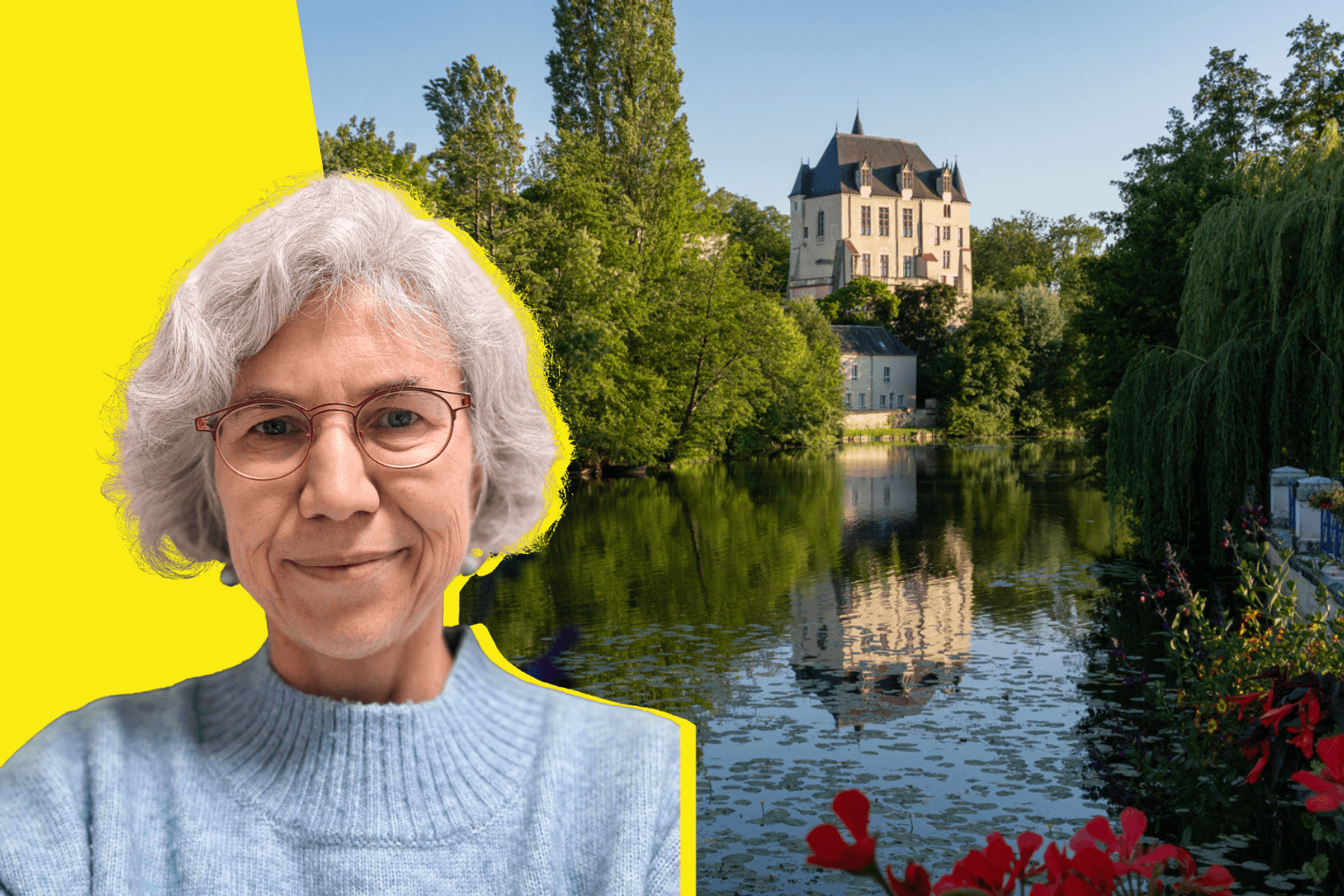
© DR
Dans l’un des territoires les moins densément peuplés en généralistes, la CPTS Châteauroux & Co a lancé fin 2021 un centre de santé expérimental : l’Offre de soin alternative et transitoire (OSAT). Installé au sein d’une maison de santé castelroussine, le dispositif – qui s’articule avec le Service d’accès aux soins local (SAS 36) – prend en charge des patients sans médecin traitant, souvent âgés, précaires ou en affection longue durée.
En 2024, l’OSAT revendique 9 000 consultations réalisées et près de 1 800 patients suivis. Pensé au départ comme un dispositif transitoire, le dispositif devait permettre de stabiliser des patients sans médecin traitant et de les réorienter vers un suivi classique dès que possible. Mais sur ce territoire confronté à une désertification médicale massive, la structure, rapidement devenue un point d’entrée incontournable… est aujourd’hui saturée. Organisation, priorisation, articulation avec le SAS 36, avantages et limites… La Dr Laurence Philippe, qui connaît bien le dispositif, nous explique.
What’s up Doc : Pourquoi lancer un tel dispositif dans le territoire ?
Laurence Philippe : L’Indre est l’un des tous derniers départements de France en termes de nombre de médecins généralistes par habitant : plus aucun d’entre eux ne prend de nouveaux patients depuis environ 15 ans. On est parmi les premiers départements à avoir été concernés par ce manque d’accès aux soins primaires : l’Indre est le département le moins dense de la région Centre-Val de Loire, qui est elle-même la moins dense de France.
Comment est née l’Offre de soins alternative et transitoire (OSAT) ?
LP. : Le projet de santé de la CPTS a été écrit en 2019 dans le cadre de la mission socle « accès aux soins ». Il a été déposé à l’ARS sous le nom « Offre de soins alternative et transitoire ». « Transitoire », parce qu’on aimerait que cette inadéquation entre l’offre et la demande en soins primaires reste passagère. Même si, vu les perspectives qu’on projette, elle est partie pour durer encore un peu dans le territoire…
L’idée, c’était de créer un dispositif pour aider les patients à passer un cap, jusqu’à ce qu’ils puissent retrouver un médecin traitant. Il n’était pas question de concurrencer la médecine générale classique, mais de se concentrer sur des patients priorisés.
« Le temps médical qu’on a réussi à mettre à disposition ne suffit plus : aujourd’hui, on est de nouveau submergé »
Quels patients avez-vous identifiés comme prioritaires ?
LP. : Les patients sans médecin traitant, porteurs d’une pathologie chronique, notamment en ALD, ou au moins une pathologie chronique même sans ALD. Et les patients plus vulnérables, par exemple bénéficiaires de la C2S. Quand le projet a été écrit, la priorisation était un peu taboue. On n’avait pas l’habitude de hiérarchiser les patients dans leur accès aux soins.
On a découvert par la suite que gérer cette priorisation n’était pas si simple sur le terrain. D’une part parce que, pour les médecins, ne faire que de la polypathologie et de la complexité peut être très usant. La concentration de patients lourds peut devenir trop importante. D’autre part, le modèle pose problème économiquement, si les médecins ne font que des consultations longues. Parce qu’on reste sur une tarification à l’acte : si on passe une demi-heure ou une heure par patient, le porteur du projet peut se retrouver en difficulté pour tenir l’équilibre financier. Donc il faut trouver un équilibre entre principe de réalité et pertinence des soins.
Cela vous-t-il conduit à faire évoluer le dispositif ?
LP. : Oui, on a dû mettre un peu d’eau dans notre vin, même si le but du projet n’est pas de viser la rentabilité. On vise la pérennité. Ça ne dérangeait pas les médecins de l’OSAT de passer une heure avec un patient polypathologique, ça leur paraissait même tout à fait normal. Mais il a fallu rediluer cette complexité pour pérenniser le dispositif, tout en évitant de saucissonner les patients : on ne va pas faire venir dix fois un patient âgé qui a du mal à se déplacer juste pour pouvoir coter une consultation à chaque fois !
C’est le seul problème que vous avez souligné au cours de l’expérimentation ?
LP. : L’autre gros soucis, c’est que le dispositif est complètement débordé. Le temps médical qu’on a réussi à mettre à disposition ces dernières années ne suffit plus. Aujourd’hui, on est de nouveau submergé. On voit arriver une marée de patients sans médecin traitant, polypathologiques, qui sont complètement à la rue.
Cela remet-il en cause l’utilité du dispositif ?
LP. : Non. L’OSAT continue à jouer son rôle. S’il donne l’accès aux soins à 2 000 patients, ce sont déjà 2 000 patients de moins qui sont dans la nature. Mais l’équilibre entre l’offre et la demande reste défavorable.
Fonctionner avec des médecins néo-retraités est très positif, le pool se renouvelle
Le dispositif repose en grande partie sur des médecins néo-retraités. Est-ce un levier solide ?
LP. : Oui, et c’est très positif : le pool se renouvelle. Les médecins partent à la retraite, parfois vers 65-70 ans, et certains reprennent un jour par semaine. Puis ils passent le relais à d’autres nouveaux retraités. C’est fluide et ça les aide aussi à tenir le coup : beaucoup culpabilisent de laisser leurs patients sans successeur. Pour eux, ça rend le départ un peu plus doux.
Vous insistez sur l’articulation avec le SAS 36. Comment cela fonctionne concrètement ?
LP. : En théorie, le parcours est simple. Le SAS a pour mission de gérer les soins non programmés, pas le suivi médical. Donc lorsqu’un patient appelle pour une demande qui relève du suivi – par exemple un renouvellement de traitement pour une hypertension – les opérateurs du SAS identifient la demande et orientent vers l’OSAT, en donnant les coordonnées du centre. Nous avons même créé dans le logiciel de régulation une catégorie spécifique « demande de suivi de pathologie chronique », précisément pour flécher ces patients vers la solution adaptée.
Sur le papier, l’articulation est claire : le SAS régule, et l’OSAT prend le relais pour les patients sans médecin traitant. Mais dans les faits, la saturation du dispositif limite fortement cette orientation, faute de moyens humains et de temps médical.
« L'arrivée des docteurs juniors ambulatoires à l'automne pourrait nous redonner une bouffée d’oxygène »
Vous parlez d’un territoire qui arrive à un point de rupture… Qu’est-ce qui permet de continuer malgré tout ?
LP. : Oui. On vient de franchir un seuil symbolique : on est passé sous la barre des 100 médecins généralistes pour tout le département. À un moment, on se dit que ce n’est plus jouable…
Le seul remède au découragement, c’est de rester collectif : se serrer les coudes, faire attention aux épuisements des uns et des autres, et continuer à penser que ça remontera un jour. Mais on aimerait que ça ne remonte pas uniquement quand d’autres territoires seront à leur tour complètement saturés, avec les dérives concurrentielles qu’on a pu voir par le passé.
L’arrivée de la première promotion de docteurs juniors ambulatoires (DJA) en médecine générale à l’automne pourrait-elle changer la donne ?
LP. : Oui. Cela pourrait nous redonner une bouffée d’oxygène. Je suis maître de stage universitaire depuis 2009, et me positionne comme futur terrain de stage pour les DJA. Je commence à louer un local pour réserver un bureau, à l’équiper, tout en ne sachant pas si je serai choisie. C’est un pari, et tout le monde n’est pas prêt à le faire. Mais je pense que c’est bénéfique pour un jeune médecin : on lui donne un sentiment d’intérêt général. Recevoir des gens en détresse, c’est difficile, mais c’est aussi gratifiant et ça redonne du sens au métier.
Si vous deviez résumer l’OSAT aujourd’hui ?
LP. : Je dirais que ce petit radeau tient la tempête. Il est toujours là, il fait son travail. Le principe n’est pas remis en question : c’est une structure qui vient épauler les soins primaires en mobilisant du temps médical disponible dans l’intérêt du territoire.
A voir aussi

 Médecine esthétique : la patientèle masculine progresse plus vite que celle des femmes
Médecine esthétique : la patientèle masculine progresse plus vite que celle des femmes












