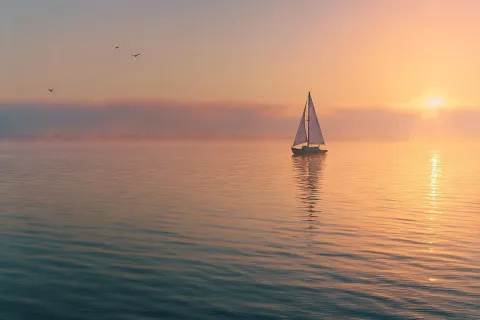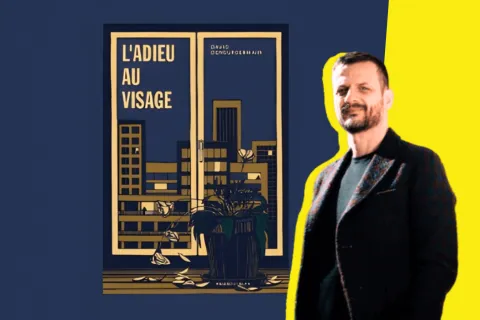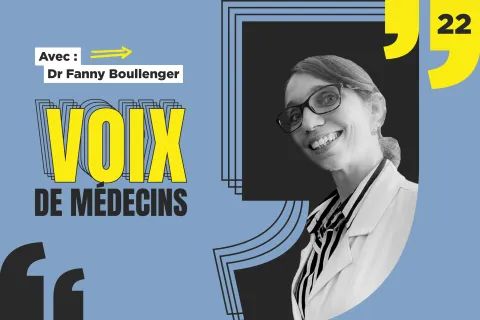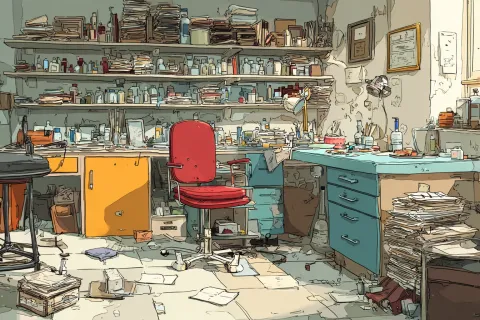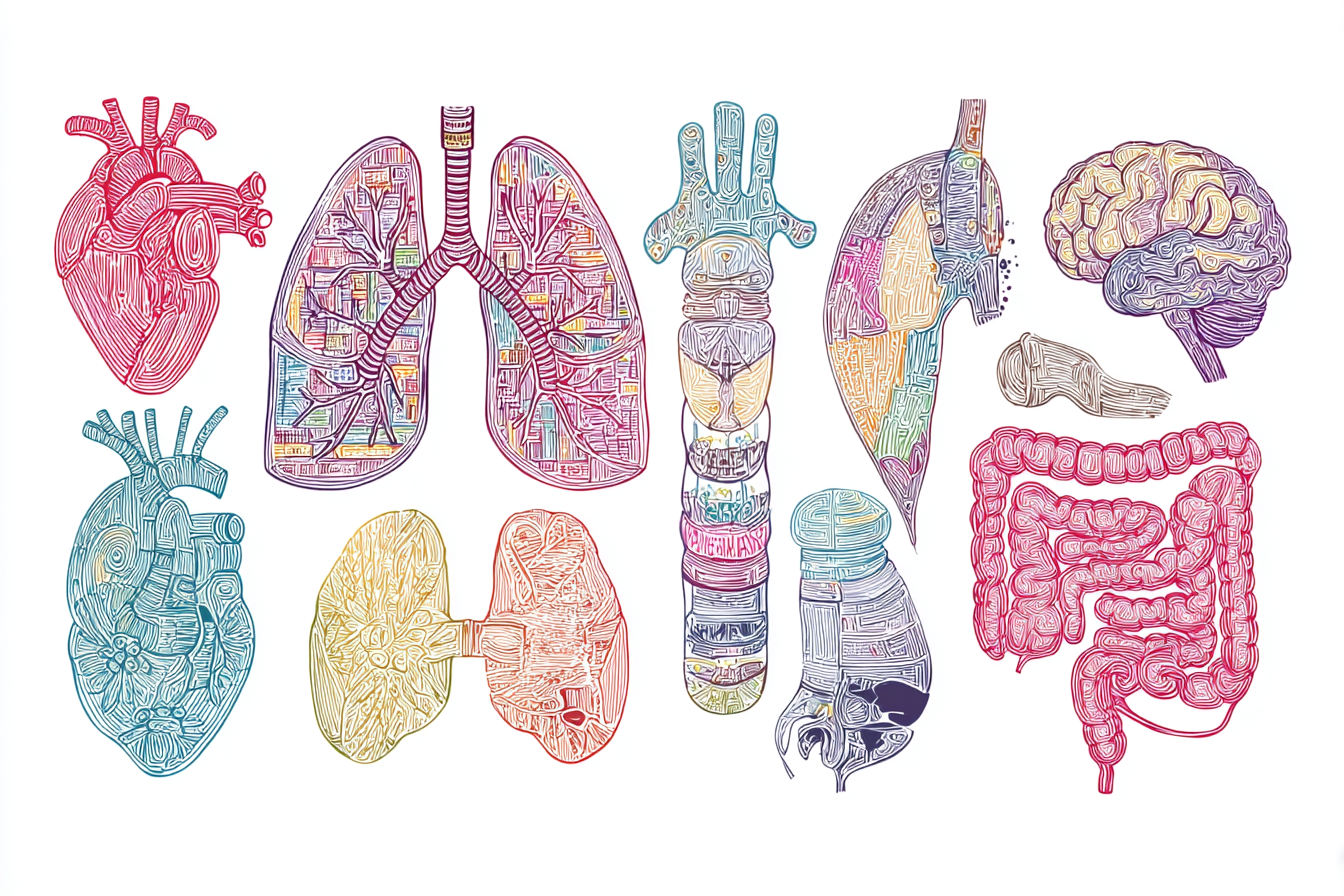
© Midjourney x What's up Doc
« Tant qu’on n’est pas touché personnellement ou dans son cercle proche, on ne visualise pas ce que le don d’organes peut amener à nos vies », a glissé Aziza Oubaita, qui fêtera mi-juillet ses neuf ans de greffe du cœur, lors d’une conférence de presse de l’Agence de la biomédecine avant la Journée nationale de réflexion sur le don d’organes de dimanche.
À 43 ans, après une bronchite mal soignée ayant dégénéré en myocardite aggravée, cette ex-championne du monde de boxe s’est « retrouvée au pied du mur avec une option greffe du cœur ». Il était d’abord « inconcevable », pour elle, de s’imaginer avec un autre cœur et « un trou dans la poitrine » : elle a refusé… avant de « tenter le tout pour tout ».
Cette greffe l’a « ballottée » physiquement et obligée à « un processus de deuil », mais cette sportive a fait, 18 mois après, un jubilé de boxe et démarrera en septembre un atelier d’éducation thérapeutique à l’hôpital Bichat (AP-HP), « Adopte un cœur.com ! »
Les dons restent insuffisants
Rendant hommage aux donneurs, l’Agence de la biomédecine entend inciter chacun à communiquer à ses proches sa position sur le don d’organes.
Quand son oncle est décédé en février, Maliane Bruge a pu rapporter aux soignants, avec d’autres proches, la volonté du défunt. « On est fier qu’il ait pu aider plusieurs personnes après son départ », a-t-elle affirmé devant la presse.
En France, la loi stipule que nous sommes tous donneurs présumés. Si la personne décédée n’était pas inscrite au registre national des refus, les soignants se tournent vers les proches pour s’assurer qu’elle n’avait pas, de son vivant, exprimé une opposition au don d’organes et de tissus. En cas de doute, les proches peuvent refuser.
Si la France a retrouvé en 2024 un niveau de greffes proche de l’avant-Covid (6 034), « cela ne suffit pas » : plus de 22 000 patients restent sur liste d’attente, a souligné mardi la directrice de l’Agence de la biomédecine, Marine Jeantet.
Face aux refus croissants de familles – 36,4 % d’opposition en 2024 – et aux « idées reçues », elle a rappelé que tout le monde peut être donneur, « sans limite d’âge », ou que « le don d’organes est compatible avec tous les rites funéraires ».
« Apprendre à parler aux familles »
L’une des clefs pour faire mieux, selon Odile Desrues, représentante de la Société française de la médecine de prélèvement d’organes et de tissus et en poste à Toulon, est de « prendre soin des familles et des proches pour les amener à dire "oui"».
« Une collègue médecin dit souvent que "le miracle c’est la greffe", et, pour y arriver, il y a un chemin semé d’embûches », où des soignants accompagnent les familles pour donner « une seconde vie aux organes » du défunt, a résumé cette anesthésiste. Des infirmières spécialisées demandent également aux proches si la personne aurait été d’accord pour donner ses tissus, « comme des cornées pour permettre à des greffés de retrouver la vue ».
« Il faut apprendre à parler aux familles, à expliquer que ce don est un soin pour le futur greffé et un accompagnement pour le donneur », dont le corps sera traité avec grand respect, a expliqué la médecin.
Il est aussi souhaitable de permettre aux proches « un geste envers le défunt » avant le prélèvement d’organes, juge Thomas Thuillier, infirmier de coordination, se souvenant que Maliane Bruge et d’autres membres de sa famille avaient préparé une playlist pour accompagner ce passage au bloc opératoire.
L’accord des familles se joue aussi parfois dans une relation de confiance nouée avant le moment fatidique. Ainsi, à l’hôpital de Toulon, « la réanimation est ouverte 24h sur 24 » aux proches, et « c’est toujours le même médecin qui reçoit les familles l’après-midi », a expliqué Odile Desrues.
Il faut qu’« on ouvre plus les portes des services, en réanimation, gériatrie… », a renchéri Rémi Salomon, président de la Conférence des présidents de commissions médicales d’établissements des CHU.
Car, a jugé ce néphrologue pédiatrique, « certaines familles peuvent se dire "on n’a pas été si bien traitées, on ne voit pas pourquoi on donnerait à la société ce qu’elle ne nous a pas donné" ».
A voir aussi
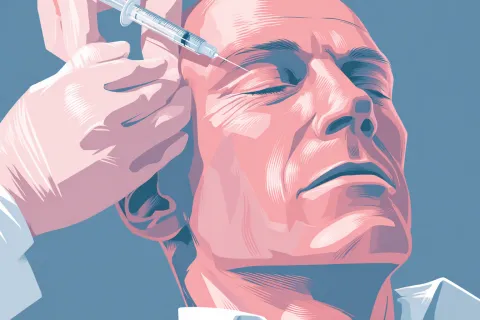
 Médecine esthétique : la patientèle masculine progresse plus vite que celle des femmes
Médecine esthétique : la patientèle masculine progresse plus vite que celle des femmes