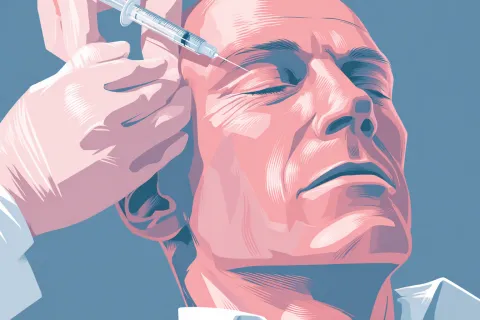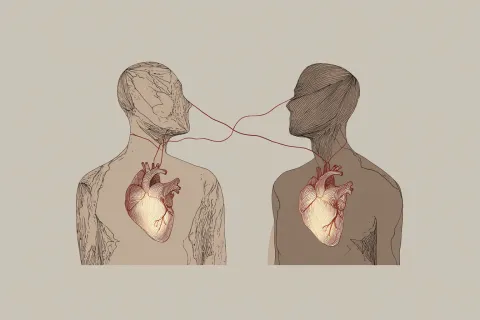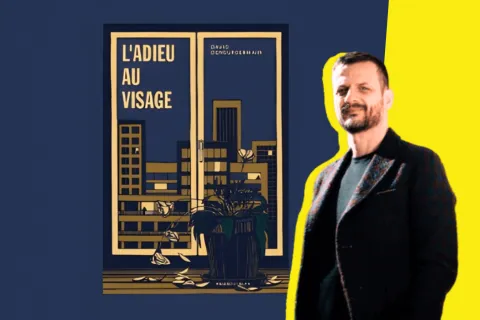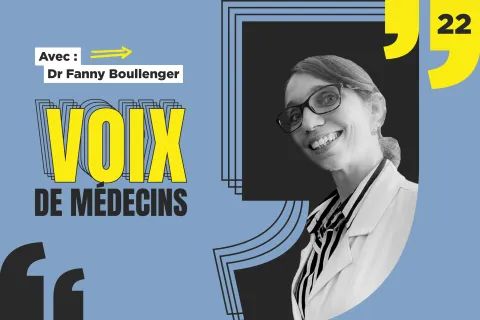© Midjourney x What's up Doc
Anticiper le retour dès le premier jour
Les troubles psychiques, notamment l’anxiété, la dépression, le burn-out, mais aussi les séquelles du Covid et les TMS comme la lombalgie, représentent les principales causes d’arrêts longs. Leur impact est majeur sur la durée et la complexité des reprises. Ils exigent donc une coordination renforcée entre tous les intervenants qui gravitent autour du patient.
Les arrêts courts et répétés peuvent révéler des fragilités plus profondes : mal-être au travail, pathologies non diagnostiquées, ou encore difficultés sociales. Repérer ces signaux faibles et orienter tôt vers la médecine du travail et/ou un accompagnement psychologique peut éviter un basculement vers l’exclusion professionnelle.
L’arrêt de travail, un outil temporaire
« Un arrêt de travail est nécessaire tant qu’on pense que la situation peut s’améliorer. Quand on pense qu’il n’y aura plus d’amélioration, ce n’est plus un arrêt qu’il faut envisager, c’est une invalidité », rappelle Cyril Bègue. Ce message, simple en apparence, est essentiel : il invite les confrères à penser l’arrêt comme un outil temporaire, inscrit dans une dynamique de soin, et non comme une solution durable.
Selon Cyril Bègue, la clé est de ne pas laisser filer les arrêts. « Moi, je préconise de ne pas aller à plus de deux semaines d’arrêt d’emblée, sauf situation évidente comme un plâtre ou une chirurgie programmée. Sinon, il faut revoir rapidement le patient, tous les 7 à 15 jours maximum, pour réévaluer la situation. » Cette logique de réévaluation régulière permet de concevoir le travail non pas comme une contrainte extérieure, mais comme un levier thérapeutique. « Si on met un arrêt d’un mois, sans revoir la personne, on ne sait pas ce qui s’est passé, on ne peut pas évaluer ni soutenir. Alors que revoir le patient, c’est ce qui permet de comprendre l’évolution et d’anticiper une reprise adaptée », insiste-t-il.
Au-delà de trois mois d’arrêt, la vigilance doit être maximale. C’est le moment de penser à la visite de pré-reprise et d’orienter vers la médecine du travail. « Une personne qui est arrêtée plus de trois mois doit rencontrer un médecin du travail. Après six mois, le risque de non-retour à l’emploi est de 50 %. C’est un enjeu énorme pour nos patients », alerte le médecin.
Le travail en réseau : un passage obligé
La reprise mobilise plusieurs acteurs dont la coordination est déterminante. Le duo médecin généraliste – médecin du travail en est le pivot ! La visite de pré-reprise, organisée entre un et trois mois d’arrêt, est selon Cyril Bègue « l’outil numéro un du maintien dans l’emploi ». Elle permet d’imaginer des aménagements de poste, d’envisager un temps partiel thérapeutique et surtout d’ouvrir un dialogue tripartite entre salarié, employeur et médecin.
Mais d’autres relais doivent être intégrés : le service social de l’Assurance Maladie, pour accompagner les situations socialement complexes comme l’isolement ou la précarité ; le service médical de l’Assurance Maladie, accessible via amelipro, qui apporte conseils et arbitrages sur les durées d’arrêt ; enfin, les dispositifs de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) à solliciter en cas de déficience durable. La RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) est une véritable boite à outil pour les situations de maintien dans l’emploi les plus complexes.
SOS-IJ : un futur appui pour les généralistes
À l’horizon 2026, l’Assurance Maladie prévoit de généraliser le dispositif SOS-IJ, actuellement expérimenté dans le Rhône et l’Eure-et-Loir. Ce service permettra aux médecins traitants de solliciter directement le service médical pour exposer des cas d’arrêts longs ou complexes et co-construire des solutions de reprise. Pensé comme un appui, il devrait constituer un outil complémentaire pour sécuriser la gestion des retours au travail et partager la responsabilité de ces situations souvent lourdes.
Dans les faits, l’accès aux médecins du travail peut varier selon la zone géographique. « Dans certains territoires, il y en a très peu. Raison de plus pour anticiper. Même si le rendez-vous n’est fixé qu’à un mois, il faut l’avoir prévu pour ne pas se retrouver à quatre ou six mois d’arrêt sans perspective », recommande Cyril Bègue. Parmi les leviers à activer avec la médecine du travail, le temps partiel thérapeutique est souvent décisif. « C’est un combo gagnant », explique le généraliste. « Reprendre de façon progressive, permet d’éviter l’éloignement prolongé de l’entreprise, même si la capacité de travail n’est pas encore à 100 %. » L’association entre visite de pré-reprise et mise en place d’un temps partiel thérapeutique peut suffire à relancer une dynamique positive. À cela peuvent s’ajouter d’autres ajustements progressifs : modulation des horaires, adaptation de la charge de travail, accompagnement psychologique, activité physique adaptée.
Des médecins mieux accompagnés
L’Assurance Maladie met également à disposition des médecins des outils et dispositifs pour les accompagner dans le suivi de leurs patients en arrêt de travail et dans la prévention de la désinsertion professionnelle.
« Notre motivation de médecin n’est pas de faire des économies, mais de préserver la santé du patient. Néanmoins, un arrêt plus court, bien accompagné, c’est moins de risque de désinsertion, moins de chômage, et donc une meilleure santé à long terme ce qui conduira à faire des économies », conclut Cyril Bègue.
A voir aussi