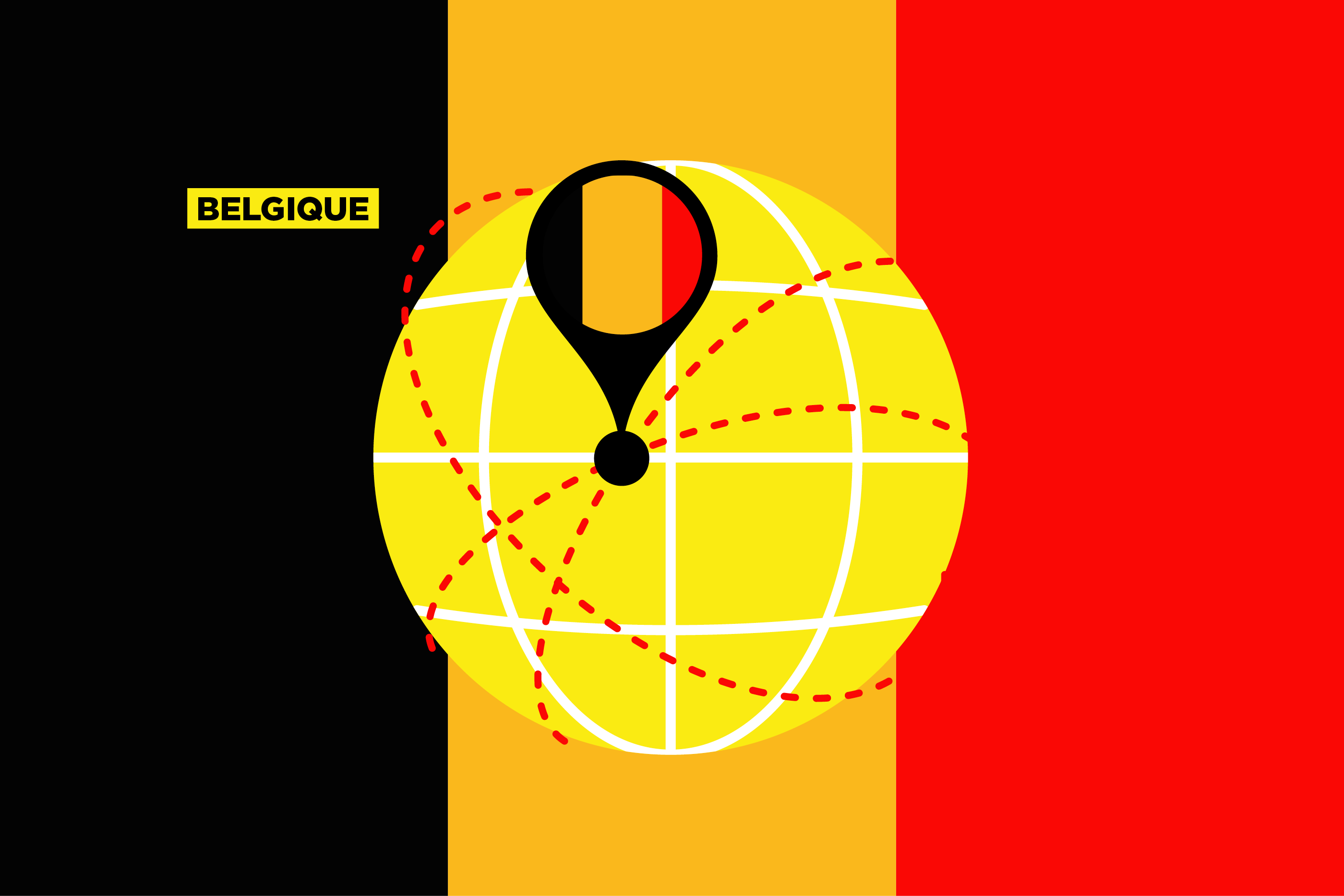
© DR
Formée à Namur, puis à l’Université Catholique de Louvain (UCL), Marie-Thérèse Maréchal, 38 ans, exerce depuis une petite dizaine d’années au CHU Saint-Pierre de Bruxelles. Cette spécialiste en chirurgie bariatrique nous confie les spécificités de son exercice et le regard qu'elle porte sur le système de santé belge.
What’s up Doc : Vous vous présentez souvent comme « chirurgienne générale », une dénomination disparue en France…
Marie-Thérese Maréchal : C’est un terme générique que l’on utilise encore beaucoup pour parler de la chirurgie digestive, parce qu’elle regroupe aussi la prise en charge des plaies, les interventions lourdes, et la proctologie. En chirurgie digestive, les premières années de formation (l’équivalent d’internat, ndlr) sont communes avec les chirurgies vasculaires, thoraciques et cardiaques, de manière à avoir une formation globale. Durant six ans de spécialisation, on a un certain quota d’interventions à réaliser dans chaque discipline, avant de se spécialiser réellement, lors des deux dernières années.
Six ans d’internat donc. Le cursus universitaire est le même qu’en France ?
M-TM. : Plus ou moins oui, ce sont plutôt les termes qui changent. Il y a toutefois des petites différences entre le réseau universitaire catholique et le réseau libre (public). Moi j’ai fait mes trois premières années, qu’on appelle années de baccalauréat, à l’université de Namur. Ensuite, je suis parti à l’Université catholique de Louvain (UCL) pour mon master de médecine, qui correspond plus ou moins à l’externat. On les appelle les stagiaires. Enfin, quand on se spécialise, donc l’équivalent de l’internat, on parle de médecin assistant candidat clinicien spécialiste (Maccs). La différence avec la France, c’est qu’ils ne sont pas rémunérés par l’État, mais par l’hôpital qui les embauche.
Il y a des différences entre la région wallonne et flamande ?
M-TM. : Pas vraiment. Les universités francophones et néerlandophones fournissent à mon sens la même qualité d’enseignement, et il y a des hôpitaux compétents des deux côtés. Lorsqu’on est bilingue, on peut facilement bouger après l’obtention du diplôme. Et d’après mes collègues qui ont eu l’occasion d’exercer dans les deux circuits, il n’y a pas de différence.
Parlez-nous du système de santé belge dans les grandes lignes…
M-TM. : Il y a un système public/privé. Les hôpitaux publics, universitaires ou non, soignent le tout-venant : toute personne qui a besoin de soins est prise en charge, mais les citoyens sont invités à souscrire à une mutuelle, celle de base étant globalement accessible à tout le monde. On peut également contracter une assurance privée, qui donne accès à de la médecine privée, dans des hôpitaux bien connus pour cela. Car au sein des hôpitaux publics, on peut également avoir une pratique privée, on y reviendra.
En Belgique, on ne parle pas de secteurs conventionnels comme en France. Par contre, on a effectivement la possibilité, en tant que médecin, d’être conventionné (Inami, sécurité sociale belge, ndlr), partiellement déconventionné ou totalement déconventionné. À l’hôpital public, la majorité des médecins sont conventionnés à 100%. Mais s’ils décident d’avoir un cabinet à côté, ou de consulter à des heures bien précises à l’hôpital, ils peuvent appliquer des dépassements d’honoraires, qui sont réglementés.
« Les libéraux fonctionnent beaucoup en regroupement de cabinets »
Apparemment, le statut de praticien hospitalier se perd, et on évolue vers une pratique indépendante à l’hôpital public ?
M-TM. : Oui, c’était déjà le cas avant, mais cela s’est amplifié au sortir de la crise du Covid. Beaucoup d’hôpitaux ont mis en place ou ont renforcé des systèmes dits de « pool ». On travaille en équipe et l’argent perçu est mis dans un pot commun et redistribué entre les médecins du service, en fonction de l’ancienneté, du temps de travail et parfois du type d’interventions. C’est le cas dans mon CHU : on était majoritairement salariés, et certains services sont progressivement passés au système de pool. D’autres fonctionnent toujours à l’acte.
Comment s’organise la médecine libérale ?
M-TM. : Elle est également fort développée. La particularité de la Belgique, c’est que c’est un petit pays avec beaucoup d’hôpitaux, par rapport à la taille du territoire. À mon sens, il y a assez de travail pour tous les médecins, et pas réellement de système concurrentiel. On peut avoir un cabinet médical personnel sans difficultés, même si, en pratique, les libéraux fonctionnent beaucoup en regroupement de cabinets, exercice en commun. Et ce, quelle que soit la spécialité.
Pour la médecine générale, la notion de médecin de famille se perd un peu dans les grandes villes. Il y a beaucoup de maisons médicales regroupant des généralistes, avec parfois, des paramédicaux. Les patients sont évidemment encouragés à avoir un médecin traitant de référence, ou, au moins, être affiliés à une maison médicale. La consultation de base coûte une trentaine d’euros, comme en France. Dans certaines villes à la population assez dense, certains patients se retrouvent dans la difficulté de trouver un médecin traitant. Mais il y a quand même beaucoup de contact entre généralistes et spécialistes dans les zones un peu plus reculées, moins dotées en médecins.
Il y a des spécialités en tension ?
M-TM. : C’est très fluctuant. Certaines peinent toujours à recruter, mais ce ne sont plus les mêmes qu’il y a dix ou quinze ans. On constate encore des difficultés à attirer les médecins généralistes dans les zones les plus éloignées des grandes villes, notamment en Wallonie. Comme il n’existe pas de contrainte sur l’installation, les jeunes médecins privilégient souvent l’exercice groupé pour bénéficier d’une meilleure qualité de vie et d’horaires plus souples. Ils ont donc tendance à se regrouper dans les grandes villes. Dans certaines spécialités chirurgicales, on observe une certaine saturation du réseau, ce qui complique l’insertion des jeunes chirurgiens. Par exemple, beaucoup de collègues partent en France après leur diplôme, et reviennent ensuite quand une place se libère. Enfin, il me semble aussi qu’il faudrait plus d’ophtalmos, même leur nombre est déjà élevé, car les délais d’attente pour un rendez-vous ne diminuent pas. À part cela, la répartition est plus ou moins équilibrée.
« la cataracte est beaucoup plus valorisée financièrement qu’une appendicite chez nous… même avec une péritonite qui prend 1h30 »
Qu’en est-il de la rémunération des médecins belges ?
M-TM. : Il y a énormément de disparités, et pas d’uniformisation entre les hôpitaux. Les prix des consultations varient entre les spécialités, avec un système de code assez ancien pour certaines, qui sont plus « lucratives », sans que ce soit forcément « justifié » par la lourdeur de l’acte. On prend souvent l’exemple de l’ophtalmologie où la cataracte est beaucoup plus valorisée financièrement qu’une appendicite… même avec une péritonite qui prend 1h30. Il y a également des écarts intra-spécialités. En chirurgie générale, le médecin qui fait plus de proctologie aura des remboursements moindres que celui qui fait des colectomies ou des interventions bariatriques. C’est pour cela que le système de pool fonctionne bien en chirurgie. La personne qui enchaîne les petits cas ne sera pas désavantagée par rapport à celle qui opère un peu moins, mais réalise des interventions plus lourdes. C’est une manière de soigner tous les patients sans être en concurrence les uns avec les autres.
(En 2023, un médecin généraliste à temps plein affiche en moyenne un chiffre d'affaires brut de 201 640 euros, selon un rapport de l’Inami. On peut estimer son revenu brut à 120 000-150 000 euros, et son revenu net à 60 000 à 70 000 euros, ndlr)
Globalement, les Belges sont-ils satisfaits de leur système de santé ?
M-TM. : À première vue, il n’a pas vraiment de raison de se plaindre. Le système de santé soigne tout le monde et les patients ont accès à la majorité des traitements sans débourser énormément. Bien-sûr, la Belgique n’échappe pas aux difficultés financières dans lesquelles se retrouvent beaucoup de pays européens. Pas mal d’hôpitaux sont déficitaires et se restructurent pour essayer de contenir ce déficit, en coupant énormément dans les budgets, et en demandant beaucoup d’efforts aux personnels administratif et soignant. Par ailleurs, pas mal de choses sont en train d’être mises en place, depuis peu, concernant le plafonnement des honoraires. Il y a beaucoup de dérives dans les hôpitaux privés où des médecins demandent systématiquement 300% de dépassement, et contraignent parfois les patients à souscrire à une assurance s’ils veulent être pris en charge.
Le pays attire toujours les étudiants français ?
M-TM. : Toujours, un petit peu en médecine, mais beaucoup en paramédical, infirmiers et kiné. J’ai beaucoup de collègues infirmières françaises, qui sont d’ailleurs restées en Belgique après leurs études. Ça tombe bien, le pays est de nouveau en pénurie d’infirmières hospitalières, ce qui nécessite beaucoup de reconfigurations managériales, entre le bloc et la néonatalité, pour essayer de combler les trous.













