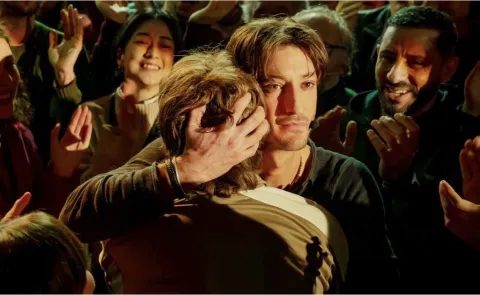Isabelle Huppert dans La femme la plus riche du monde de Thierry Klifa.
© Manuel Moutier/La femme la plus riche du monde
Tout pouvoir expose à l’emprise, celle exercée pour le capter ou le conserver. En scénarisant l’affaire Bettencourt, ou comment l’équilibre d’une grande fortune française est menacée par un photographe mondain plus avide qu’intéressé, Thierry Klifa réalise un film purement français. Avec ses forces et ses faiblesses.
Tout, dans La femme la plus riche du monde, respire le travail bien fait. Trop bien fait ? À chacun de l’apprécier. Toujours est-il que cette armada de scénaristes et d’acteurs, au service d’un metteur en scène qui nous avait jusqu’alors habitués à un classicisme discret, a accouché d’un film équilatéral, tendu autour de trois axes que rien ne vient jamais dévier.
« Laurent Laffite fait plus qu'exceller, Marina Foïs délicieuse de retenue, Isabelle Hupert avec chaleur et humanité »
Le film a été vendu à grands renforts de punchlines efficaces et de drôlerie enlevée, au final plus proche de la comédie de caractères que du pastiche attendu. Nous voilà en immersion dans la vanité de la grande bourgeoisie, à mi-chemin entre Proust et Labiche, que viendrait dézinguer le comique troupier et pompier d’un trublion. Dans le rôle du cabot dans un jeu de quilles, Laurent Laffitte fait plus qu’exceller. Il capte la lumière pour mieux la renvoyer sur des partenaires au travail plus complexe, dans la défense de rôles a priori plus ingrats. On pense à Marina Foïs, délicieuse de retenue en godiche blessée à vif, ou encore à Raphaël Personnaz qui, dans le rôle du majordome peroxydé et froid, convoque jusqu’au trouble Alain Delon et ses ambiguïtés constamment au bord du ridicule. Huppert survole cette distribution de prestige avec une aisance que les années ne cessent de renforcer, insufflant dans sa trajectoire de star de plus en plus de chaleur et d’humanité - mais avec la même détermination et la même maîtrise.
« C’est la chronique d’une certaine France autant que le miroir d’un certain cinéma français»
Le film tient également du feuilleton, à la fois familial, politique et sociétal. Un équivalent de roman, à la structure narrative inviolable, mais qui paradoxalement se dévore par plusieurs bouts. C’est la chronique d’une certaine France autant que le miroir d’un certain cinéma français. On bouscule, mais jamais trop. Et donc toujours mal. On sent qu’à travers le personnage de Pierre-Alain Fantin et son outrance si facile à écrire et à manier, les scénaristes se sont fait plaisir et se sont confortablement cachés derrière l’alibi de son insolence pour dénoncer les compromissions et les hypocrisies à l’œuvre dans ce scandale médiatique, et plus globalement les ambiguïtés françaises qui ne cessent d’irriguer la vie politique et financière depuis, au minimum, les Croix de Feu et la francisque. Le résultat est à la fois trop long pour un seul film - la fresque a tendance à s’étirer surtout quand elle s’impose de rentrer dans les détails de l’affaire - et trop rapide pour évoquer des sujets qu’il est interdit de bâcler. Entre le papy collabo prestement excusé, pour des motifs en partie financiers, par la branche juive de la famille, en mode circulez y’a rien à voir (un peu comme lorsqu’est à peine survolé le soupçon de financement de la campagne d’un certain président) et le photographe homo renvoyé en permanence à la caricature de folle du Marais, Klifa semble incapable de se prémunir du mauvais goût. C’est la principale conséquence négative de ce souci constant de garder le cul entre plusieurs chaises.
« Un film parfois imparfait, souvent plaisant et ponctuellement passionnant »
Le dernier des trois axes étant, fort heureusement, le plus intéressant, celui qui en tout cas sauve le tout. C’est disons la veine la plus psychologisante du film, celle qui, par delà le feuilletonnage et le pastiche, permet d’aborder, avec nous semble-t-il beaucoup de pertinence et d’accessibilité, la complexité des démarches de mise sous protection des biens, les enjeux qu’elles renferment et les frontières floues auxquelles elles se percutent, quand l’altération du discernement ou de la cognition est trop ténue pour qu’elle s’imbrique dans le puzzle familial. Ce que montre le film, avec autant de pertinence que de cruauté, c’est à quel point cette démarche reposant sur une expertise psychologique ou médicale constitue également, et peut-être avant tout, un expédient au service de l’ordre moral, dans laquelle la liberté, habituellement érigée en vertu cardinale et en droit fondamental, est secondaire. Dans cette affaire, chacun a ses raisons, et le dénouement se fera aux dépens du plus déviant et au détriment de principes jusqu’alors intangibles - on pense à la caution morale que constitue l’œcuménisme de façade du clan. Quand la fille Bettencourt - pardon, Farrère - confronte sa mère pour savoir si elle était au courant du passé collabo du patriarche, celle-ci répond évasivement que non, ou qu’elle a oublié. « Ce qui est pareil. » Tout tient dans cette phrase-là. Klifa et Huppert, dans cette histoire, ont pris leur parti. En déplaçant le curseur - le peu d’importance, au final, de la réalité du déclin cognitif de la dame - ils tapent dans le mille. L’enjeu, dans ces démarches, se situe bien souvent ailleurs. L’intérêt et la survie de la famille, dans les affaires patrimoniales comme dans la protection de l’enfance, priment souvent, dans le droit, sur l’individu et son bonheur.
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/larmes-de-guerre-critique-de-muganga-celui-qui-soigne-de-marie-helene-roux
En résulte un film parfois imparfait, souvent plaisant et ponctuellement passionnant. Trop léché et corseté, dans sa fantaisie comme dans sa férocité, il eut gagné à s’autoriser plus de respirations, à l’image de la superbe scène où Anne Brochet, fantôme d’une créature échappée du Palace ou des Bains, chante, mélancolique et veloutée, le prix de l’affranchissement.