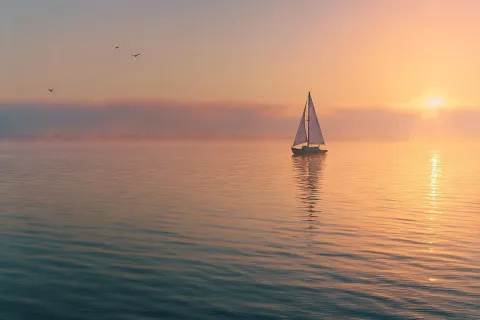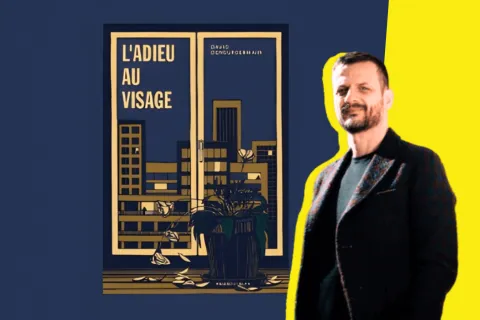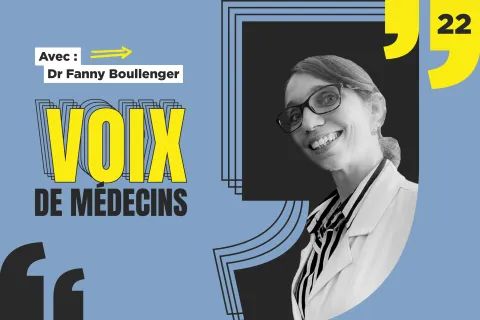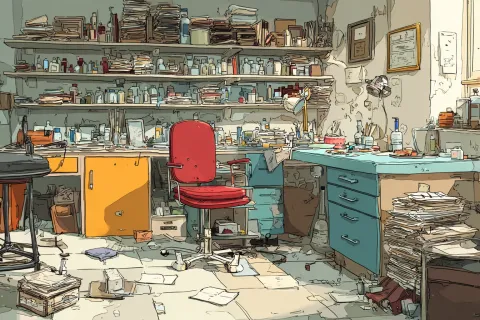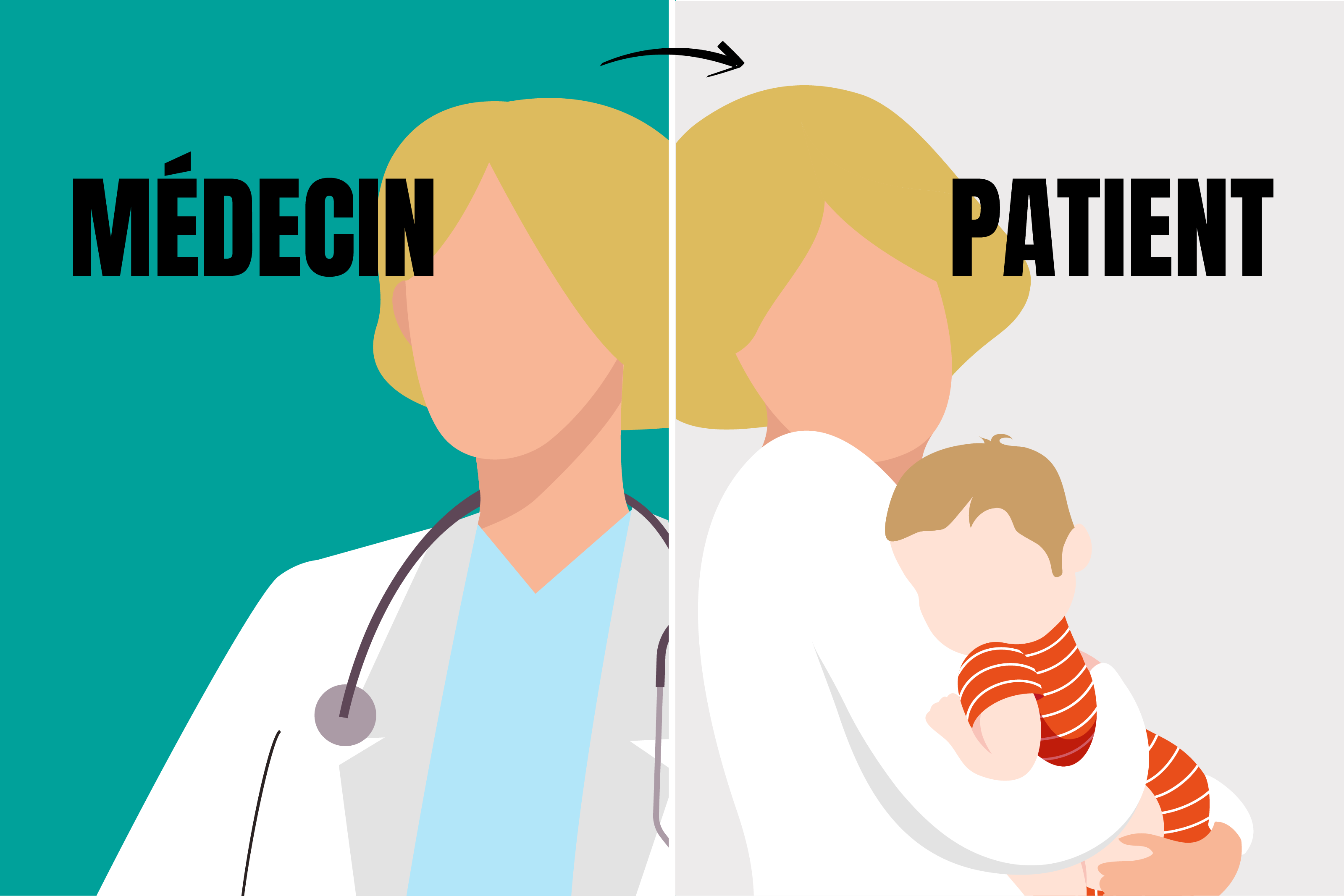
© DR
L’histoire d’Estelle, 45 ans aujourd’hui, remonte à il y a dix ans. En février 2015, sa fille Haya, alors âgée de treize mois, dort de moins en moins bien, mange peu et s’agite nerveusement.
Face à ces symptômes inquiétants, les consultations chez le pédiatre s’enchaînent pendant plusieurs semaines, toujours menées par le père ou les grands-parents. À chaque fois, le diagnostic est le même : « on nous assure que c’est une otite et on ressort avec des antibiotiques ».
Pourtant, l’état de santé d'Haya continue d’empirer, jusqu’au jour où elle ne tient plus sur ses jambes et s’écroule. Pour sa mère, c’est la goutte d’eau, elle prend les choses en main. « J’ouvre son carnet de santé et répertorie tout ce qu’elle faisait avant et qu’elle ne fait plus. Je le montre au pédiatre en lui disant que je pense vraiment que c’est grave », raconte-t-elle.
Finalement, grâce à l’insistance d’Estelle, et probablement un peu à son statut de médecin, une place est trouvée au CHU de Brest deux jours plus tard.
Diagnostic et changement de cap
À l’hôpital, l’état du bébé est pris au sérieux, et une consultation de neuropédiatrie en urgence est demandée. Estelle se rappelle les longs couloirs, à travers lesquels on l’accompagne avec bienveillance. « C’était limite si on nous déployait le tapis rouge. C’est cool l’hôpital public quand ça fonctionne », se dit-elle à ce moment.
Elle se souvient également du neuropédiatre qui, apprenant qu’elle est médecin, l’inclut dans les discussions avec les équipes. Une position étrange, presque déroutante, pour la mère de famille.
L’échographie demandée révèle une masse tissulaire, qui nécessite une IRM complémentaire. Mais les mots ne percutent pas chez Estelle, pourtant habituée au jargon médical : « j’étais dans un état second, entre comprendre et ne pas vouloir comprendre ».
On installe alors les parents dans une chambre d’hospitalisation et Haya est placée sous morphine pour soulager sa douleur. La maman réalise enfin où elle est : en oncopédiatrie. Une évidence qui lui avait jusque-là échappé, malgré les enfants sans cheveux croisés dans le service.
Paradoxalement, c’était « plutôt rassurant » de bénéficier « enfin » d’une prise en charge à la hauteur de la situation, avec des équipes soignantes disponibles pour la famille et un soulagement médicamenteux pour la petite.
Mais peu après, le diagnostic tombe : un neuroblastome en sablier, c’est-à-dire engainant la moelle épinière, qui n’est développée qu’à 5% de sa taille normale. Ce qui explique la douleur atroce et l’incapacité à marcher.
À ce moment-là, « tout s’arrête, c’est la vie qui bascule ». Estelle, qui projetait à l’époque de partir vivre en famille à Tahiti, comprend que le départ est annulé. Il n’y a pas de soins de ce type là-bas.
Décision est prise par l’équipe oncologique de ne pas opter pour la chirurgie, trop risquée, et de tenter la chimiothérapie, malgré le risque de non-réponse.
C’est en réanimation pédiatrique, pour la pose du cathéter permettant d’acheminer la chimio, qu’Estelle imagine une histoire qui deviendra plus tard un livre.
Pour rassurer sa fille pendant qu’elle se fait « triturer » le bras par une interne encore peu expérimentée, Estelle lui conte ce voyage « biospatiotemporel », où de gentils extraterrestres cherchent à la délivrer de l’alien malfaisant qui a envahi son corps.
« On perd beaucoup à ne pas considérer les gens »
La nuit suivante, l’enfant souffre et sa mère sollicite de l’aide auprès de l’équipe de garde. « Personne ne m’écoute, j’ai le sentiment de ne pas être pris en compte », se rappelle-t-elle. Une indifférence qui vient entacher une prise en charge hospitalière jusqu’ici « remarquable ».
Puis arrive cette première matinée à l'hôpital, où Estelle est presque réveillée par la visite d’un « vieux pédiatre », suivi par « une ribambelle » de jeunes gens en blouse, « sans doute des externes ». Sans lui adresser un mot, ni un regard, il examine Haya et conclut : « cet enfant a mal. Une enfant de son âge qui reste immobile comme cela est une enfant qui souffre ». Estelle elle-même aura retenu la leçon. Le médecin ordonne l’administration d’antidouleurs.
Malgré l’étrangeté de la situation, et son côté expéditif, Estelle l’admet : « j’ai eu de la chance de tomber sur lui ». Elle nuance toutefois : « on perd beaucoup à ne pas considérer les gens ».
Cette expérience, bien que douloureuse à pleins d’égards, a au moins eu le mérite de « confirmer (l)a position éthique » de la pédopsychiatre sur le côté humain de la prise en charge.
Un confinement « en 10 fois pire »
Deux semaines d’hospitalisation complète s’ensuivent, avec de la chimio à forte dose dans une « ambiance de chambre stérile », et sans visite de l’extérieur à cause de l’aplasie.
Fort heureusement, les premières IRM de contrôle montrent une tendance à la stabilisation de la tumeur, qui diminue ensuite progressivement. Pour autant, « on sent petit à petit que les gens sont moins présents, moins attentionnés, on s’autonomise », symptôme d’un traitement qui fonctionne et d’une urgence qui se relativise…
« Plus on s’éloigne de l’urgence vitale, plus c’est dur psychologiquement d’accepter les soins intrusifs »
Au bout de 15 jours, Haya, dont l’état s’améliore de jour en jour, peut retourner à la maison. La famille part pour 3 mois d'« HAD qui ne dit pas son nom », à base de soins de bouche, d’antimycotiques, de stérilisation systématique de tous les objets… Avec le recul, « c’était comme un confinement, mais en dix fois pire », compare Estelle.
Enfin, la petite se remet debout, mais perd ses cheveux dans le même temps. « Un vrai passage pour nous, parents ». Haya, elle, « s’en foutait complètement ».
Deuxième choc : la chirurgie
Mais l’absence d’activité tumorale ne signifie pas la fin du calvaire pour la famille, qui subit un nouveau revers au bout de deux mois. Protocole du neuroblastome oblige : la chirurgie (surrénalectomie) s’impose désormais, à cause du risque de récidive. Une éventualité qu’Estelle avait, depuis un moment, écartée, volontairement ou pas.
Pour la famille, qui pensait enfin pouvoir aller de l’avant, ce rebondissement inattendu est « insupportable ». D’autant qu’il faut se déplacer à Rennes, le CHU de Brest ne disposant pas de service de chirurgie pédiatrique. « Plus on s’éloigne de l’urgence vitale, plus c’est dur psychologiquement d’accepter les soins intrusifs », commente la mère de famille, qui se rappelle s’être opposée en premier lieu à l’intervention.
Là-encore, Estelle souffre de laisser son enfant partir seule au bloc, encadrée par « deux grands brancardiers hyper balèzes » indifférents, le regard rivé sur leur téléphone.
Cinq heures plus tard, Haya revient. L’opération s’est bien passée, le chirurgien prend le temps de tout expliquer, les parents sont soulagés.
Pour séquelle, l'enfant gardera un pied tordu dû à la compression médullaire, qui devra être traité pendant 4 ans, à base de kiné, d’attelle pendant le sommeil et de chaussures orthopédiques, à changer en même temps qu'elle grandit. Une anomalie pourtant remarquée à l’époque de la chimio, mais reléguée à plus tard par l’équipe oncologique devant l’urgence du neuroblastome.
Une expérience romancée
10 ans après le diagnostic, Haya, aujourd’hui en sixième, se porte bien et n’a plus qu’un léger déficit de développement au pied droit. Son histoire est racontée par sa mère dans le touchant petit ouvrage Un voyage biospatiotemporel, édité à compte d'auteur.
Mais l’expérience de l’hôpital a laissé des traumatismes chez Estelle, qui a dû, un an après les premiers évènements, réarrêter son travail de pédospsychiatre. « Je n’arrivais plus à être empathique. C’était trop compliqué d’être parent d’enfant malade tout en s’occupant de parents d’enfants malades », explique-t-elle.
« Les parents, ce sont les premiers soignants : ils connaissent bien leurs enfants et ils voient bien quand il y a quelque chose d’inhabituel »
Le frère jumeau de Haya, parfois tenu à l’écart, a également été ébranlé par l’aventure. Il a d’ailleurs souffert de troubles du sommeil au cours des années qui ont suivi.
Côté strictement médical, Estelle porte un regard partagé sur son passage de l’autre côté du miroir. Elle vante à la fois la prise en charge « efficace » par l’hôpital public, tout en regrettant que son intuition de mère n’ait pas été toujours écoutée, à commencer par les premières consultations chez le pédiatre.
Avec le recul, elle nuance aujourd’hui. « En pédiatrie, on fait toujours face à des parents anxieux. Parfois, ce n’est pas facile de faire la différence ». Pour autant, ce sont eux « les premiers soignants : ils connaissent bien leurs enfants et ils voient bien quand il y a quelque chose d’inhabituel. Malgré tout, il est fréquent qu’ils ne soient pas écoutés ».
Car c’est bien cette sensation de ne pas être prise en compte qui a poussé Estelle à « transgresser » son rôle de parent, jusqu’à faire des hypothèses diagnostiques, qui se sont révélées en fin de compte « pas si éloignées de la vérité ».
Aujourd'hui mère de trois enfants, elle partage son exercice entre le libéral et l’hôpital en… pédopsychiatrie avec des adolescents. Comme quoi, « rien n’est figé dans la vie ».
A voir aussi
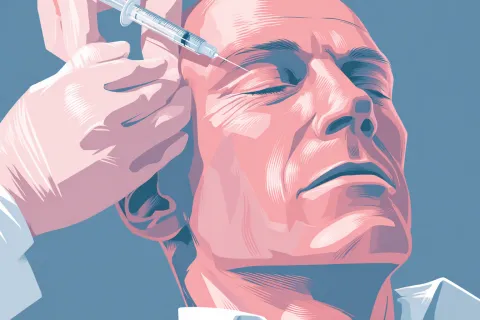
 Médecine esthétique : la patientèle masculine progresse plus vite que celle des femmes
Médecine esthétique : la patientèle masculine progresse plus vite que celle des femmes