
© IStock
"J'ai perdu définitivement l'odorat", témoigne auprès de l'AFP Anne Le Beuz, une patiente de 50 ans actuellement, dont les capacités olfactives n'ont pas survécu au retrait d'un méningiome en 2019.
Le risque pour un méningiome de devenir un handicap est démultiplié par un traitement, vendu par le laboratoire Bayer sous le nom Androcur. Anne Le Beuz l'a pris pendant six ans, comme pilule contraceptive et comme traitement anti-acné.
Ces indications ne sont pas officiellement prévues pour cette molécule anti-androgène, l'acétate de cyprotérone. Chez la femme, elle ne doit théoriquement être prescrite que contre une pilosité très excessive. Chez les hommes, l'usage, nettement plus rare, vise essentiellement à rendre plus supportables les cancers de la prostate.
Mais, dans les faits et particulièrement en France, les médecins ont pendant plusieurs décennies prescrit Androcur bien au-delà de ces limites, notamment pour répondre aux symptômes de pathologies féminines difficiles à traiter comme l'endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques.
Depuis quatre ans, la donne a changé. Actuellement, un peu plus de 5 000 femmes prennent Androcur, soit dix fois moins que début 2018, selon des chiffres relayés la semaine dernière par l’ANSM.
Que s'est-il passé ? Courant 2018, les autorités sanitaires ont pris la mesure du problème, à la faveur d'une vaste étude, et lancé une campagne en deux temps.
Elles ont averti les médecins du risque élevé de méningiome et leur ont demandé de faire passer des examens du cerveau à un grand nombre de patients sous Androcur. L'année suivante, elles ont adressé un courrier à tous ceux qui avaient récemment pris ce traitement.
Résultat : le nombre de cas de méningiomes s'est effondré. Avant 2018, une centaine de femmes était opérée par an à cause de tumeurs liées à Androcur. En 2021, elles étaient moins de dix.
Le risque de méningiome était multiplié par sept chez les patientes sous Androcur depuis plus de six mois, et par vingt au-delà de cinq ans
Pourquoi ne pas avoir agi avant, alors que d'importantes suspicions existaient depuis au moins 2009 ?
Pour les autorités sanitaires, qui imposaient à Bayer de mentionner le risque de méningiome dans les notices d'Androcur depuis le début des années 2010, il était impossible de mener une campagne efficace sans une étude aussi importante que celle publiée en 2018.
Celle-ci a montré que le risque de méningiome était multiplié par sept chez les patientes sous Androcur depuis plus de six mois, et par vingt au-delà de cinq ans.
Sans cette étude, "on n'aurait pas eu le recul nécessaire, on n'aurait pas montré ou trouvé tout ce qu'on a mis en évidence", a argumenté début décembre, lors d'une conférence de presse, Isabelle Yoldjian, directrice médicale de l'ANSM.
L'argument ne convainc pas les associations de patients et leurs avocats, qui, sans absoudre Bayer, tendent à d'abord renvoyer la responsabilité aux autorités sanitaires.
L'ANSM "a agi avec dix ans de retard, au moins", a jugé auprès de l'AFP l'avocat Charles Joseph-Oudin, qui accompagne une vingtaine de patientes dans des procédures judiciaires, notamment aux côtés d'une association, Amavea.
"Il fallait informer les médecins, de manière ciblée, de l'existence d'un risque dès l'émergence d'un signal", selon lui.
Que faut-il retenir : l'efficacité des actions ou leur caractère trop tardif ?
Cette ambivalence est sensible chez Anne Le Beuz, dont le méningiome a été diagnostiqué à la suite du courrier de l'ANSM en 2019.
"Je suis reconnaissante d'avoir été informée parce que, sinon, ce sont des symptômes plus graves qui m'auraient alertée", a-t-elle expliqué.
Mais il y aussi "la colère de la non-information, à la fois au niveau du laboratoire et de l'ANSM. Je me dis : « On aurait pu arrêter avant, ça aurait pu ne pas m'arriver »", a-t-elle ajouté, jugeant que le corps médical portait aussi une grande part de responsabilité.
Avec AFP
A voir aussi

 Sanofi a des problèmes aux États-Unis, accusé d'inciter les médecins à prescrire ses médicaments
Sanofi a des problèmes aux États-Unis, accusé d'inciter les médecins à prescrire ses médicaments

 Placebos sans mentir : faut-il dire à un patient qu’on lui prescrit un placebo ?
Placebos sans mentir : faut-il dire à un patient qu’on lui prescrit un placebo ?

 Asthme sévère et polypose naso-sinusienne : Feu vert européen pour la biothérapie longue durée de GSK
Asthme sévère et polypose naso-sinusienne : Feu vert européen pour la biothérapie longue durée de GSK

 « Un traitement exceptionnel et une première » : Un bébé atteint d'une tumeur vasculaire rare sauvé in utero
« Un traitement exceptionnel et une première » : Un bébé atteint d'une tumeur vasculaire rare sauvé in utero

 Changement monsieur l'arbitre ! Paul Hudson remplacé par Belén Garijo à la tête de Sanofi
Changement monsieur l'arbitre ! Paul Hudson remplacé par Belén Garijo à la tête de Sanofi

 Moderna critique la FDA après un refus d’examen de son vaccin antigrippal
Moderna critique la FDA après un refus d’examen de son vaccin antigrippal
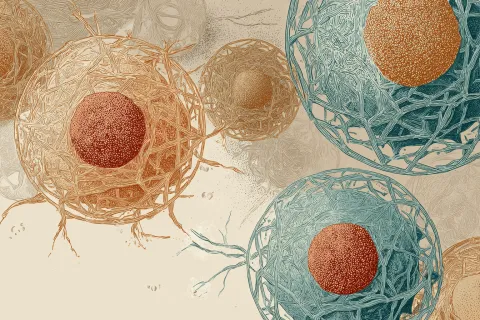
 Eli Lilly se renforce dans les thérapies cellulaires avec le rachat d’Orna Therapeutics
Eli Lilly se renforce dans les thérapies cellulaires avec le rachat d’Orna Therapeutics






