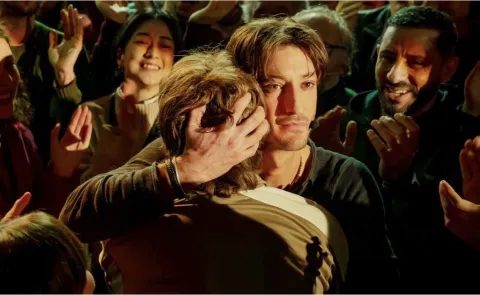Anthony Hopkins dans Freud, la dernière confession de Matt Brown.
© DR.
Mal fichu et très souvent imbitable, ce pudding anglais résiste à la détestation absolue, à l’image d’un Anthony Hopkins d’ores et déjà immortel et irrévocablement fascinant.
Les circonstances coïncidentes qui accompagnent la sortie d’un mauvais film peuvent, à défaut de le rendre meilleur, susciter une forme d’intérêt connexe. Ainsi en est-il de cette curieuse auscultation des derniers jours du père de la psychanalyse, qui finira par un geste euthanasique qui, en cette période de grand bon en avant passéiste entourant les débats sur l’aide à mourir, pourrait presque passer pour moderne, si l’on oubliait le fait que cette pratique a eu lieu de tout temps, hors de toute législation, par une médecine qui compensait son défaut de technicité et de résultats par une humanité instinctive. En résulte un film saturé de naphtaline et de morphine, cocktail suffisamment déroutant pour le sortir de l’affligeante insignifiance à laquelle d’autres ingrédients le destinaient.
Commençons par le plus déplaisant, et évacuons sans plus attendre la question du théâtre filmé, aspect qui n’est insupportable que parce que le fond l’est, cette incessante joute oratoire entre celui qui croyait au Ciel et celui qui n’y croyait pas, ampoulée d’une façon telle que, rapidement et globalement, l’on s’en contrefout. Mais aussi parce que le réalisateur refuse de trancher sur la forme, d’y aller à fond sur l’unité de temps et de lieu, ou de la transfigurer, comme Florian Zeller avait réussi à le faire dans The Father, illustre précédent d’Anthony Hopkins. Ainsi, en plus des scènes dialoguées interminables, a-t-on droit à des flash-backs qui les plombent au lieu de les éclairer. Au chapitre des coïncidences qui ne sont probablement pas plus que cela, on notera que le recours au rêve d’enfance du héros procède du même contenu que celui dont usait déjà Jean-Claude Barny dans Fanon, biopic d’un autre médecin révolutionnaire emporté par le cancer.
« L'interprétation d'Anthony Hopkins aurait pu faire date si le film avait été plus ambitieux et moins bondieusard »
En réalisant un total contresens dans la traduction du titre originel - la dernière séance de Freud devient sa dernière confession, terme relevant du lexique religieux s’il en est - les distributeurs ont précisément mis le doigt sur l’amalgame douteux sur lequel repose ce film-débat supposément neutre mais qui aimerait quand même faire passer l’idée que la religion c’est pas mal, que ça prémunit du narcissisme absolu - tiens donc -, celui qui rend inhumain envers ses enfants. Problème: en choisissant C.S. Lewis pour en remontrer à Freud, c’est un peu comme si le réalisateur filmait J.D. Vance en audience chez le pape François…
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/culture-sur-canape
Le film est finalement intrigant par ce qui le déborde, d’une façon très psychanalytique, au fond. Comment par exemple une prothèse de mâchoire devient un enjeu scénaristique - la verra-t-on, ne la verra-t-on pas? - c’est-à-dire qu’il se coltine la souffrance et la merde en général, jusqu’à faire de la tumeur contre laquelle le maître a combattu durant des années un étrange objet d’amour/haine, symbole de son obsession de contrôle et de l’inéluctabilité de son échec. Le film reste en revanche excessivement sage concernant l’homosexualité, sujette à polémique, d’Anna Freud.
Cette douleur physique finale, à laquelle un apaisement ultime, relativement bien amené pour le coup, décidera le savant à abdiquer sa Lebentrieb, ce combat contre la mort plus que contre Dieu, sont magnifiquement incarnés par Anthony Hopkins, dont l’interprétation aurait pu faire date si le film avait été plus ambitieux et moins bondieusard. Sa façon d’éructer en boucle sur les grands principes comme sur les aspects les plus triviaux de la vie qui l’abandonne, c’est aussi celle du vieux lion élisabéthain qu’il personnifie de plus en plus, aussi puissante qu’émouvante. Il préfigure la trace qu’il laissera dans l’histoire du cinéma, comme Freud dans celle des grandes idées.