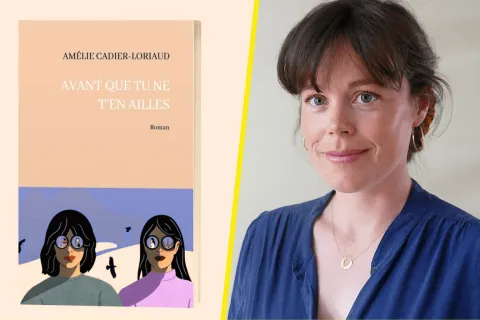© DR
What’s up Doc : Comment en vient-on à exercer dans autant de disciplines différentes ?
Thierry Durantel : D’abord par passion. C’est parce que je suis sportif depuis jeune que je me suis orienté vers ce métier. En tant que judoka, j’ai très vite voulu allier le sport, notamment le judo, et la médecine. Comme j’étais à l’INSEP (institut national du sport, de l’expertise et de la performance), j’ai rencontré des médecins qui m’ont orienté dans mon choix de carrière. Dès le début de mon internat, je suis rentré à la fédération française de judo, puis celle du tennis, et enfin celle des sports de glace, où j’ai pu intervenir sur des compétitions ou auprès des équipes de France. Je me suis aussi occupé de quelques clubs de rugby de la région parisienne.
Ça c’était à Paris, mais vous vous êtes installé plus tard au Pays Basque…
TD. : Comme les portes étaient relativement bouchées à l’Insep, et que la vie parisienne ne me convenait plus trop, j’ai voulu découvrir d’autres horizons. En prospectant, notamment au moment de l’ouverture du centre européen de rééducation du sport (CERS) à Capbreton (Landes), j’ai eu l’occasion de me projeter au Pays Basque, que je connaissais de mon enfance. J’y ai rencontré une population très axée vers le sport, avec des joggeurs partout et des surfeurs à l’eau, quelle que soit l’heure de la journée, ce qui m’a bien plu. Je m’y suis donc installé au début des années 90, pour de nouvelles aventures.
Là-bas, je me suis d’abord occupé du club de hockey sur glace, en parallèle de mon activité au cabinet. Puis, je suis rentré à l’Anglet Olympique Rugby, mon club de cœur, et, pendant quelque temps, à l'Aviron bayonnais rugby pro, ainsi qu'à l'élite pro de la pelote basque à main nue, sport typique du Pays Basque.
En 2008, on m’a proposé de m’occuper des équipes de France juniors de judo, puis peu après, de la fédération française de surf, et enfin des Espoirs du centre de formation du Biarritz Olympique Rugby, ce que je fais toujours actuellement. Ça fait beaucoup !
Quelles sont les spécificités de la médecine de surf ?
TD. : Il n’y a pas beaucoup de pathologies. Les principales blessures sont des coupures et blessures cutanées, dues au contact avec la planche ou le fond marin. Dans la pratique, il y a un faible pourcentage de blessures sévères, notamment des membres inférieurs, voire du rachis ; et un très minime pourcentage, mais malgré tout jamais nul, de décès, que ce soit par plaies ou par perte de connaissance.
« Mes patients ont l’impression que je ne suis jamais là, mais je passe quand même plus de temps au cabinet qu’à l’extérieur »
Vous avez aussi été membre de la commission médicale de la fédération internationale de surf, en quoi ça consiste ?
TD. : C’était un rôle principalement consultatif, pour les préparations de compétitions internationales, en fonction des régions et de leurs spécificités - notamment en termes de risques sanitaires dans les régions tropicales. J’en ai démissionné début 2024, avant les JO de Paris, car j’estime ne pas parler suffisamment bien anglais pour être le plus efficace possible, et parce que je préfère m’occuper des équipes de France sur les compétitions.
Quel est le sport que vous prenez le plus de plaisir à médicaliser ?
TD. : Tous ont leurs particularités ! Celui dans lequel j’ai le moins de stress, c’est le surf, qui est à la base une activité de loisirs. Le judo restera mon sport de cœur, car je suis un pratiquant de longue date. Rester dans ce milieu, c’est du bonheur. Je prends aussi beaucoup de plaisir dans le rugby, où les échanges avec les sportifs sont très riches. Ces deux sports sont également les plus
pourvoyeurs de blessures, étant tous deux des sports d'impact et de contact.
On imagine que vous devez beaucoup vous déplacer…
TD. : Mes patients ont parfois l’impression que je ne suis jamais là (rires), mais je passe quand même plus de temps au cabinet qu’à l’extérieur. Je suis souvent en déplacement le week-end, pour les compétitions de judo et de rugby. Et je pars parfois pendant plusieurs jours ou semaines pour les compétitions internationales, qui sont, en fin de compte assez peu fréquentes. Mais depuis peu, je couvre aussi les compétitions de golf.
« On a de plus en plus d’obligations médico-juridiques qui nous brident dans ce que l’on pourrait faire sur le champ »
Il y a vraiment des risques de blessure dans le golf ?
TD. : Bonne question…. À priori, ce sont plutôt des tendinites et des blessures cutanées liées aux insectes ou à l’exposition au soleil. Pour l’instant, je n’ai pas été exposé à grand-chose. Dans ce genre de sport, comme en tennis ou en pelote basque, le plus courant c’est des pathologies de surcharge musculaire et tendineuse, souvent liées à la répétition des gestes.
Quelle sont les qualités requises pour être un médecin du sport bon et polyvalent ?
TD. : Dans la médecine du sport dite d’accompagnement, il faut avant tout être un bon médecin généraliste et bien connaître les maladies du tout-venant et leurs traitements. Cela relève de la médecine « standard », mais il faut savoir la maitriser lorsqu’on est à l’autre bout du monde.
Pour ce qui est de la médecine de terrain, il faut oser à imposer son point de vue et à prendre ses responsabilités, car on est parfois confronté au scepticisme des sportifs, du staff et des organisations. C'est le cas, par exemple, lorsqu’il faut réduire une luxation. Certains insistent pour courir aux urgences, quitte à attendre longtemps, alors qu’on peut tout de suite soulager l’athlète. De temps en temps, on joue un peu avec notre carrière, car il y a plus en plus d’obligations médico-juridiques qui nous brident dans ce que l’on pourrait faire sur le champ. Cela me semble très castrateur, déjà pour le médecin, mais aussi pour le patient-athlète.
En somme, dans ce métier, il y a parfois du stress, mais le plaisir et la satisfaction prennent toujours le dessus. Et côtoyer tous ces sportifs est particulièrement plaisant !
A voir aussi

 Médecins en campagne : ces praticiens qui briguent une mairie aux municipales 2026
Médecins en campagne : ces praticiens qui briguent une mairie aux municipales 2026