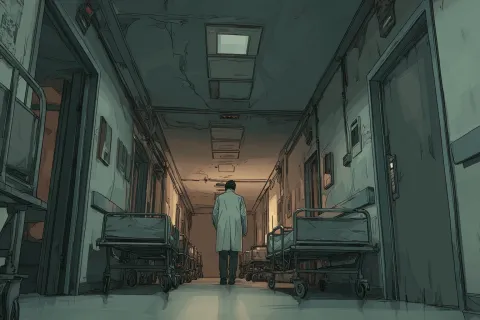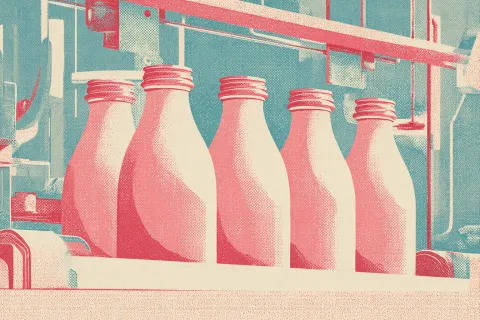Robert F. Kennedy, ministre de la santé aux USA.
© Capture USA Today
J+10 et les craintes se poursuivent. Le nouveau président des États-Unis, qui poursuit la constitution de son administration, a désigné jeudi « RFK » à la tête de la Santé, une des thématiques phares de sa campagne.
Peu avant son élection, Donald Trump avait annoncé que l’ancien démocrate jouerait « un rôle important dans la santé » au sein de son futur gouvernement.
Crédité de quelque 5% des intentions de votes, l’ancien démocrate, alors candidat à la Maison Blanche avait annoncé fin août suspendre sa candidature, pour apporter son soutien au milliardaire.
Depuis, « il est resté dans le sillage de Donald Trump et s’est positionné comme interlocuteur supposément compétent sur les questions de santé », et ce « alors qu’il n’a pas une grande crédibilité scientifique », explique Élisabeth Fauquert, maîtresse de conférence à l’université Paris Nanterre et spécialiste de l’histoire sociale des États-Unis.
Et pour cause, le neveu du président assassiné Kennedy a assumé des positions ouvertement vaccino-sceptiques, allant jusqu’à affirmer que « les vaccins jouent un rôle dans les maladies chroniques », s’attirant ainsi les foudres d’une partie du clan Kennedy. « On est quand même sur une personne qui est proche des théories du complot », insiste Élisabeth Fauquert.
Pour paraître moins clivant, l’intéressé a soutenu en interviews ces derniers jours qu'il « ne retirerait les vaccins de personne », tout en faisant en sorte que « les Américains soient bien informés » sur la question.
En réaction à sa nomination, il a déclaré sur le réseau social X qu’ « ensemble, nous allons mettre un terme à la corruption, mettre un terme aux échanges entre l’industrie et le gouvernement et ramener nos agences de santé à leur riche tradition de référence scientifique fondée sur des preuves ».
« Je fournirai aux Américains la transparence et l’accès à toutes les données afin qu’ils puissent faire des choix éclairés pour eux-mêmes et leurs familles », a-t-il poursuivi.
« Faites vos cartons » : un coup de pied dans le système de santé
En tout cas, la nomination de « RFK » constitue un point de bascule considérable. La nouvelle administration Trump sera vraisemblablement plus ouverte à des théories non-prouvées, notamment sur la question des vaccins, « déjà que la première administration n’était pas le fer de lance de la santé publique, au sens où on l’entend en France », rappelle Elisabeth Fauquert.
De manière générale, la politique de santé entrevue par le président Trump s’articule autour d’une défiance, quasi-conspirationniste, envers les agences de santé publique, notamment la Food and Drug Administration (FDA, l’agence de santé publique chargée de la surveillance des produits alimentaires et des médicaments).
Derrière le « Maha » (Make America Healthy Again, slogan santé de la campagne de Donald Trump) fièrement scandé, « il y a l’idée que l’État fédéral cautionne un système dangereux en termes de nutrition », explique Élisabeth Fauquert.
Le « problème », c’est que le nouveau président laisse entendre que les fonctionnaires de carrière dans les agences publiques seraient liés au « deep state » (littéralement, l’État profond, une instance informelle qui détiendrait le véritable pouvoir décisionnaire).
« S’il est vrai que l’État subventionne certains secteurs mortifères à différents points de vue, là où c’est dangereux, c’est que Donald Trump s’en sert pour en faire une croisade politique et idéologique contre les services publics », précise l’universitaire.
Le milliardaire souhaite ainsi « faire le ménage » et remplacer ces fonctionnaires de carrière par des politiciens nommés personnellement par lui-même, donc « plus politisés et partisans ».
Un objectif assumé, illustré par les récents propos de RFK lancés aux employés de la FDA : « gardez vos archives et faites vos cartons ».
« Tout cela forme un écosystème très dangereux pour un système de santé qui a déjà du mal à fonctionner pour tous », reprend Élisabeth Fauquert, qui a écrit une thèse sur l’assurance maladie aux États-Unis.
La vraie fin de l’Obamacare ?
Lors de son premier mandat, le camp Trump avait échoué à démanteler l’Affordable Care Act, dit Obamacare.
Cette loi emblématique du mandat de Barack Obama oblige tous les citoyens à souscrire à une assurance santé auprès d’un assureur privé, en contrepartie de quoi l’État fournit une aide financière, sous forme de crédits d’impôts.
Les citoyens les plus pauvres bénéficient, eux, du Medicaid, une sorte de couverture universelle qui s’applique également aux séniors.
Cette fois-ci, le président veut « s’attaquer indirectement aux crédits d’impôts, non pas en les retirant, mais en ne faisant rien législativement pour les renouveler », alors même qu’ils doivent expirer l’année prochaine.
Ne pas agir sur cette expiration, qui « permet de maintenir des primes d’assurance de l’Obamacare à un faible niveau », fera « flamber » les prix de l’assurance pour des millions de personnes qui peinent déjà à s’assurer pour des raisons financières, pointe Élisabeth Fauquert.
En 2022, environ 26 millions de personnes demeuraient sans couverture santé dans le pays.
L’autre point concerne le retour à une division en différents groupes des assurés sociaux, en fonction des risques. Une vision qui dominait avant l’Obamacare, et qui est promue par le vice-président élu J.D Vance.
Le problème, selon la chercheuse, « c’est que ça irait complètement à l’encontre de l’Obamacare qui, pour le coup, avait créé un droit à l’assurance maladie que l’assureur ne puisse pas refuser, indépendamment des pathologies préexistantes ». Une disposition d’ailleurs très populaire chez les Américains.
Grosso modo, les jeunes, population moins à risque, paieraient moins cher, mais les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques, « verraient, eux, leur coût grimper en flèche ».
« Ça crée des inégalités à l’intérieur d’un système qui était un peu mieux sur le plan de l’accès à l’assurance maladie », regrette l'universitaire.
Enfin, l’administration Trump souhaite instaurer la subvention de politiques d’assurance maladie à court-terme, « donc pas forcément au moment où les gens ont un besoin ». Des subventions qui seraient d’ailleurs « moins généreuses » et qui n’auraient pas « vocation à couvrir tout ce qui est requis par les plans Obamacare », notamment en matière de soins préventifs et de médicaments sur ordonnance.
Menace sur les droits reproductifs
Accusé par les démocrates d’être « l’architecte » du recul des droits reproductifs lors de sa dernière mandature, Donald Trump a maintenu une position prudente sur le sujet au cours de sa campagne, au point parfois de s’attirer les foudres des franges les plus conservatrices de son parti.
Il a martelé vouloir s’en remettre à la volonté des États, comme prévu par l’abrogation de l’arrêt emblématique Roe v. Wade en juin 2022 par la Cour suprême. Celui-ci garantissait depuis 1973 le droit d’avorter sur tout le territoire.
Pourtant, l’accès à l’IVG pourrait se restreindre de manière plus insidieuse, selon Élisabeth Fauquert. Une FDA vidée de ses fonctionnaires et remplacée par des agents très conservateurs « pourrait réviser les directives qui autorisent l’envoi par courrier de la mifépristone », la pilule abortive la plus utilisée dans le pays.
Ce dispositif permet aux femmes qui souhaitent avoir recours à une IVG médicamenteuse, de contourner les lois restrictives en matière d’IVG dans la dizaine d’États concernés aujourd’hui.
Concrètement, « les conservateurs veulent contester la légalité de l’envoi par courrier de la pilule abortive », notamment « en ressuscitant le Comstock act », une loi relative à l’interdiction de la diffusion de matériel et information dits « obscène », parmi lesquels l’avortement, datant de… 1873.
En anticipation, la demande de médicaments abortifs a explosé depuis une semaine, selon le Washington Post. Aid Access, grand fournisseur de pilules abortives, a déclaré 10 000 demandes de médicaments dans les 24 heures qui ont suivi l’annonce des résultats.
La communauté trans tremble
Enfin, la présidence Trump pourrait marquer une diminution dangereuse des droits, y compris médicaux, des personnes transgenres, cible régulière du Républicain depuis des années.
Le nouveau président s’est en effet engagé à interdire le financement à l’échelle fédérale des opérations de réassignation des personnes trans.
« Dès les premiers jours de son investiture, il compte publier un décret présidentiel (executive order) qui ordonnerait aux agences fédérales de mettre fin aux programmes qui promeuvent le « concept » de transition de genre à tout âge », note Elisabeth Fauquert.
Un sujet qui colle aussi à l’agenda de la Cour Suprême, qui doit trancher prochainement sur la légalité ou non, d’une loi adoptée par l’État du Tennessee, qui interdit les soins d’affirmation du genre pour les mineurs trans.
Pour ce qui est de la pratique globale des médecins, « il est difficile d’anticiper à l’heure actuelle » d’éventuels changements, conclut Élisabeth Fauquert, avec précaution.
On peut toutefois imaginer des incidences sur les capacités de prescriptions en cas de restructuration des agences sanitaires publiques.
Mais la nomination de RFK ne va sans doute pas faciliter les choses : « ça risque d’être autorité contre autorité », anticipe l’universitaire.
A voir aussi