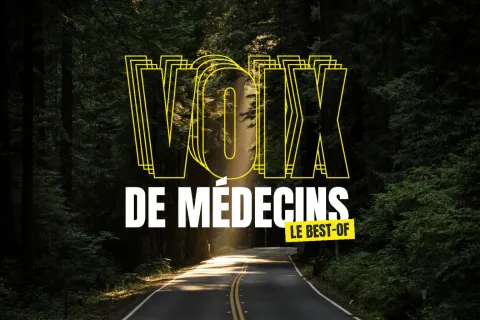Éléonore Conradt avec son livre Sur la peau, prix du polar non publié 2023 © DR
Ce livre n’aurait jamais dû sortir. Et pourtant, Éléonore Conradt, 25 ans, est bien la 3ème lauréate de ce prix, instauré il y a quelques années par la maison d’édition indépendante Novice.
Sur la peau raconte l’enquête policière autour du curieux meurtre d’un homme, dont le corps est retrouvé dans un salon de tatouage parisien. Un thriller énigmatique qui octroie à la médecine légale une place toute particulière.
Le roman s’est déjà vendu à près d'un millier d’exemplaires, selon l’éditeur.
What’s up Doc : Raconte-nous comment tu as reçu ce prix ?
Éléonore Conradt : L’écriture a toujours eu une place dans ma vie, c’est une échappatoire depuis longtemps. J’ai commencé par des petites histoires sur des blogs et me suis très vite orientée vers des fan-fictions, jusqu’à obtenir une toute petite audience. Malheureusement, avec mes études de médecine, je n’avais plus trop le temps de publier. En 2021, après une période compliquée, je me penche sur l’écriture de ce roman. C’est entre deux révisions de l’ECN que je découvre l’existence du prix du polar non-publié. Je décide de m’accorder une pause, et d’y candidater.
À quelques jours du concours, on m’apprend que j’ai été sélectionnée et que je dois désormais retravailler le livre pour l’édition. Heureusement, l’éditeur a été compréhensif et on s’est mis d’accord pour s’y consacrer une fois le concours terminé. C’est comme ça que mon « petit bébé » est arrivé, en même temps que le début de l’internat !
L’intrigue donne une place importante au médecin légiste, et tu ne lésines pas sur l’utilisation de termes médicaux ; c’était important d’imprégner ton histoire de ton expérience médicale ?
EC : Oui et non. Non car, comme je l’ai dit, l’écriture m’a permis de m’évader pendant mes révisions, particulièrement pendant le confinement où je n’avais pas le moral. Je ne voulais donc pas que l’histoire me rappelle trop la médecine. Mais en même temps, c’est le domaine que je connais. Je me voyais mal mettre en scène un banquier avec des problèmes de finances hyper pointus. Je savais qu’en parlant de médecine, je pouvais être fiable dans ce que je racontais, contrairement à certaines séries qui ne sont pas très réalistes.
« À quel moment on passe du réel à la fiction ? Et que faire si dans la fiction, un patient se reconnaît ? »
C’est une patte qui pourrait revenir dans de futurs romans ?
EC : Disons que j’ai une idée pour un futur roman dans lequel le héros serait médecin. Le problème, c’est que j’ai peur de croiser un jour un patient qui souffre de la maladie dont j’aimerais parler. Il y a toujours ce problème de secret médical qui entre en jeu : à quel moment on passe du réel à la fiction ? Et que faire si dans la fiction, un patient se reconnaît ?
Mais tu peux partir d’une expérience vécue avec un patient et l’adapter ensuite en fiction, non ?
EC : Oui, j’en ai déjà parlé avec des collègues qui m’ont dit qu’il était très peu probable que l’histoire que j’ai en tête se produise un jour. Mais je dois dire que ça me travaille quand même beaucoup. Le secret médical, c’est la base de la confiance entre le médecin et le malade, j’y tiens beaucoup.
La situation initiale de Sur la peau est un meurtre dans un salon de tatouage. Pourquoi ce choix particulier ?
EC : L’idée m’est venue simplement avec l’acteur Philippe Bas, un acteur très tatoué qui incarne un commandant de police dans la série Profilage. Je me suis toujours demandé pourquoi ses tatouages n’étaient pas utilisés comme ressort scénaristique dans la série, comme dans les autres films dans lesquels il a joué.
Moi-même, je ne suis pas tatouée, mais c’est quelque chose qui me fascine beaucoup d’un point de vue sociologique et ethnologique.
« Professionnellement, comme pour l’écriture, j’opte pour le calme, le silence et le petit coin de verdure »
Pas non plus de lien avec une potentielle appétence pour la dermatologie ?
EC : Non, j’ai longtemps hésité entre la médecine générale, l’ophtalmologie et la médecine légale. Mais dès mon stage en D2 chez le généraliste, je me suis rendue compte que c’était un exercice fait pour moi. Le contact humain, la diversité des pathologies et des prises en charge, l’absence de redondance ont fait que je n’ai pas hésité longtemps.
C’est quoi le mieux pour l’inspiration : le rythme effréné de l’hôpital ou un cabinet rural près d’un coin de verdure ?
EC : En libéral à la campagne à 100 % ! Pour te dire : je me suis infligée près d’1h30 de trajet aller-retour pour me rendre à mon terrain de stage actuel, car je voulais absolument voir du rural. Alors que mon classement m’aurait permis sans problème un stage en centre-ville. Professionnellement, comme pour l’écriture, j’opte pour le calme, le silence et le petit coin de verdure (rires).
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/de-medecin-ecrivain-le-dr-jean-jacques-erbstein-se-livre
En tout cas, tu pars avec un avantage pour la rédaction de la thèse…
EC : Absolument pas ! C’est totalement différent : d’un côté, on a un exercice très créatif et de l'autre, un exercice très réflexif. Dans la forme, c'est peut-être plus facile pour moi de formuler les choses, mais dans le fond, je serai jugée sur mon travail de recherche. Je ne crois pas que la qualité rédactionnelle soit prise en compte dans le barème. En revanche, pour le RSCA (récit de situation complexe authentique, où l’interne présente une situation détaillée qu’il a vécue, ndlr), dans lequel il y a un vrai travail de rédaction, ma tutrice m’a dit que ça se voyait que je savais raconter.
A voir aussi

 Régionaliser les places d'internes en médecine : une solution face à la désertification, une nouvelle réforme du concours ?
Régionaliser les places d'internes en médecine : une solution face à la désertification, une nouvelle réforme du concours ?
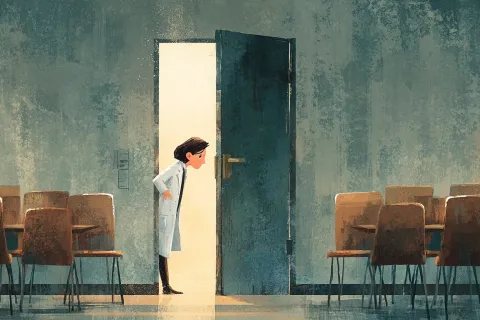
 Quatrième année d'internat de médecine générale : la réforme patine, les internes décrochent
Quatrième année d'internat de médecine générale : la réforme patine, les internes décrochent

 Classement des groupes de spécialités 2026 : quel groupe est le plus sélectif ? Et le moins ?
Classement des groupes de spécialités 2026 : quel groupe est le plus sélectif ? Et le moins ?

 En 2025, ils nous ont partagé leur expérience heureuse (ou pas) de jeunes médecins
En 2025, ils nous ont partagé leur expérience heureuse (ou pas) de jeunes médecins