
Après avoir participé au projet transmédia Impunité zéro, sur les violences sexuelles en temps de guerre, la journaliste Cécile Andrzejewski s’en penchée sur les couloirs obscurs de l’hôpital. Et ce qu’elle y découvre n’est guère reluisant. Dans son ouvrage Silence sous la blouse, Anne-Lise, Justine, Laurie, Besma, Sonia, Jessica ou Lina lui ont confié leur histoire. Elles sont infirmières souvent, technicienne de laboratoire mais aussi interne en chirurgie, neurologue ou agent des services hospitaliers. Toutes ont été harcelées verbalement et parfois agressées physiquement par un collègue, le plus souvent un médecin, puis mises au ban de leur équipe, non soutenues par leur hiérarchie, changées de services pour « leur protection ». Beaucoup sont passées par la case dépression, quelques-unes sont allées jusqu’en justice, sans toujours obtenir la condamnation réparatrice. « On peut tout perdre parce qu’on a été victime, explique l’une d’elles. Et ce n’est pas la bonne personne qui est punie. Ce qui ressort de tout ça, ce ne sont même plus les faits en eux-mêmes, mais l’injustice qui nous ronge. » Leurs témoignages sont enrichis par les analyses de chercheurs, de syndicalistes, d’avocats, de doyens de faculté, de professionnels de santé. L’auteur décrit le poids de la hiérarchie hospitalière, l’officielle et l’officieuse. Elle a même passé une matinée au bloc pour y saisir l’ambiance et profiter des blagues graveleuses du chirurgien, qui avait pourtant autorisé sa présence. Un ouvrage nécessaire mais dont la lecture révolte presque à chaque page.
What's Up Doc. Les violences envers les femmes ont lieu dans tous les environnements professionnels écrivez-vous, mais peut-être encore plus dans les établissements de santé. Comment expliquez-vous cela ?
Cécile Andrzejewski. Il y a plusieurs choses. D’une part, l’idée préconçue selon laquelle l’hôpital est un environnement extrêmement féminin qui protège les femmes. Mais en regardant la distribution des postes, on constate que le pouvoir reste aux mains des hommes. Les PU-PH, les chirurgiens, les chefs de service, les présidents de CME et même au niveau administratif, les directeurs d'hôpital, malgré la féminisation de ces corps professionnels, sont très majoritairement des hommes. Et comme tout lieu où les hommes sont en position de force, l’hôpital devient un lieu de domination masculine sur les corps féminins. S’ajoute à cela la culture carabine, marquée par un certain sexisme (des fameuses fresques porno dans les salles de gardes, aux blagues et aux bizutages des week-ens d’intégration). Les études de médecine ont lieu dans un climat de violence, très concurrentiel. Il y a bien sûr la mort, la maladie, la confrontation au corps qui se dégrade, toutes ces choses qu’on évite de ramener à la maison et qui génèrent une culture de la relativisation : « Je ne peux pas me plaindre, je suis en bonne santé. » Et puis il y a les conditions de travail de plus en plus difficiles en établissement aujourd’hui. Tout ce cocktail rend la situation explosive.
A-t-on une idée de la prévalence de ces situations ?
C.A. Je n’ai pas trouvé de chiffres pour l’instant en France. Dans la littérature internationale, entre la fin des années 80 et le début des années 2000, 66 % des infirmières britanniques, 76 % des Américaines et 63 % des Turques ont été victimes de harcèlement sexuel. Elles seraient même 91 % selon une étude portant sur les infirmières et étudiantes en Israël. Mais c’est très compliqué à évaluer. Déjà parce qu’assez peu de gens savent définir précisément une agression ou un harcèlement sexuel. Ensuite, parce que les déclarations sont minorées par la culture de relativisation et une forme d’omerta. Il n’y a toujours pas de prise de conscience. On ne veut pas voir le problème et donc on n’enquête pas.
Elles seraient même 91 % selon une étude portant sur les infirmières et étudiantes en Israël
Dans cette enquête vous évoquez un mécanisme commun à toutes les situations de violences mises à jour. De quoi s’agit-il ?
C.A. À force de compiler récits et témoignages, en effet, des points communs sont apparus. Toutes ces femmes qui m’ont parlé, quel que soit leur poste, le type d’établissement dans lequel elles travaillent, une fois agressées ou harcelées, et après qu’elles commencent à prendre la parole, découvrent qu’elles ne sont pas les seules ni les premières à être victimes de tel médecin ou chirurgien. Que jusqu’à présent les autres n’avaient pas osé parler. Que le harceleur était connu pour agir ainsi sans que les faits soient précisément qualifiés. On va dire que c’est un “caractériel”, qu’il est “bourru”, qu’il faut se méfier de lui.…Et puis une fois les faits connus, tout sera fait pour extraire les femmes du service… sans sanctionner le médecin. La hiérarchie va tenter d’enterrer l’histoire. C’est la double peine pour la victime. Marylin Baldeck, secrétaire générale de l’AVFT (Association européenne contre violences faites aux femmes au travail) le dit bien : “Être agressée c’est une chose. Mais que les institutions ne protègent pas, c’est le signe qu’il est possible de violenter de manière industrielle. Là, on découvre qu’on est dans un système.” »
Une fois les faits connus, tout sera fait pour extraire les femmes du service… sans sanctionner le médecin
Vous avez cherché à contacter des hommes accusés, voire condamnés. Que vouliez-vous entendre de leur part ?
C.A. J’aurais voulu qu’ils m’expliquent ce qui s’était passé. En tant que journaliste, je me devais de donner la parole à chacun. Aucun ne m’a accordé d’entretien. Ceux qui sont passés au tribunal ont évoqué un « complot », que ce soit en réponse à mes demandes de rendez-vous ou au cours de leur procès. Et donc ils ne veulent plus parler. Tous évoquent la culture carabine. « C’est comme ça à l’hôpital. » C’est intéressant d’entendre comment ils se défendent. Ils considèrent que des attouchements, par exemple, c’est une sorte de normalité. Je ne sais pas s’ils ont conscience que ce qu’ils font est répréhensible pénalement. J’ai également cherché à contacter les directions d’hôpitaux. Je voulais qu’elles me disent pourquoi à chaque fois qu'il y a agression, c’est la femme qui doit partir, quitter son poste, son service, son établissement. Là non plus je n’ai obtenu aucune réponse. À mon niveau aussi, je me suis retrouvée face à un mur.
Le coupable n’est pas toujours un supérieur hiérarchique comme le montre le premier témoignage de votre livre…
C.A. Plus l’agresseur monte dans la hiérarchie, plus il est protégé. Mais même quand c’est un simple collègue, tout est fait aussi pour étouffer l'affaire. Anne-Lise, technicienne de laboratoire, s’est retrouvée confrontée à une violence inouïe. Après une tentative de viol par un collègue dans les vestiaires, elle perd le bébé qu’elle attendait, ne dit rien. Lorsqu’elle se décide à en parler à sa hiérarchie, on lui rit au nez. Son humeur se dégrade et ses relations avec ses collègues en pâtissent, elle est mal notée. Elle doit s’expliquer et raconter ce qui lui est arrivé à plusieurs reprises. Son agresseur écopera d’un simple avertissement. Lorsqu’elle porte plainte devant la justice, sa plainte est classée et au final c’est elle qui doit quitter son poste et même, finalement la profession…
Ceux qui sont passés au tribunal ont évoqué un “complot”
Vous évoquez l’article 40 du Code pénal et le manque de protection de l’institution …?
C.A. Oui, car « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions a connaissance de crimes ou délits est tenue d’en donner avis sans délai au procureur de la République ». C’est rarement fait. Je pense que des victimes pourraient poursuivre l’hôpital dans lequel elles travaillent pour ne pas les avoir protégées. Dans l’affaire d’Arras, où un médecin du travail est jugé [il sera condamné en appel à un an de prison ferme et à l’interdiction d’exercer, NDLR] on entend d’ailleurs très bien comment la vice-procureure tance l’établissement pendant les réquisitions, parce qu’elle a été prévenue tardivement, qu’elle a eu du mal à se faire communiquer le dossier, etc.
Les mouvements #MeToo et #BalanceTonPorc ont-il aidé votre enquête ?
C.A. C’est difficile à dire, car j’ai commencé quelques mois avant #MeToo. Je pensais que ça libérerait la parole. D’autant que les histoires dont je parle sont anciennes mais je n’ai pas l’impression pour l’instant que cela ait vraiment changé.
1- Silence sous la blouse. Cécile Andrzejewski. Éditions Fayard.
A voir aussi

 68 021 décès prématurés liés au tabagisme en 2023, malgré un léger recul
68 021 décès prématurés liés au tabagisme en 2023, malgré un léger recul

 SONDAGE : Excellence en santé : ce que les médecins jugent possible aujourd’hui… pour toutes les générations
SONDAGE : Excellence en santé : ce que les médecins jugent possible aujourd’hui… pour toutes les générations

 Neuf cas de mpox recensés à Mayotte mais la situation reste « peu inquiétante » selon l'ARS
Neuf cas de mpox recensés à Mayotte mais la situation reste « peu inquiétante » selon l'ARS

 Le Chateau Sourire, un lieu pensé pour que les enfants atteints du cancer restent des enfants
Le Chateau Sourire, un lieu pensé pour que les enfants atteints du cancer restent des enfants
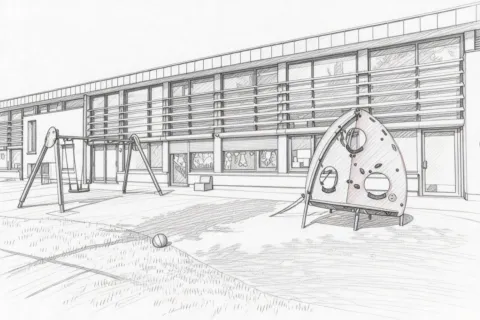
 Des enfants enfermés et maltraités en pédopsychiatrie : l’hôpital de la Fondation Vallée sous inspection de l’ARS
Des enfants enfermés et maltraités en pédopsychiatrie : l’hôpital de la Fondation Vallée sous inspection de l’ARS

 Incendie de Crans-Montana : quand une bactérie multirésistante complique la prise en charge des grands brûlés
Incendie de Crans-Montana : quand une bactérie multirésistante complique la prise en charge des grands brûlés

 Naturopathie, jeûne, compléments alimentaires... Quand les malades du cancer pensent s'aider pour le pire
Naturopathie, jeûne, compléments alimentaires... Quand les malades du cancer pensent s'aider pour le pire

 Qualité des soins en 2025 : les 10 chiffres que le système hospitalier ne peut plus ignorer
Qualité des soins en 2025 : les 10 chiffres que le système hospitalier ne peut plus ignorer





