
Lorsque l’on pense « démence précoce », autrement dit problèmes de mémoire avant 65 ans, les premiers mots qui viennent à l’esprit sont généralement « maladie d’Alzheimer ». Pourtant, dans les pays occidentaux, la première cause de démence avant 65 ans est… l’alcool. Ce fait, peu connu du grand public, est aussi ignoré par de nombreux professionnels de santé.
Parmi les troubles cognitifs causés par l’alcool figure le syndrome de Korsakoff. Cette affection sévère, chronique et irréversible résulte de la combinaison de deux mécanismes : la toxicité directe de l’alcool pour les neurones et, surtout, la carence en thiamine (vitamine B1).
Alors que les carences en thiamine sont faciles à diagnostiquer et à prévenir, elles restent pourtant massivement négligées, ce qui condamne des milliers de patients.
Alcool et démence
Les résultats de divers travaux de recherche indiquent que consommation excessive d’alcool et risque de démence sont étroitement liés.
En France, une étude menée sur une vaste cohorte nationale comportant plus de 57 000 cas de démence précoce a révélé qu’environ 60 % des cas survenus avant 65 ans étaient liés à l’alcool.
Les résultats d’une autre étude, menée en Finlande, indiquent quant à eux que le trouble de l’usage de l’alcool multiplie par environ 5,7 le risque de démence précoce chez les hommes et par 6,1 chez les femmes. Une autre revue de littérature scientifique récente indique également que la consommation excessive d’alcool est responsable de 8 % des nouveaux cas de démence chez les hommes de 45 à 64 ans.
Enfin, selon l’organisme caritatif britannique Alzheimer’s Society, environ une personne sur huit atteinte de démence précoce souffre de troubles cognitifs liés à l’alcool, fréquemment diagnostiqués entre 40 et 50 ans.
Les déficits cognitifs liés à l’alcool s’inscrivent dans un continuum allant de ceux liés au « binge drinking », à ceux liés au trouble de l’usage d’alcool, jusqu’au terrible syndrome de Korsakoff, qui détruit irréversiblement la mémoire des patients.
Pertes de mémoire et confusion
Les patients atteints par le syndrome de Korsakoff souffrent de graves troubles de la mémoire.
Leurs souvenirs d’avant la maladie disparaissent (on parle d’« amnésie rétrograde »), et ils sont également incapables d’en fabriquer de nouveaux (« amnésie antérograde »). Souvent, ces trous sont meublés par de faux souvenirs, des fabulations qui permettent aux patients de donner le change, ainsi que par de fausses reconnaissances.
Ce syndrome se traduit également par une perte de repères temporels et spatiaux : les malades ont des difficultés à se situer dans le temps et dans l’espace. Ils deviennent, par exemple, incapables de se souvenir du chemin qu’ils empruntaient pour aller faire leurs courses hebdomadaires.
Ils souffrent aussi de problèmes d’équilibre et de difficultés à marcher, en raison de troubles de la coordination des mouvements (« ataxie ») et de problèmes oculaires se traduisant par des mouvements incontrôlés des yeux.
Les personnes atteintes du syndrome de Korsakoff sont également atteintes d’« anosognosie » : elles sont incapables de prendre conscience d’un ou plusieurs de leurs propres déficits. Enfin, elles peuvent présenter des troubles du comportement.
Le syndrome de Korsakoff se développe généralement à la suite d’une autre affection, l’encéphalopathie de Gayet-Wernicke. Si cette phase aiguë est traitée rapidement, son évolution peut être favorable. Malheureusement, jusqu’à 80 % des personnes atteintes par une encéphalopathie de Gayet-Wernicke ne sont pas diagnostiquées et ne reçoivent donc pas le traitement adapté, qui consiste en une simple supplémentation vitaminique.
Résultat : le syndrome de Korsakoff, la forme chronique et irréversible de l’encéphalopathie de Gayet-Wernicke, se met en place.
Un problème de vitamine B1
Les symptômes de l’encéphalopathie de Gayet-Wernicke et du syndrome de Korsakoff sont dus à la présence de lésions dans diverses zones du cerveau des malades. Ces dommages sont la conséquence d’un déficit en vitamine B1.
Aussi appelée thiamine, cette dernière joue un rôle important dans la maintenance du système nerveux. Il s’agit d’une vitamine dite « essentielle », ce qui signifie que le corps humain n’est pas capable de la produire. Elle doit donc être apportée par l’alimentation : la prise de 1 mg à 2 mg par jour suffit à couvrir les besoins d’une personne en bonne santé.
Naturellement présente dans certains produits, la thiamine est aussi ajoutée à d’autres. Elle peut, par ailleurs, être consommée sous forme de compléments alimentaires. Parmi les sources de thiamine figurent notamment le riz brun, les céréales complètes, le porc, la volaille, le soja, les noix, les pois, les haricots secs ainsi que les produits céréaliers enrichis ou fortifiés, tels que le pain, les céréales et les préparations pour nourrissons.
S’il arrive que l’encéphalopathie de Gayet-Wernicke résulte de problèmes nutritionnels dus à une alimentation trop pauvre en thiamine (dans diverses régions du monde, la carence en vitamine B1 est à l’origine du béribéri), dans près de 90 % des cas cette pathologie concerne des patients présentant un trouble de l’usage de l’alcool. Souvent, en effet, ces derniers mangent trop peu, les boissons alcoolisées leur fournissant une partie de leurs apports énergétiques.
Par ailleurs, la consommation d’alcool diminue l’absorption gastro-intestinale et le stockage hépatique de la thiamine, tout en augmentant son utilisation par les cellules. Enfin, diarrhées et vomissements peuvent aussi aggraver les problèmes d’absorption.
Cela signifie que le syndrome de Korsakoff pourrait être largement évité par l’administration précoce de thiamine, en particulier chez toute personne avec un trouble de l’usage de l’alcool, même sans symptômes neurologiques nets. Pourtant, cette vitamine bon marché, sans risque majeur, n’est que très rarement prescrite dans les services d’urgence, en addictologie ou en médecine générale.
En cause, notamment, la méconnaissance du fait que seule une minorité de patients présente un tableau clinique classique complet. Ce constat a conduit plusieurs associations de patients et de familles à alerter sur la carence de repérage, de diagnostic et de prise en charge de ces pathologies
Le sous-diagnostic, à l’origine d’un scandale sanitaire silencieux
L’encéphalopathie de Gayet-Wernicke est souvent mal diagnostiquée, car la triade de symptômes « confusion, troubles oculomoteurs, ataxie » considérée comme son tableau clinique dit classique n’est complète que chez 16 % des patients.
Il faut donc l’abandonner et utiliser à la place les critères de Caine, établis par la neuropsychologue Diana Caine et ses collaborateurs. Validés par des études cliniques et neuropathologiques, recommandés par les sociétés savantes, ils sont aujourd’hui considérés comme les plus fiables : ils permettent de multiplier par quatre la sensibilité du diagnostic d’encéphalopathie de Gayet-Wernicke, lequel repose sur la présence d’au moins 2 des 4 critères.
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/virage-ambulatoire-quels-patients-en-sont-exclus
Les critères cliniques de Caine (1997) pour diagnostiquer l’encéphalopathie de Gayet-Wernicke
- Déficits nutritionnels documentés : IMC très bas, perte de poids, dénutrition sévère, malabsorption, régime très restrictif, vomissements fréquents ;
- Troubles oculomoteurs : nystagmus, ophtalmoparésie, paralysie du regard, diplopie ;
- Syndrome cérébelleux : ataxie, démarche instable, dysmétrie, troubles de l'équilibre ;
- État confusionnel ou troubles de la mémoire : désorientation, attention fluctuante, troubles mnésiques modérés à sévères.
Chez les patients avec trouble de l’usage de l’alcool, la présence d’un seul critère doit déjà alerter sur un risque élevé d’encéphalopathie de Gayet-Wernicke, justifiant une administration immédiate de thiamine, sans attendre les résultats d’imagerie ou de biologie.
En effet, les lésions cérébrales irréversibles surviennent rapidement et une fois le syndrome de Korsakoff installé, il n’existe aucun traitement curatif. Seules des approches de remédiation cognitive ou de soutien social peuvent alors limiter les dégâts.
Cette situation a conduit plusieurs associations de patients et de familles de patients à alerter sur la carence de repérage, de diagnostic et de prise en charge de ces pathologies, qui concerneraient de 60 000 à 100 000 personnes en France.
Des patients plutôt masculins
Chaque année, dans notre pays, de 600 à 900 personnes développeraient un syndrome de Korsakoff. À l’heure actuelle, on dispose à de peu de données concernant son épidémiologie. On sait cependant qu’il touche surtout des individus présentant un trouble de l’usage de l’alcool sévère et une carence prolongée en vitamine B1.
Le risque d’être atteint par ce syndrome augmente fortement lorsque la consommation est élevée (soit, par jour, 6 à 8 verres d’alcool, selon que l’on est respectivement une femme ou un homme) et qu’elle se maintient sur une durée prolongée (de plusieurs années, souvent supérieure à dix ans). Il est aussi aggravé par la malnutrition, les épisodes de sevrage répétés sans prise en charge, ou encore les maladies qui augmentent les besoins ou réduisent l’absorption.
Une étude récente menée en Finlande a rapporté une incidence (nombre de nouveaux cas) de 3,7 (pour les hommes) et de 1,2 (pour les femmes) pour 100 000 personnes-années. Ces travaux révèlent aussi que 56 à 84 % des patients qui survivent à une encéphalopathie de Wernicke non traitée développent un syndrome de Korsakoff.
Une étude observationnelle rétrospective, publiée en 2025 et menée sur 1 320 patients pris en charge à l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris (AP–HP) entre 2017 et 2022, a révélé que la majorité des patients était de sexe masculin (72,9 %). Leur âge moyen était de 62,9 ans, et ils étaient principalement pris en charge dans les services de médecine interne (22,1 %).
Les principales pathologies associées au syndrome de Korsakoff étaient l’hypertension artérielle (fréquence de 34 %) et un épisode dépressif (fréquence de 23,7 %). Le suivi médian de trois ans de ces patients a montré un mauvais pronostic, se traduisant par des atteintes sévères de la cognition, un taux de récupération faible, et un taux de mortalité élevé (30,2 %).
Enfin, l’étude menée sur les patients de l’AP-HP a permis d’estimer les coûts hospitaliers annuels moyens pour les patients atteints du syndrome de Korsakoff : 15 346 euros par patient, ce qui représente un déficit annuel de 8 507 euros par cas et par hôpital. Les auteurs insistent sur le fait que la mise en place d’un parcours de soins spécifique est nécessaire pour améliorer la survie de ces personnes.
Une insupportable errance médicale
De nombreux patients atteints d’un syndrome de Korsakoff subissent une difficile errance médicale. Ils sont souvent considérés comme trop jeunes pour la gériatrie, trop désorientés pour les structures médico-sociales classiques, trop stabilisés pour la psychiatrie aiguë, et trop lourds pour les centres d’addictologie.
Le syndrome de Korsakoff concentre en effet plusieurs angles morts de notre système de santé : la stigmatisation des troubles de l’usage d’alcool, la marginalisation des personnes en précarité, ou encore le sous-investissement dans la prévention nutritionnelle. Ces patients, souvent jeunes, sont perçus comme responsables de leur état, ce qui freine l’accès aux soins. La lecture des nombreux témoignages existants est édifiante.
Contrairement à d’autres pays, comme les Pays-Bas ou la Belgique, la France ne dispose d’aucune filière de soins spécialisée. L’absence de réponse structurée aggrave la perte d’autonomie, alourdit le fardeau des familles et rend la réinsertion quasiment impossible. À Roubaix, toutefois, une maison d’accueil a été spécifiquement créée pour accueillir les femmes atteintes du syndrome.
Un plan national pour sortir du déni
Le syndrome de Korsakoff n’est pas le résultat d’un simple excès de boisson, mais bien d’un enchaînement évitable de négligences médicales (notamment l’insuffisance de repérage précoce du mésusage de l’alcool), nutritionnelles et sociales.
Il est possible de lutter contre ce fléau en mettant en place quatre types d’actions :
- La prescription systématique de thiamine par voie intraveineuse ou intramusculaire chez tout patient suspecté de trouble de l’usage de l’alcool, ou en état de sevrage.
- L’organisation de campagne de formation des professionnels de santé pour repérer les encéphalopathies de Wernicke précoces et éviter les erreurs diagnostiques.
- La création, à l’échelle régionale, de structures spécialisées destinées à accueillir les patients avec syndrome de Korsakoff pour leur proposer soins, réhabilitation cognitive et accompagnement social.;
- L’intégration du risque de démence liée à l’alcool dans les politiques publiques de prévention et dans les parcours de soins en addictologie.
Le syndrome de Korsakoff n’est pas une fatalité. C’est le produit d’un déni collectif face à une forme de démence évitable, souvent installée à l’âge de 40 ou 50 ans, dans l’indifférence. Si rien n’est fait, ces patients continueront à disparaître lentement, dans un silence médical et politique injustifiable.
Chez les patients à risque, gare au glucose !
- Administrer du glucose à un patient à risque lors de sa prise en charge peut précipiter le déclenchement d’une encéphalopathie aiguë. En effet, donner du sucre à quelqu’un qui manque de vitamine B1 risque de « brûler » ses dernières réserves et d’abîmer son cerveau en quelques heures. Pour cette raison, il est recommandé d’administrer la thiamine avant ou en même temps que le glucose.
Mickael Naassila, Professeur de physiologie, Directeur du Groupe de Recherche sur l'Alcool & les Pharmacodépendances GRAP - INSERM UMR 1247, Université de Picardie Jules Verne (UPJV) Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
A voir aussi

 SONDAGE : Excellence en santé : ce que les médecins jugent possible aujourd’hui… pour toutes les générations
SONDAGE : Excellence en santé : ce que les médecins jugent possible aujourd’hui… pour toutes les générations
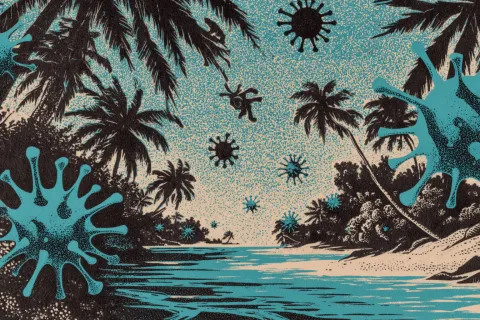
 Neuf cas de mpox recensés à Mayotte mais la situation reste « peu inquiétante » selon l'ARS
Neuf cas de mpox recensés à Mayotte mais la situation reste « peu inquiétante » selon l'ARS

 Le Chateau Sourire, un lieu pensé pour que les enfants atteints du cancer restent des enfants
Le Chateau Sourire, un lieu pensé pour que les enfants atteints du cancer restent des enfants
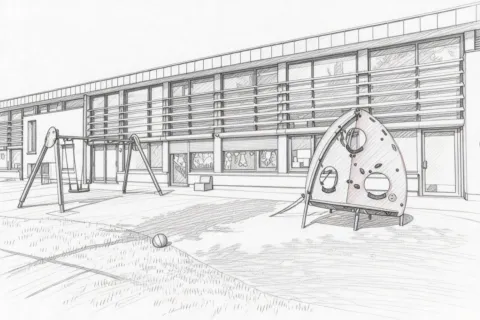
 Des enfants enfermés et maltraités en pédopsychiatrie : l’hôpital de la Fondation Vallée sous inspection de l’ARS
Des enfants enfermés et maltraités en pédopsychiatrie : l’hôpital de la Fondation Vallée sous inspection de l’ARS

 Incendie de Crans-Montana : quand une bactérie multirésistante complique la prise en charge des grands brûlés
Incendie de Crans-Montana : quand une bactérie multirésistante complique la prise en charge des grands brûlés

 Naturopathie, jeûne, compléments alimentaires... Quand les malades du cancer pensent s'aider pour le pire
Naturopathie, jeûne, compléments alimentaires... Quand les malades du cancer pensent s'aider pour le pire

 Qualité des soins en 2025 : les 10 chiffres que le système hospitalier ne peut plus ignorer
Qualité des soins en 2025 : les 10 chiffres que le système hospitalier ne peut plus ignorer

 Laits infantiles rappelés : 5 nourrissons sont hospitalisés, annoncent les autorités
Laits infantiles rappelés : 5 nourrissons sont hospitalisés, annoncent les autorités





