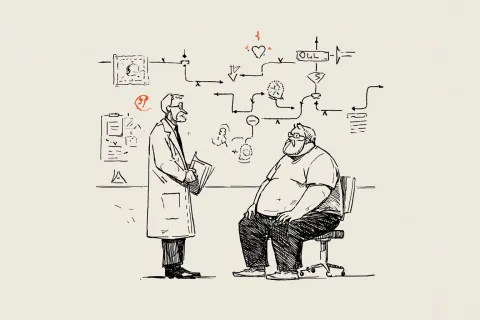Vendredi soir, dans la capitale ensanglantée par les attentats, il y avait deux catégories de médecins. Ceux qui étaient à l’hôpital, et ceux qui n’y étaient pas. Une soirée très difficile, pour les uns comme pour les autres.
« La première patiente qui est arrivée, c’est une jeune fille qui est venue par elle-même de la rue de Charonne avec une balle dans le bras ». Vendredi dernier, Barbara assure sa deuxième garde en tant que chef aux urgences de l’hôpital Saint-Antoine, à Paris. Elle s’en souviendra longtemps.
Après cette première patiente, les blessés par balle commencent à affluer dans cet établissement, le plus proche du lieu des tueries. Mais l’équipe ne sait toujours pas que des attentats sont en cours dans la capitale. « C’est par l’extérieur qu’on l’a su, ce sont mes proches qui m’ont informé par texto », explique Barbara.
« Il y a un DU pour ça et je ne l’ai pas fait »
« Après, j’ai un trou », reconnaît-elle, tentant de rassembler ses souvenirs. « Je sais que je me suis dit que j’allais faire de la médecine de catastrophe, qu’il y a un DU pour ça, et que je ne l’ai pas fait ». Mais Barbara dédramatise rapidement : « finalement, c’est surtout du triage, de la médecine de base et beaucoup de bon sens ».
L’urgentiste passe la nuit au déchoquage. Ce qui la frappe, c’est la mobilisation du personnel. « Beaucoup de collègues, des chefs, des internes, des externes, et énormément de paramédicaux sont venus », se souvient-elle. A tel point qu’à un moment, il y a trop de monde. « On a dû s’organiser, limiter le nombre de paramédicaux à 4 par patient », explique Barbara.
Et puis, progressivement, les choses se calment, les patients partent vers d’autres services. « A 2 ou 3 heures, on a recommencé à boire de l’eau. A 4 heures, il n’y avait plus personne aux urgences ».
Frustration
Dans un autre quartier, Serge*, anesthésiste-réanimateur dans un autre établissement, vit une soirée bien différente. Lui aussi apprend les événements par ses proches, mais il n’est pas de garde. Rester chez lui est difficile : « J’ai très peu dormi, tourné en rond », ressasse-t-il. « Savoir que les blessés arrivent là où on travaille et ne pas y être est dur. On se sent encore plus impuissant ».
Samedi, il est en contact avec son équipe. « Notre chef avait bien sûr organisé les présences médicales. Pas besoin de moi ce week-end. Dur ». Mais Serge accepte : « il en faut aussi sur le pont pour les jours qui suivent : les blessés chirurgicaux ont besoin de reprise chirurgicale, de pansements au bloc. L’effort doit tenir dans la durée ».
Le point commun entre ces deux soirées de jeunes médecins ? L’incompréhension. « On est habitués à rigoler des situations horribles avec notre cynisme de médecins », explique Barbara. Mais là, quelque chose empêche le mécanisme d’autodéfense habituel d’opérer. « C’était des gens de mon âge, dans mon quartier… On se sent visés », résume-t-elle.
* Le prénom a été changé
Source:
Adrien Renaud et Alice Deschenau