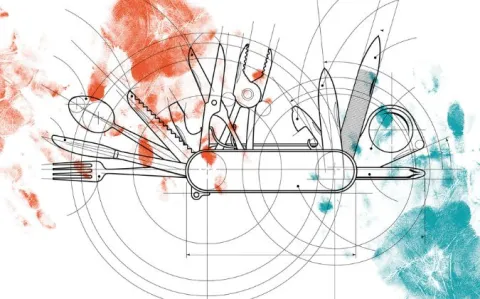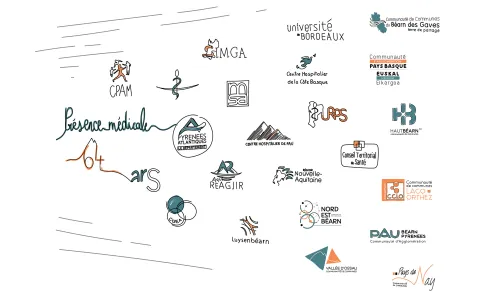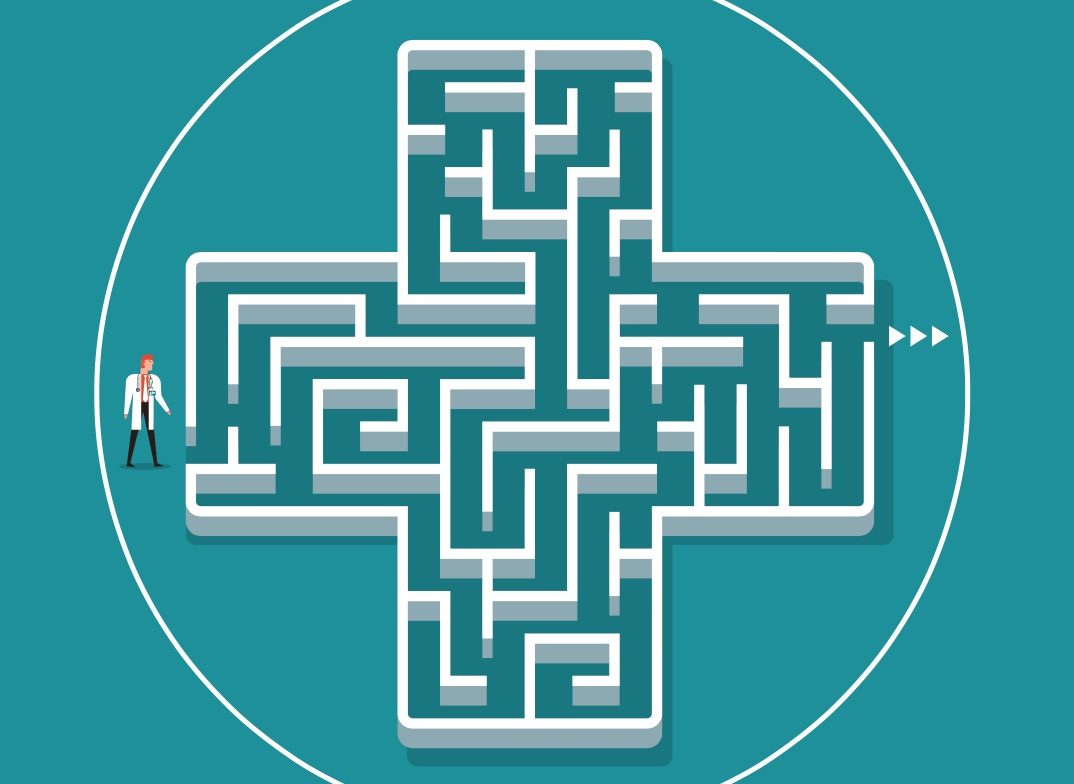
En avril 2021, le Sénat de l’Arkansas a adopté une loi interdisant aux prestataires de soins médicaux de proposer aux jeunes personnes transgenres des hormones ou des opérations chirurgicales visant à confirmer leur identité sexuelle.
À la lecture du projet de loi – intitulé Save Adolescents From Experimentation Act (« Sauvez les adolescents de l’expérimentation ») – on pourrait penser que le texte en question vise à protéger les enfants de médecins tels que Josef Mengele, rendu tristement célèbre par les expérimentations meurtrières qu’il a menées sur des prisonniers juifs, pendant la Seconde Guerre mondiale.
« L’Assemblée générale est gravement préoccupée », dit le texte, par le fait que l’on autorise les jeunes transgenres « à être les sujets de traitements irréversibles et drastiques », « malgré l’absence d’études démontrant que les avantages de ces interventions extrêmes dépassent les risques. »
Cette déclaration est en contradiction avec les preuves de plus en plus nombreuses qui établissent qu’empêcher les gens d’accéder à des traitements d’affirmation du genre augmente les risques d’isolement social, d’idées suicidaires et de dépression. Il a également été constaté que le fait de refuser aux jeunes trans et non binaires l’accès aux bloqueurs de puberté a des effets négatifs sur leur santé mentale.
L’emploi d’un tel langage hyperbolique ainsi que la diffusion d’une imagerie d’expérimentation brutale empêchent en revanche les prestataires médicaux de s’emparer des divers problèmes qui existent effectivement dans ce domaine. Leurs efforts sont encore davantage découragés par la nature punitive de la législation, qui peut entraîner la perte du droit d’exercer la médecine.
Comme je l’explique dans mon dernier ouvrage, Médecine trans, rare sont les traitements médicaux trans, les thérapies ou les éléments de prise de décision qui répondent à l’heure actuelle aux standards scientifiques « basés sur les preuves ». On manque notamment d’essais contrôlés randomisés.
Pour cette raison, les personnels médicaux ont souvent des appréhensions à travailler avec des personnes transgenres, même s’ils reconnaissent qu’ils le doivent, dans l’intérêt de leurs patients.
Une résistance historique
Le manque de preuves dans ce domaine médical est connu de longue date.
Depuis le milieu du XXe siècle, les personnels médicaux s’occupant des personnes trans sont accusés de se livrer à des expériences inutiles, voire immorales, et d’être des charlatans. Nombre de ces accusations émanent d’autres médecins.
Dans une lettre à un collègue, Harry Benjamin, un endocrinologue bien connu qui a travaillé dans les années 1950, écrivait par exemple :
Si vous saviez le nombre de collègues qui ont demandé à me parler en aparté afin d’avoir une discussion à cœur ouvert sur le fait de travailler avec des transsexuels. Ils s’inquiétaient des ragots qui circulaient sur moi et sur mon cabinet, en raison de ce type de consultations.
Comme Benjamin le souligne – et comme le montrent d’autres éléments historiques – les soignants disposés à offrir une hormonothérapie aux transsexuels se sont retrouvés submergés par des vagues de scandales. En effet, un individu qui demandait à changer de genre était perçu comme souffrant d’une maladie mentale, et il était donc présupposé qu’il aurait été mieux pris en charge grâce à une thérapie de long terme.
En réponse à ces accusations de charlatanisme, l’establishment médical a généralement souligné la qualité de la formation des médecins incriminés, ainsi que leurs références et leurs compétences en matière de prise en charge des maladies – y compris lorsque lesdites accusations émanaient de confrères.
Cependant, depuis plus de 70 ans, les médecins et les thérapeutes qui travaillent avec des clients trans, jeunes ou vieux, sont hantés par une question fondamentale : comment une personne formée à la prise en charge de la maladie peut-elle « traiter » l’identité de genre d’une personne, laquelle ne relève d’aucune pathologie ?
Dans les eaux troubles du doute
Cette question traduit bien l’ambivalence dans laquelle se trouvent de nombreux médecins et thérapeutes lorsqu’ils tentent d’appliquer les modèles médicaux ou thérapeutiques standard aux identités de genre.
Prenons l’exemple de Margaret. Cette médecin de famille s’occupait de personnes transgenres depuis environ cinq ans au moment où nous nous sommes rencontrés, un après-midi, pour discuter de ses diverses expériences (les prénoms utilisés dans mes travaux de recherche sont des pseudonymes).
« Lorsque je travaille avec des personnes trans, je ne suis pas toujours sûre de le faire correctement », m’a-t-elle avoué. « Je n’ai pas été formée dans ce domaine. Si l’un de mes patients, qui présente un taux de cholestérol élevé ou qui fume, souhaite commencer à prendre des œstrogènes, que dois-je faire ? Refuser me semble préjudiciable, car la prise d’œstrogènes l’aiderait à exprimer son genre, lequel reflète qui il est vraiment. Mais qu’en est-il des risques pour sa santé ? Dans une telle situation, que suis-je censée faire ? » (À l’heure actuelle, les preuves d’une relation entre prise d’hormones et augmentation des risques de crises cardiaques ou d’accidents vasculaires cérébraux sont mitigées.
Les professionnels de santé savent habituellement que les connaissances sur lesquelles ils appuient leurs décisions éclairées sont fiables. Lorsque ce n’est pas le cas, les médecins peuvent ressentir un certain malaise, à l’image de celui exprimé par Margaret.
Son expérience n’est pas un cas isolé. Après avoir m’être plongé dans les archives de l’Institut Kinsey, qui abritent la correspondance des soignants depuis le milieu du XXe siècle, avoir interrogé des médecins ou des thérapeutes travaillant avec des personnes transgenres jeunes ou moins jeunes, sur tout le territoire des États-Unis, et avoir assisté à leurs communications durant diverses conférences, il m’est apparu clairement que l’incertitude exprimée par Margaret imprègne la médecine transgenre.
Alexis, une travailleuse sociale que j’ai interrogée, m’a confié que l’une des difficultés lorsque l’on travaille avec les personnes trans est que le parcours de chacune est unique – « Il s’agit de cet individu, puis cet individu, et encore cet autre individu… », m’a-t-elle expliqué. Autrement dit, il est difficile d’essayer d’appliquer un modèle standard de prise de décision à l’expérience des personnes transgenres. Elles abordent en effet leur identité de façon complexe, et les raisons qui amènent l’une ou l’autre à solliciter des interventions médicales varient.
Or, lorsqu’il s’agit de procurer des soins ou des thérapies visant à aider à affirmer le choix d’expression du genre, cette flexibilité peut mettre mal à l’aise certains praticiens. S’exprimant lors d’une conférence sur les soins de santé, une médecin a exhorté ses collègues à s’assurer, avant de mettre leurs patients sous hormones, « que leur identité sexuelle est claire et qu’aucun signal d’alarme ne se déclenche ». Mais il n’existe aucun test médical pour confirmer une identité trans, et la littérature ou les directives cliniques ne définissent aucun « signal d’alarme ».
Les obstacles à la compréhension
Le fait qu’un traitement soit mis en place par les médecins ne signifie pas que le corpus de connaissances scientifiques à son sujet est complet. Cela tient en partie au fait que les résultats des essais contrôlés randomisés sont difficilement extrapolables aux personnes transgenres ou non binaires, étant donné que seul 0,6 % de la population s’identifie comme tel.
De plus, à l’image de Margaret, les praticiens peuvent se sentir peu qualifiés vis-à-vis de ces prises en charge, car leurs formations ne les y ont pas préparés correctement. Ces dernières ne consacrent en effet que peu de temps au thème de la « diversité » : une seule journée y est généralement dédiée. Elle porte sur les soins de santé pour les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels, établissant de ce fait un amalgame entre sexualité et genre.
En outre, les soignants ont peu d’occasions d’acquérir une formation spécifique en médecine ou en thérapie trans. Si les directives cliniques pour la médecine transgenre – autrement dit, les recueils de « recettes » visant à orienter au mieux la prise de décision médicale – offrent aux praticiens des indications sur les étapes à suivre pour mettre en place une hormonothérapie ou des interventions chirurgicales, elles traitent rarement de la manière de travailler avec les personnes trans et non binaires dans le respect de leur genre, ou de la manière d’éviter de créer des obstacles à l’accès aux soins pour ces patients.
Malgré tout, des progrès importants ont été réalisés.
Un nombre restreint, mais croissant, d’études portant sur l’efficacité des techniques chirurgicales ou sur les effets de l’hormonothérapie a été publié. Les praticiens que j’ai interrogés sont tous d’accord pour reconnaître que ces études leur sont utiles pour déterminer par exemple quelle quantité prescrire pour une hormone donnée. Mais ces informations ne les aident guère à décider quand initier, poursuivre ou refuser l’accès à un traitement hormonal – ou comment interagir avec les patients transgenre et non binaires de manière solidaire et inclusive.
Soutenir plutôt que punir
Les praticiens avec lesquels j’ai parlé insistent sur le fait qu’ils essaient de faire du mieux qu’ils peuvent. Mais en raison du manque de preuves scientifiques et d’une expérience clinique restreinte, ils se fient souvent à leur instinct pour les aider à naviguer dans les méandres de la médecine transgenre.
Cette situation peut parfois mener à ce que les entretiens cliniques soient insidieusement pollués par divers préjugés à l’égard de certaines personnes transgenres ou non binaires. Lesdits préjugés ne sont pas nécessairement intentionnels. Mais comme je le souligne dans mon ouvrage, lorsqu’ils se fient à leur instinct pour guider leur prise de décision médicale, les praticiens peuvent être influencés subrepticement par des préjugés de classe, voire des préjugés racistes ou homophobes.
Les personnes transgenres qui s’identifient comme des femmes ou des hommes, plutôt que comme des personnes non binaires, ont généralement plus de facilité à accéder à des soins adaptés à leur sexe. En effet, jusqu’à récemment, les praticiens avaient principalement pour expérience clinique des prises en charge de personnes en transition de sexe (femme vers homme ou homme vers femme).
La médecine transgenre ne constitue pas une exception : la façon dont les praticiens prennent leurs décisions et proposent des soins conformes au genre reflète la façon dont ils procèdent dans la plupart des nouveaux territoires de la médecine. La pandémie de Covid-19 a démontré à quel point il pouvait être difficile pour la médecine de se positionner dans une situation d’incertitude généralisée.
Il existe toutefois des solutions viables aux préoccupations des législateurs. Au lieu d’interdire purement et simplement aux praticiens de proposer des soins tenant compte de l’identité sexuelle, les pouvoirs publics ne feraient-ils pas mieux d’accorder davantage de financements pour mener des études longitudinales ? Ne faudrait-il pas offrir aux praticiens des possibilités de mieux se former à ces questions ? Selon moi, une telle approche contribuerait grandement à atténuer le malaise qu’ils éprouvent actuellement lorsqu’ils sont confrontés à de telles situations.
Auteur : Stef M. Shuster, professeur assistant en socilogie, Michigan State University
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l'article original
Source:
Déclaration d'intérêts : Stef M. Shuster ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.