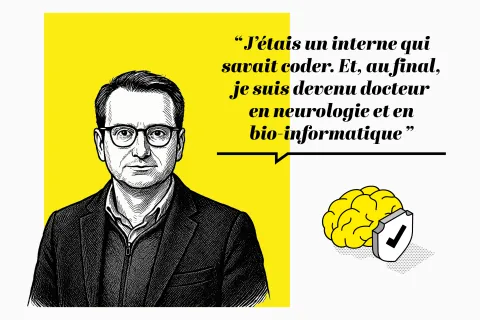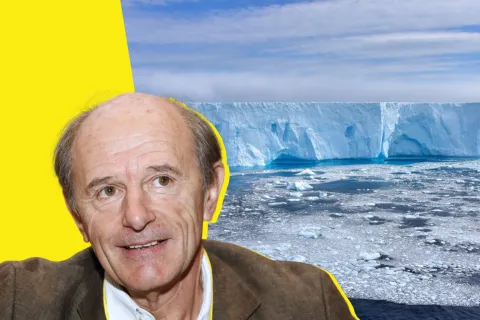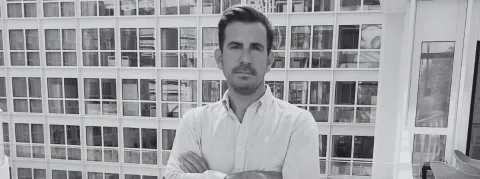Midjourney X What's up doc
« Biais sexistes, formation insuffisante des soignants, douleurs minimisées, diagnostics tardifs... En 2025, les femmes restent encore les grandes oubliées de la médecine », déclare l’association dans un communiqué.
Marie-Amandine Stévenin, présidente de l’UFC-Que Choisir, nous raconte la démarche de l’association : « Fin 2023, nous avons fait une grande enquête qui nous avait mené à déposer un recours au Conseil d'État contre l'État pour inaction en ce qui concernait les déserts médicaux. »
En réalisant cette enquête, les journalistes s’étaient aperçus que 70% des femmes vivaient dans un désert médical concernant la gynécologie. « Nous nous sommes dit qu'il fallait creuser et agir pour la santé des femmes. » Cette nouvelle publication intitulée « Médecine : Les femmes dans l’angle mort » est consultable dès aujourd'hui.
Le constat fait est alarmant : « La médecine est pensée pour les hommes. Les femmes sont invisibilisées et en danger. »
La recherche médicale ou l’effacement des femmes
Seule la moitié des essais cliniques incluaient des femmes en 2019. C’est peu, mais c’est le double des chiffres de 2009. Que Choisir relativise dénonçant une « progression trompeuse : par exemple, si un traitement fonctionne très bien chez les hommes mais plutôt mal chez les femmes, le résultat global est parfois jugé positif. »
En bref, même si un traitement provoque des effets indésirables chez la femme, si l’homme supporte le traitement, il peut être validé.
La période Covid-19 a été l’apogée de l’ignorance des femmes dans la recherche : « moins de 10% des études scientifiques ont analysé les données en fonction du sexe et seulement 1,3% des essais de médicaments prenaient en compte les différences biologiques. »
Marie-Amandine Stévenin précise les résultats de l’enquête : « On écarte le féminin de toutes les études et de tous les protocoles parce que les variations hormonales sont complexes à analyser. » Ce n’est pas tout on apprend que dès le départ, « les animaux femelles sont souvent écartés des tests sous prétexte que leur cycle hormonal complexifie les résultats. »
Par « complexe », il est entendu qu’il va falloir multiplier les études. Tester les traitements sur différentes, à différents moments du cycle menstruel notamment.
La présidente de l’UFC-Que Choisir tient à mettre en exergue les femmes enceintes, encore plus invisibilisée dans la recherche. Le chiffre choc de l’étude, c’est peut-être celui-ci : « Sur 172 traitements approuvés entre 2000 et 2010, le risque de malformation du fœtus est indéterminé pour 168 d’entre eux. »
« Il faut renforcer la formation aux spécificités médicales féminines »
Résultat : les laboratoires se protègent en déconseillant le traitement aux femmes enceintes. Mais, pour une très grande majorité d’entre eux, le risque n'est pas prouvé ou infirmé, il est juste ignoré.
« Ce n’est pas parce qu'on est enceinte qu'on ne peut pas tomber malade », rappelle Marie-Amandine Stévenin. Cela paraît invraisemblable de devoir le rappeler, pourtant la recherche médicale semble l’oublier.
Encore plus radicalement, les femmes sont parfois juste « blacklistées » des essais cliniques parce qu’on suppose que, si elles sont en âge de procréer, il y a toujours un risque de grossesse…
L’UFC-Que Choisir continue « son combat pour une médecine équitable »
Dans la continuité de l’enquête, l’association de consommateurs réclame des « mesures fortes et immédiates ».
La première : « inclure systématiquement les femmes dans les essais cliniques pour que la recherche médicale soit véritablement inclusive ». La présidente insiste sur l'importance d'intégrer les femmes dès le début des études pour mieux comprendre l'impact des traitements et des diagnostics spécifiques à leur physiologie.
Une autre mesure concerne la formation des professionnels de santé. « Il faut renforcer la formation aux spécificités médicales féminines », souligne-t-elle. Certaines maladies présentent des symptômes différents selon le sexe, et d'autres sont exclusivement féminines. Mieux former les soignants permettrait de réduire les erreurs de diagnostic et de prise en charge.
La sensibilisation du grand public est également mise en avant. « Il serait essentiel de lancer une campagne nationale autour de la santé des femmes, car il reste encore des tabous », affirme Marie-Amandine Stévenin. Elle prend l'exemple de l'endométriose, qui touche deux millions de femmes en France et dont le diagnostic prend en moyenne sept ans. Selon elle, ces retards sont liés à des sujets encore tabous, comme celui des règles, même pour les femmes qui sont peu informées sur leur propre santé.
« Il faut simplement écouter et prendre au sérieux la parole des femmes lorsqu'elles consultent »
Enfin, la dernière mesure porte sur l'écoute des patientes. « Il faut simplement écouter et prendre au sérieux la parole des femmes lorsqu'elles consultent », déclare-t-elle. Trop souvent, les symptômes exprimés par les femmes sont minimisés, sous prétexte qu'elles exagéreraient leur douleur. Conséquence directe de la vision misogyne et patriarcale de l’existence d’un « sexe faible ». « La parole des femmes a autant de valeur que celle des hommes. Quand une femme dit qu'elle souffre, elle doit être entendue et recevoir des solutions », conclut-elle
A voir aussi

 Décès du Pr Claude Huriet, ancien sénateur et pionnier des questions de bioéthique
Décès du Pr Claude Huriet, ancien sénateur et pionnier des questions de bioéthique