
© Midjourney x What's up Doc

Le consentement, un pilier de la relation médecin-patient
La relation médecin-patient repose sur la confiance et le respect mutuel, et cette relation trouve son expression la plus formelle dans le consentement éclairé. On le sait tous, ce dernier, selon la loi française (Article L1111-2 du Code de la santé publique), exige que le médecin fournisse au patient une information claire, loyale et appropriée, concernant les bénéfices, risques et alternatives d’une intervention. Le patient doit, de manière libre et éclairée, donner son consentement avant toute procédure médicale.
Dans la pratique, il arrive que cette étape soit négligée ou traitée de manière routinière, notamment dans les contextes chirurgicaux. Mais la signature d’un formulaire de consentement, seule, ne suffit pas. Le médecin doit avoir expliqué l’intervention en détail et s'assurer que le patient a bien compris les enjeux, ce qui inclut également les complications possibles.
Les conséquences juridiques en cas de manquement
En France, le défaut d’information représente l'un des premiers motifs de mise en cause des médecins. En 2022, plus de 1 000 contentieux concernant un défaut de consentement ont été recensés, selon les chiffres de la Commission nationale des accidents médicaux. La majorité de ces litiges concernent des interventions chirurgicales où le patient a estimé ne pas avoir été suffisamment informé des risques encourus, en particulier des complications post-opératoires.
Aux États-Unis, le défaut de consentement est encore plus sévèrement sanctionné. En 2023, plus de 3 500 affaires de "malpractice" liées à des consentements incomplets ou inexistants ont été portées devant les tribunaux américains, avec des indemnisations parfois colossales, dépassant les 3 millions de dollars pour certains cas de chirurgie esthétique ou oncologique.
Qu'est-ce que cela signifie pour nous, médecins ?
Nous devons être conscients que les patients sont de plus en plus informés et attentifs à leurs droits, notamment en matière de consentement. Une simple négligence dans la présentation des risques d’une intervention peut rapidement se transformer en contentieux. Plus que jamais, nous devons nous rappeler que le consentement est un processus, pas une simple formalité administrative.
Ce qu’un consentement éclairé doit inclure :
- Une description détaillée de l’intervention, des objectifs et des alternatives thérapeutiques.
- Une explication claire des risques, y compris les complications fréquentes et rares.
- La possibilité pour le patient de poser des questions et de réfléchir avant de signer.
- Une trace écrite, signée par le patient et le médecin, attestant que l’information a été donnée et comprise.
Les situations à risque
Certaines spécialités sont particulièrement exposées aux litiges pour défaut d’information, en particulier la chirurgie plastique, l’orthopédie, et la chirurgie cardiaque, où les complications sont plus fréquentes ou potentiellement lourdes de conséquences. Mais au-delà de ces spécialités, il est de la responsabilité de chaque médecin de s’assurer que son patient a bien compris les implications de toute intervention médicale ou chirurgicale.
Un cas emblématique, en 2021, a concerné un patient ayant subi une intervention chirurgicale orthopédique qui a entraîné une complication neurologique grave. Le patient a affirmé n’avoir jamais été informé des risques neurologiques associés à l’opération. Le tribunal a donné raison au patient, condamnant l’établissement à verser 150 000 euros d’indemnités pour défaut de consentement éclairé. On est loin des montants américains, certes, mais cela représente néanmoins une somme importante.
Comment se protéger ? Mon conseil en pratique
1. Prendre le temps :
Dans un contexte médical où le temps manque souvent, nous devons consacrer suffisamment de temps à expliquer clairement les procédures, leurs risques et leurs alternatives. Il est préférable de repousser une intervention si le patient n’est pas encore en mesure de prendre une décision éclairée.
2. Documentation précise :
Conserver une trace écrite de l’information donnée au patient, idéalement avec un résumé des risques spécifiques mentionnés. Cette étape est essentielle en cas de contentieux. Des solutions numériques d’archivages existent aujourd’hui, elles permettent également d’avoir la trace de la remise au patient… essentielle !
3. Formation continue :
Les risques évoluent, tout comme la législation et les attentes des patients. Nous devons nous former régulièrement pour rester à jour sur nos obligations légales et éthiques.
Au total, le consentement médical pré-opératoire est loin d’être une simple signature au bas d’un formulaire. Il s'agit d'un acte éthique et juridique majeur qui engage la responsabilité de chaque médecin. Il y a tellement d’information à donner sur la situation technique et ses risques qu’il faut presque le considérer comme une partie de la consultation, comme une forme d’éduction thérapeutique pour le patient.
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/video/faites-entrer-lassuree-lemission-branchet-tv-0
Alors que les cas de mise en cause pour défaut d’information augmentent, il est essentiel que nous prenions le temps nécessaire pour informer nos patients de manière claire et exhaustive, tout en nous protégeant légalement par une documentation précise. Une bonne information est non seulement un droit pour le patient, mais également une sécurité pour nous, médecins.
Ne laissons pas l’administration du soin médical éclipser cette étape fondamentale de notre pratique.
A voir aussi
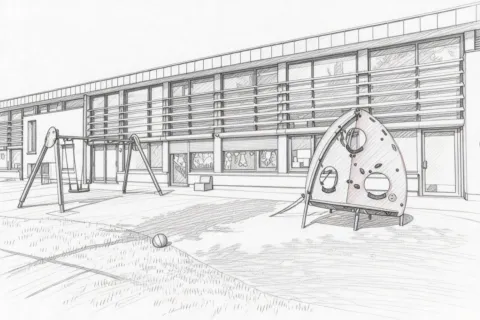
 Des enfants enfermés et maltraités en pédopsychiatrie : l’hôpital de la Fondation Vallée sous inspection de l’ARS
Des enfants enfermés et maltraités en pédopsychiatrie : l’hôpital de la Fondation Vallée sous inspection de l’ARS
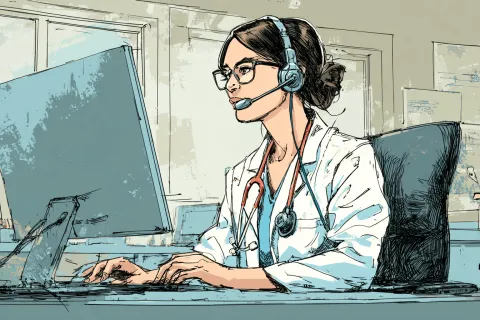
 Certains médecins pourront bientôt dépasser les 20% de téléconsultations, annonce Stéphanie Rist
Certains médecins pourront bientôt dépasser les 20% de téléconsultations, annonce Stéphanie Rist

 Urgences du CHU de Caen : la CGT alerte sur un danger grave et imminent
Urgences du CHU de Caen : la CGT alerte sur un danger grave et imminent

 Grève des médecins : un impact limité avec seulement 13,5% de baisse des feuilles de soins
Grève des médecins : un impact limité avec seulement 13,5% de baisse des feuilles de soins

 Un généraliste de 29 ans crée le premier centre multi-spécialités de suivi du diabète : « J'ai voulu en finir avec "le grand bricolage" qu'est la prise en charge du diabète »
Un généraliste de 29 ans crée le premier centre multi-spécialités de suivi du diabète : « J'ai voulu en finir avec "le grand bricolage" qu'est la prise en charge du diabète »

 Accidents du travail : 90 millions d'euros accordés pour la prévention des risques
Accidents du travail : 90 millions d'euros accordés pour la prévention des risques

 Grève des médecins : l’Ordre lance une mobilisation « constructive » et prépare un livre blanc pour 2027
Grève des médecins : l’Ordre lance une mobilisation « constructive » et prépare un livre blanc pour 2027







