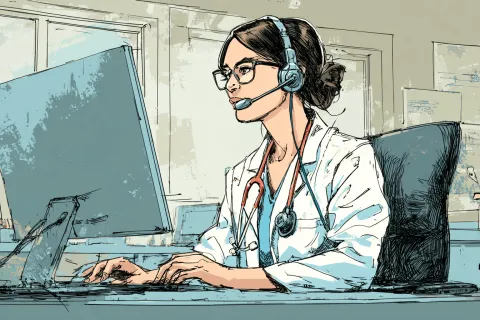© Midjourney x What's up Doc
Bien que les progrès médicaux aient rendu l’accouchement plus sûr que jamais, les disparités géographiques et la tendance à fermer les maternités locales ont créé une situation dans laquelle certaines femmes se retrouvent confrontées à un risque considérablement plus élevé d’accoucher hors d’un établissement hospitalier, sans l’avoir voulu.
Or, ces accouchements comportent un risque plus élevé de complications, en particulier pour le nouveau-né. Ce problème critique, qui a un impact sur la santé et la sécurité des mères et de leurs enfants, n’est pas uniquement la résultante de difficultés d’accessibilité. Explications.
La politique de périnatalité française en question
La France est un pays réputé pour son système de santé. Cependant, son approche des soins de périnatalité pose question. Par rapport à des pays dont la situation est comparable, le taux de mortalité néonatale (moins de 28 jours de vie) français est en effet plus élevé.
Les dépenses en matière de périnatalité ont augmenté ces dernières années, dans un contexte de recul de la natalité…, et alors que les comptes financiers des hôpitaux publics se sont dégradés depuis deux décennies. La Cour des comptes tirait d’ailleurs le signal d’alarme à ce sujet dans un rapport de 2024..
On constate aussi qu’au cours du dernier demi-siècle, la France a connu une baisse constante du nombre de maternités. Cette tendance est due à divers facteurs, notamment la sécurité, les mesures de réduction des coûts et la volonté de spécialisation. Elle a conduit à une situation où de nombreuses femmes, en particulier celles des zones rurales, vivent désormais plus loin d’une maternité que les générations antérieures.
Cela n’est pas sans conséquence sur les taux de mortalité néonatale. En effet, contrairement aux accouchements à domicile planifiés, ces accouchements sont souvent imprévus et, par définition, non pris en charge par une équipe médicale. Conséquence : pour de tels accouchements extra-hospitaliers, les taux de mortalité néonatale sont quatre fois plus élevés lorsque la maternité la plus proche est à plus de 45 km.
Distance à la maternité la plus proche et accouchements extra-hospitaliers
Bien qu’au niveau national, les temps de trajet médians vers les maternités soient restés relativement stables au cours des dernières décennies, cette moyenne masque d’importantes variations régionales.. Dans certains endroits, notamment les zones rurales, la distance jusqu’à une maternité peut être considérable.
Cette augmentation de la distance a un impact significatif sur la probabilité d’accouchements extra-hospitaliers. Si ces événements demeurent rares, puisqu’ils représentent moins de 0,5 % des naissances, on constate que les femmes qui vivent à plus de 30 km d’une maternité ont deux fois plus de risques d’accoucher en dehors d’un hôpital que celles qui vivent plus près.
Ce risque est amplifié dans les zones rurales, où les taux d’accouchements extra-hospitaliers sont deux fois plus élevés que dans les zones urbaines (7,4 pour 1 000 contre 3,3 pour 1 000, respectivement).
Ces chiffres augmentent avec la distance : on constate 11,6 accouchements extra-hospitaliers pour 1 000 lorsque les femmes vivent à plus de 45 km de la maternité la plus proche, contre seulement 3,1 pour 1 000 lorsque la maternité est à moins de 5 km. La fermeture de maternités dans des régions comme la Normandie, par exemple, a été directement associée à une augmentation des accouchements extra-hospitaliers.
Par ailleurs, le temps de trajet n’est pas le seul facteur à entrer en ligne de compte. Si certaines études suggèrent que les temps de trajet médians sont restés assez stables, ils masquent parfois la réalité des femmes qui vivent dans les zones les plus reculées. Dans le Lot, la proportion de femmes résidant à plus de 45 minutes d’une maternité passe de 6 % en 2000 à 24 % en 2017. Depuis 2000, trois maternités sur quatre du département ont été fermées. D’autres configurations territoriales peuvent poser également problème, comme les zones montagneuses où les routes peuvent se retrouver facilement enneigées en hiver.
Qui plus est, si une femme est en travail actif ou présente des complications, chaque minute peut être critique. Le temps de trajet ne rend pas compte à lui seul de l’accessibilité optimale aux soins, en particulier en cas d’urgence. La disponibilité des secours mobiles ainsi que le personnel et l’équipement à l’arrivée sur place ont une importance considérable.
Les facteurs socio-économiques et les inégalités jouent aussi un rôle
La question de l’accès aux soins maternels est encore aggravée par les facteurs socio-économiques. Le fardeau des disparités géographiques ne pèse pas de la même manière sur toutes les femmes.
Les femmes issues de milieux défavorisés, notamment les femmes migrantes, celles qui ont déjà eu plusieurs enfants ou celles qui vivent dans des zones défavorisées, sont souvent touchées de manière disproportionnée. Ces femmes ont tendance à choisir la maternité la plus proche, la distance est souvent un facteur clé dans leur choix, plutôt que d’autres facteurs comme l’expertise technique d’un établissement.
Celles qui sont dépourvues de couverture de sécurité sociale ont en revanche plutôt tendance à accoucher dans les hôpitaux publics, même s’ils sont plus éloignés de leur domicile.
La nécessité d’une approche nuancée
La situation actuelle suggère la nécessité d’une approche plus nuancée des soins de santé maternelle en France. La simple fermeture des maternités, sans prévoir de solutions alternatives adéquates, n’est pas une solution viable. Une réforme du financement des activités d’obstétrique est donc nécessaire.
Faire en sorte que toutes les femmes, quel que soit leur lieu de résidence ou leur origine socio-économique, aient accès à des soins sûrs et de qualité requiert notamment :
- de réaliser des investissements dans les services de maternité ruraux. Cela peut inclure la mise en place de davantage d’unités dirigées par des sages-femmes, pour les accouchements à faible risque, comme c’est le cas dans d’autres pays, notamment au Royaume-Uni ;
- d’améliorer les infrastructures de transport, pour s’assurer que les femmes peuvent atteindre rapidement une maternité en cas d’urgence ;
- de procurer un soutien ciblé aux populations vulnérables, afin de lutter contre les obstacles sociaux et économiques aux soins ;
- d’améliorer la collecte de données, pour obtenir des informations plus détaillées et récentes sur les différents facteurs qui entraînent un accès inégal aux soins.
Bien que le système de santé français soit généralement solide, il présente certaines lacunes, en particulier dans le domaine des soins en périnatalité. La question des accouchements extra-hospitaliers constitue un problème complexe, façonné par une combinaison de facteurs géographiques, socio-économiques et systémiques. En reconnaissant ces disparités et en adoptant une approche qui en tient compte, nous pouvons faire en sorte que toutes les femmes aient la possibilité d’accoucher en toute sécurité et dans la dignité.![]()
Hugo Pilkington, Géographie de la santé, Santé publique, Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
A voir aussi
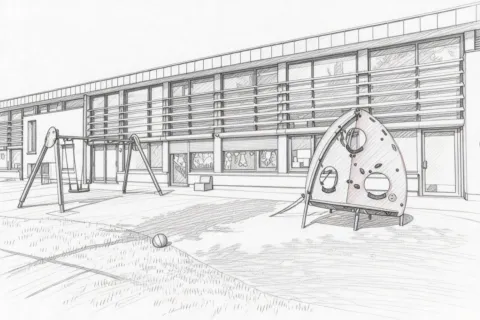
 Des enfants enfermés et maltraités en pédopsychiatrie : l’hôpital de la Fondation Vallée sous inspection de l’ARS
Des enfants enfermés et maltraités en pédopsychiatrie : l’hôpital de la Fondation Vallée sous inspection de l’ARS

 Incendie de Crans-Montana : quand une bactérie multirésistante complique la prise en charge des grands brûlés
Incendie de Crans-Montana : quand une bactérie multirésistante complique la prise en charge des grands brûlés

 Naturopathie, jeûne, compléments alimentaires... Quand les malades du cancer pensent s'aider pour le pire
Naturopathie, jeûne, compléments alimentaires... Quand les malades du cancer pensent s'aider pour le pire

 Qualité des soins en 2025 : les 10 chiffres que le système hospitalier ne peut plus ignorer
Qualité des soins en 2025 : les 10 chiffres que le système hospitalier ne peut plus ignorer

 Laits infantiles rappelés : 5 nourrissons sont hospitalisés, annoncent les autorités
Laits infantiles rappelés : 5 nourrissons sont hospitalisés, annoncent les autorités

 Quand les réseaux sociaux poussent à doper sa testostérone, un business qui inquiète les médecins
Quand les réseaux sociaux poussent à doper sa testostérone, un business qui inquiète les médecins

 Point d'étape de l'épidémie de grippe : un rebond jugé peu probable selon Santé publique France
Point d'étape de l'épidémie de grippe : un rebond jugé peu probable selon Santé publique France