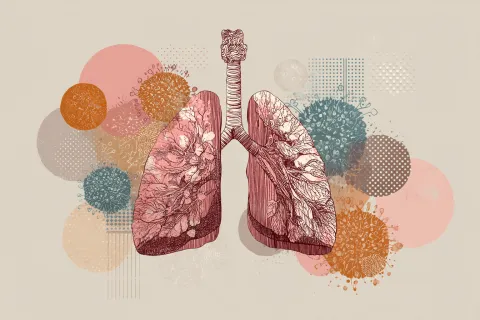![[PODCAST] Journée du don d’organes : quand Alex a donné son rein à son fils Julien](/sites/default/files/article/pictures_movies/Don%20d%27organes.jpg)
© IStock
« Comme mon père l’a dit à ma mère, tu lui as donné la vie une fois, je lui donne, moi, pour la deuxième fois ». Du concret, de l’émotion, du don… Un don d’un rein d’un père à son fils, d’Alex à Julien. Une intervention particulière pour mettre l’accent, un coup de projecteur, sur toutes ces interventions. Dans cette histoire de famille on raconte un don d’organe du vivant mais le don d’organes peut aussi se faire après son décès.
Cette année, l’Agence de la biomédecine appuie pour que cette journée devienne le jour où tous les Français disent à leurs proches s’ils sont donneurs d’organes après leur mort. La grande majorité de la population (80%) est favorable à ce don, 91% pensent qu’il est important de faire part de sa position à ses proches, mais seulement 47% en ont effectivement parlé.
1 prélèvement sur 3 est empêché
Pourtant, cet échange est vital. Si le sujet n’avait jamais été abordé, dans le doute, les proches rapportent par prudence une opposition, si bien que 1 prélèvement sur 3 est ainsi empêché. Autant de vies qui auraient pu être sauvées qui ne le sont pas, sachant que 5 à 7 personnes peuvent bénéficier d’une greffe d’organe vitale, pour chaque donneur décédé prélevé.
Grâce au don d’organes, 5 495 personnes ont été sauvées en 2022, mais près de 10 000 nouveaux patients sont inscrits en liste d’attente chaque année.
A voir aussi

 Changement monsieur l'arbitre ! Paul Hudson remplacé par Belén Garijo à la tête de Sanofi
Changement monsieur l'arbitre ! Paul Hudson remplacé par Belén Garijo à la tête de Sanofi

 Moderna critique la FDA après un refus d’examen de son vaccin antigrippal
Moderna critique la FDA après un refus d’examen de son vaccin antigrippal
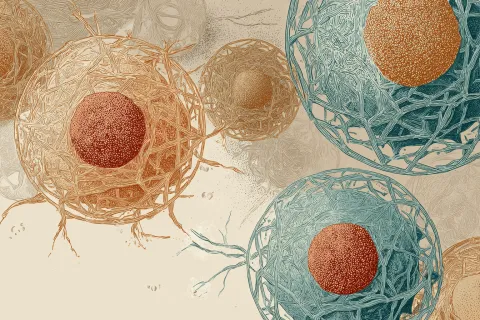
 Eli Lilly se renforce dans les thérapies cellulaires avec le rachat d’Orna Therapeutics
Eli Lilly se renforce dans les thérapies cellulaires avec le rachat d’Orna Therapeutics

 Bénéfice record pour AstraZeneca grâce à ses médicaments contre le cancer
Bénéfice record pour AstraZeneca grâce à ses médicaments contre le cancer

 Maladies rares : vers un traitement de Sanofi contre la maladie de Gaucher
Maladies rares : vers un traitement de Sanofi contre la maladie de Gaucher

 Maladie du greffon contre l’hôte : un traitement de Sanofi désormais recommandé par l'EMA
Maladie du greffon contre l’hôte : un traitement de Sanofi désormais recommandé par l'EMA
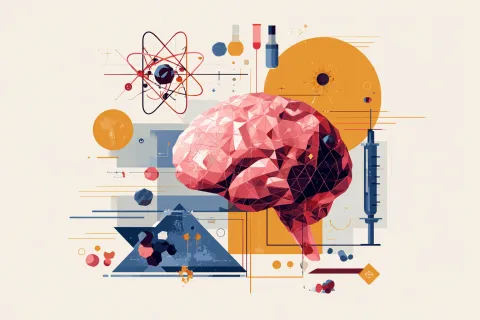
 659 millions d'euros de bénéfices : Servier encaisse grâce à son traitement contre le cancer du cerveau
659 millions d'euros de bénéfices : Servier encaisse grâce à son traitement contre le cancer du cerveau