
© Matthieu Brillard
What’s up Doc. L’année dernière a été marquée par le débat sur ce que certains ont appelé les « violences obstétricales ». Est-ce un débat légitime ?
Amina Yamgnane. Oui, parce que les gynécos occupent une place particulière : en dehors de l’acte amoureux ou du viol, nous sommes les seuls individus au monde à demander aux femmes de se mettre toutes nues, à aller dans leur vagin, et à les voir s’exécuter. Je trouve donc ce débat assez salvateur. Nous sommes très en retard par rapport à la demande des usagères, ayant tendance à rester dans l’acte technique pur, sans forcément mesurer l’impact émotionnel de nos mots ou gestes. Nous avons du mal à sortir de notre zone de confort. Si les femmes n’étaient pas venues nous tirer le bas du pantalon, je ne crois pa
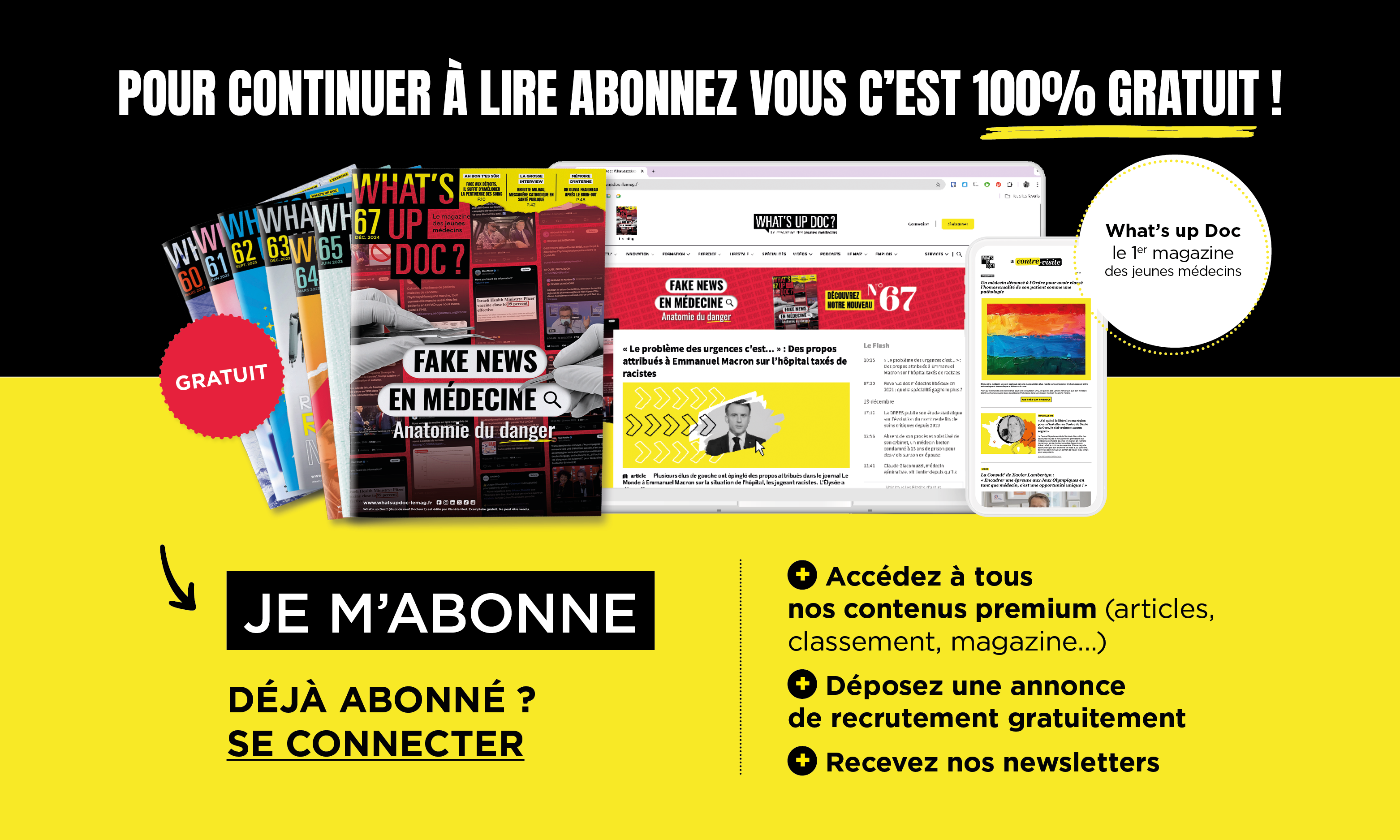
A voir aussi

 68 021 décès prématurés liés au tabagisme en 2023, malgré un léger recul
68 021 décès prématurés liés au tabagisme en 2023, malgré un léger recul

 SONDAGE : Excellence en santé : ce que les médecins jugent possible aujourd’hui… pour toutes les générations
SONDAGE : Excellence en santé : ce que les médecins jugent possible aujourd’hui… pour toutes les générations
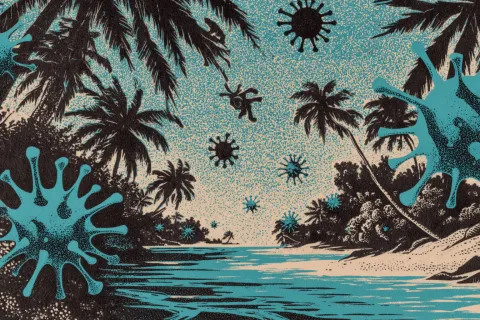
 Neuf cas de mpox recensés à Mayotte mais la situation reste « peu inquiétante » selon l'ARS
Neuf cas de mpox recensés à Mayotte mais la situation reste « peu inquiétante » selon l'ARS

 Le Chateau Sourire, un lieu pensé pour que les enfants atteints du cancer restent des enfants
Le Chateau Sourire, un lieu pensé pour que les enfants atteints du cancer restent des enfants
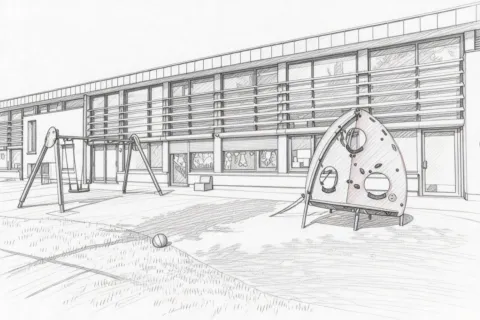
 Des enfants enfermés et maltraités en pédopsychiatrie : l’hôpital de la Fondation Vallée sous inspection de l’ARS
Des enfants enfermés et maltraités en pédopsychiatrie : l’hôpital de la Fondation Vallée sous inspection de l’ARS

 Incendie de Crans-Montana : quand une bactérie multirésistante complique la prise en charge des grands brûlés
Incendie de Crans-Montana : quand une bactérie multirésistante complique la prise en charge des grands brûlés

 Naturopathie, jeûne, compléments alimentaires... Quand les malades du cancer pensent s'aider pour le pire
Naturopathie, jeûne, compléments alimentaires... Quand les malades du cancer pensent s'aider pour le pire

 Qualité des soins en 2025 : les 10 chiffres que le système hospitalier ne peut plus ignorer
Qualité des soins en 2025 : les 10 chiffres que le système hospitalier ne peut plus ignorer





