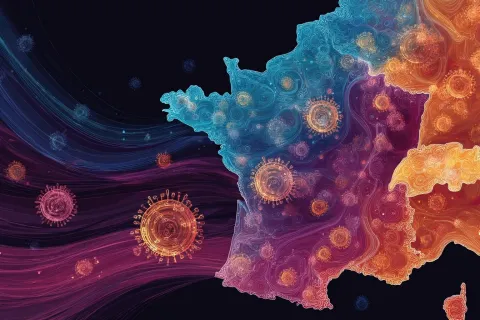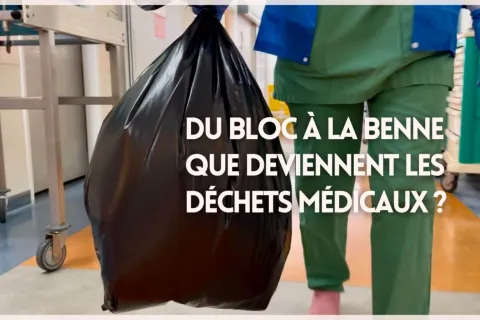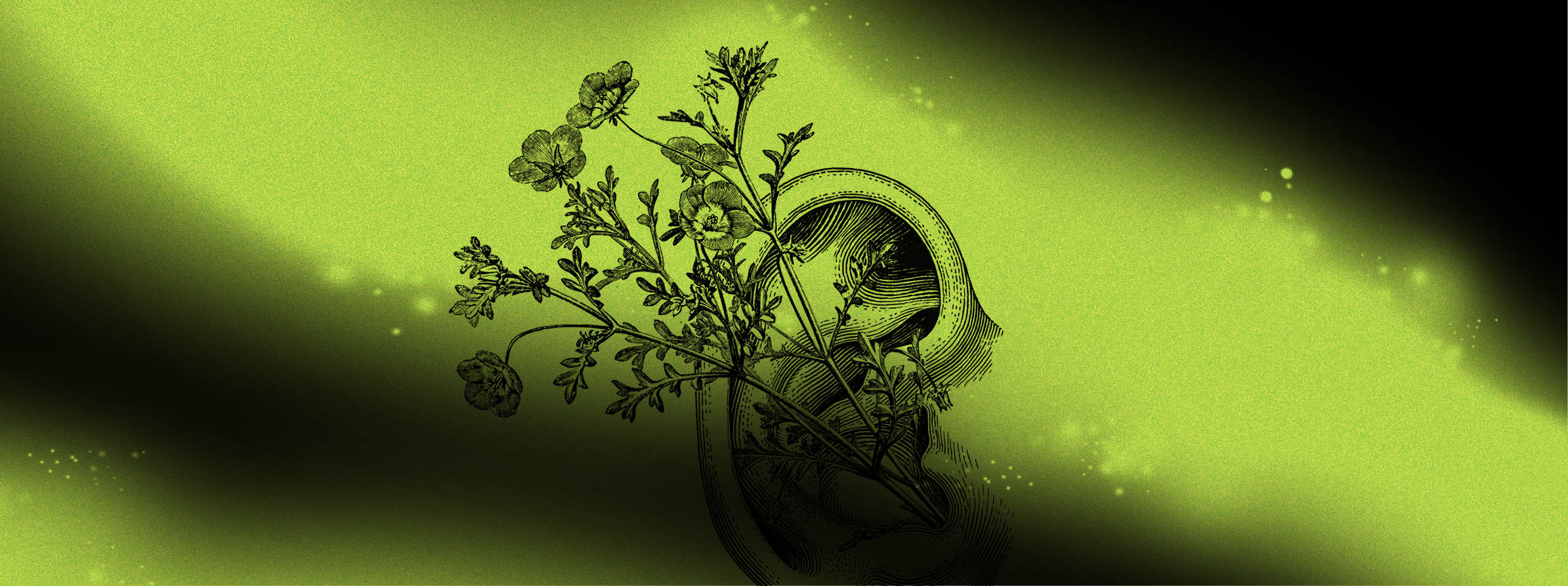
© DR
En parlant rempla’. C’est ainsi que le Dr Vincent Truchot, généraliste fraîchement installé à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), et le Dr Marine Toletti, qui s’apprêtait à faire des remplacements dans son cabinet, ont échangé quelques astuces pour diminuer l’empreinte environnementale de leur pratique. Le premier a expliqué comment il avait arrêté de jeter les embouts d’otoscope, la seconde a partagé la façon dont elle tentait d’économiser les draps d’examen. Et depuis, chacun a modifié sa façon de faire. Un « troc de trucs » très répandu entre confères, et dont on a tendance à sous-estimer l’impact potentiel sur les changements de comportement.
« J’ai expliqué que je nettoyais les embouts d’otoscope : je les brosse et je les mets dans un bain 24 heures, raconte le Provençal. Elle m’a dit qu’elle avait arrêté d’utiliser systématiquement des draps d’examen. C’est vrai qu’on a l’habitude de mettre le drap sur tout le lit pour chaque patient, alors que ça n’a pas trop de sens, la plupart ne sont pas déshabillés. » Une habitude que Marine Toletti avait elle-même contractée lors d’un stage d’internat. « C’est quelque chose qui avait été mis en place surtout pour des raisons financières, et maintenant je le fais partout parce que je trouve que c’est beaucoup mieux écologiquement », souligne la jeune généraliste.
Profiter des moments informels
De fait, les deux généralistes méridionaux ne sont pas les seuls à expérimenter les bienfaits des conversations du quotidien pour améliorer le verdissement des pratiques. Le Dr Amélie Aïm-Eusébi, elle aussi généraliste, mais dans le 18e arrondissement de Paris, a fait le même constat. « Cela arrive tout le temps, dans des moments de pause, quand on est en train de manger par exemple, ou alors quand on parle de choses organisationnelles et que je dis que ce serait peut-être l’occasion de commander des piles rechargeables ou du gel hydroalcoolique en flacons consignés », constate celle qui est cheffe de file sur les sujets environnementaux au sein de sa maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) et de sa communauté pluriprofessionnelle territoriale de santé (CPTS).
La praticienne parisienne a même remarqué avec satisfaction que certains des conseils prodigués lors de ces échanges se diffusent de confrère en confrère, au point de lui revenir par ricochet. « Parfois, cela revient à l’envoyeur, s’amuse-t-elle. Je parle par exemple très souvent des prescriptions nature [prescriptions consistant à demander au patient de dédier du temps à des sorties en nature, NDLR]. Un jour, quelqu’un m’a dit qu’il avait constaté que cela marchait très bien, que ses patients s’en était saisis, et en remontant le fil, on s’est rendu compte que son information initiale venait d’un cercle où j’en avais parlé. »
De l’informel au formel
Et il n’est parfois même pas besoin d’un échange en face-à-face ! C’est en tout cas l’expérience du Dr Eva Kozub, généraliste dans les Hautes-Pyrénées, membre de l’Alliance santé planétaire et coordinatrice du groupe « Santé planétaire » au sein du Collège de la médecine générale (CMG), qui avoue améliorer le bilan environnemental de ses prescriptions en scrutant celles de ses confrères. « Les ordonnances que nous prescrivons se baladent et se retrouvent parfois chez d'autres médecins, constate-t-elle. Personnellement je suis toujours curieuse et parfois dépitée de voir les prescriptions des autres. En tout cas, en prendre conscience, c'est l'occasion d'inspirer ou d'être inspiré ! »
https://www.calameo.com/whatsupdoc-lemag/read/00584615447976f93c3b9
Reste que malgré toute la valeur que peuvent avoir les échanges informels, ils ne sauraient suffire et doivent s’accompagner d’une communication plus structurée. « Ma façon principale d'échanger reste surtout liée à mon engagement associatif », estime Eva Kozub, qui évoque l’Alliance santé planétaire, le CMG, mais aussi l’Union régionale des professionnels de santé (URPS) au sein de laquelle elle est également impliquée. « Nous organisons aussi des événements type webinaires sur la santé planétaire au sein de la CPTS, et les professionnels du territoire nous disent qu’ils en sont très satisfaits », indique de son côté Amélie Aïm-Eusébi. Quant à Vincent Truchot, il a été invité à présenter (avec d’autres, voir encadré) ses pratiques durables lors d’une conférence en ligne organisée par l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP) en juin dernier. Ce n’est pas parce qu’on parle carbone autour d’un café qu’on ne doit plus en parler autour d’une table de réunion !
Structurer le bouche-à-oreilleLe 13 juin dernier, l’Anap présentait lors d’une webconférence organisée en collaboration avec l’Assurance maladie et le ministère de la Santé quelques-unes des 400 initiatives envoyées par les soignants de France et de Navarre en réponse à un questionnaire sur les soins écoresponsables pratiqués au sein des équipes. Parmi les idées mises en avant à l’issue de ce gigantesque exercice de bouche-à-oreille, on trouvait celles de Vincent Truchot (voir ci-xxx), mais aussi celles du Dr Sébastien Ponsonnard, anesthésiste à la polyclinique de Limoges, qui a réussi à arrêter l’utilisation dans son établissement du desflurane, un gaz anesthésiant dont l’impact pour le climat est 2 500 fois plus important que celui du CO2. On a également pu entendre lors de cette conférence comment Angélique Alexandre et le Dr Noëlle Bernard, respectivement aide-soignante et copilote de la transformation écologique au CHU de Bordeaux, ont travaillé sur l’écoconception de la toilette des patients. |
A voir aussi

 Un décès sur cinq, liés aux maladies cardiaques, évitable grâce à un environnement plus sain
Un décès sur cinq, liés aux maladies cardiaques, évitable grâce à un environnement plus sain