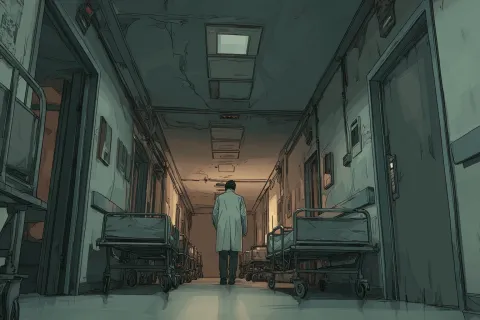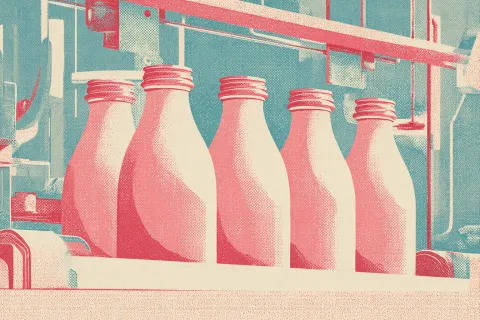© Midjourney x What's up Doc
Maladie du passé ? Pas du tout. Cette pathologie infectieuse, causée par le bacille Mycobacterium leprae, continue de toucher au moins 200 000 personnes dans le monde (des chiffres minimisés), soit un nouveau cas toutes les trois minutes, rappelle la Fondation Raoul Follereau, qui agit depuis 60 ans auprès des malades.
Avec plus de 100 000 cas déclarés en moyenne chaque année, l’Inde concentre la majorité des cas mondiaux. Viennent ensuite l’Indonésie, le Brésil et le continent africain. La France, elle, reste exempte de cas autochtones, mais quelques cas importés peuvent être détectés sporadiquement Outre-mer.
Si elle se traite et ne tue que très rarement, la lèpre continue de pâtir d’une mauvaise répétition, liée aux stéréotypes de l’Histoire, conduisant souvent à l'exclusion des malades. Et ce, « malgré sa contagiosité très faible », qui se fait « essentiellement dans la sphère familiale », rappelle la Fondation.
« C’est une maladie neurologique avec une expression dermatologique », résume le Dr Bertrand Cauchoix, médecin infectiologue qui a travaillé toute sa vie en Afrique, notamment sur le sida et la tuberculose, avant de s’engager aux côtés de la Fondation. « On dit communément que le bacille lèche la peau et mord le nerf », pouvant entraîner désensibilisation et atteinte à la motricité, traduite notamment par des paralysies (main en griffe et pied tombant) et amyotrophies.
Changement climatique
Revendiquant 16 millions de malades soignés en 30 ans, la Fondation Raoul Foullereau, du nom de son créateur, intervient principalement en Afrique francophone, et en particulier dans quatre pays dits « prioritaires » (Madagascar, Cote d’Ivoire, Tchad et Bénin).
Sur ce dernier pays, « on espère gagner la bataille dans peu de temps », explique Bertrand Cauchoix, le Bénin comptant aujourd’hui moins de cent malades.
« Le scandale aujourd’hui, c’est que l’on sait diagnostiquer la lèpre, on sait la guérir, mais malheureusement, la pauvreté agit comme un obstacle », renchérit le médecin. « Si on pouvait multiplier les examens, ça permettrait de dépister à des stades peut-être infracliniques ».
Ainsi, l’activité de la Fondation vise à « pallier les difficultés d’accès au système de santé des populations pauvres », à travers des actions de dépistage auprès des habitants, d’appui logistique et de formation des personnels dans les pays concernés. En plus du volet médical, elle agit aussi auprès des malades exclus pour favoriser leur réinsertion sociale.
Dans les pays développés, elle soutient également les programmes de recherche pour trouver des traitements efficaces.
Alors, pour Bertrand Cauchoix, l’intérêt d’une journée mondiale est aussi l’occasion de sensibiliser l’opinion publique et de mobiliser les donateurs.
« Aujourd’hui, les activités sur la lèpre ne sont financées que par les fondations caritatives, qui elles-mêmes ne vivent que de la générosité », explique-t-il. À l’image en France de Raoul Foullereau, ou de l’Ordre de Malte, qui œuvre aussi dans la lutte contre la maladie.
La Fondation met aussi en garde sur l’impact du changement climatique sur la détection et le suivi des malades ; qui agit à la fois sur « l’appauvrissement des États » (et ses conséquences en termes de budgétisation de la santé), et sur le déplacement des populations, « vecteur d’arrêt du traitement ».
Des nouvelles pistes de traitements
Car le traitement actuel contre la lèpre - une association de plusieurs antibiotiques (rifampicine, clofazimine et dapsone) - est « très long et contraignant » (six à douze mois), rappelle Alexandra Aubry, professeure de microbiologie à l’université Paris-Sorbonne et membre de la commission médicale de la Fondation. L’inconvénient, c’est que les patients « en apparence améliorés ou guéris », peuvent être incités à arrêter.
« Le risque c’est que l’on rechute avec une bactérie qui devenue résistante à au moins un des antibiotiques utilisés », précise-t-elle.
De plus, la clofazimine possède un effet secondaire particulier, qui donne à la peau une coloration - jaune-orange à brun-noir – contribuant à amplifier la « stigmatisation » qui entoure déjà cette maladie.
Récemment, la bédaquiline, un antibiotique déjà efficace contre la tuberculose a montré des « résultats spectaculaires » sur la lèpre, selon deux études parallèles parue et à paraître dans le New England Journal Of Medicine.
Menées respectivement sur 8 et 30 patients, celles-ci ont montré que la bédaquiline avait un « effet quasiment jamais observé vis-à-vis de l’agent de la lèpre » qui en fait donc un traitement « vraiment prometteur », se réjouit Alexandra Aubry.
La bétaquiline ayant une demi-vie longue, « on peut très bien imaginer donner le traitement aux patients qu’une ou deux fois par mois », ajoute-elle.
Concernant un potentiel vaccin en revanche, « ce n’est probablement pas vers cette solution qu’il faut se diriger en priorité », au regard des moyens financiers alloués à la maladie qui restent « malheureusement limités ».
« Ça n’intéresse pas le secteur privé. On ne va pas vacciner l’Occident, on ne va pas vacciner les États-Unis, donc personne ne va le financer », conclut quant à lui Bertrand Cauchoix.
Note de la rédaction : Raoul Follereau (1903-1977) reste un personnage controversé de l’Histoire de France qui, s’il a consacré la deuxième partie de sa vie à la lutte contre la lèpre, il s’est également affiché publiquement à l’extrême-droite pétainiste et maurassienne, et a manifesté son soutien aux régimes fascistes européens dans l’entre-deux guerres.
Dans un mail à What’s up Doc, la Fondation a tenu à rappeler qu’elle « ne nie pas les faits controversés liés au passé politique de Raoul Follereau, mais insiste sur son engagement humanitaire auprès des malades de la lèpre à partir de 1942 (…) ». Elle « revendique également son indépendance et son caractère apolitique (…) » et dit s’être détachée « de tout influence politique [et] religieuse pour se concentrer sur la lutte contre la lèpre et les maladies négligées ».
A voir aussi