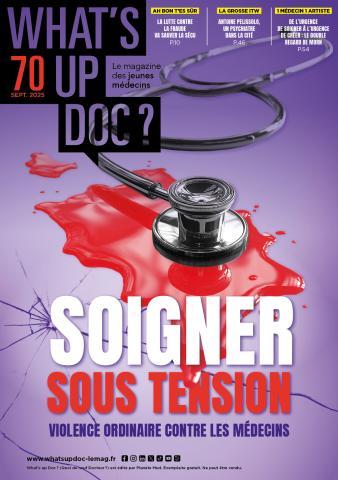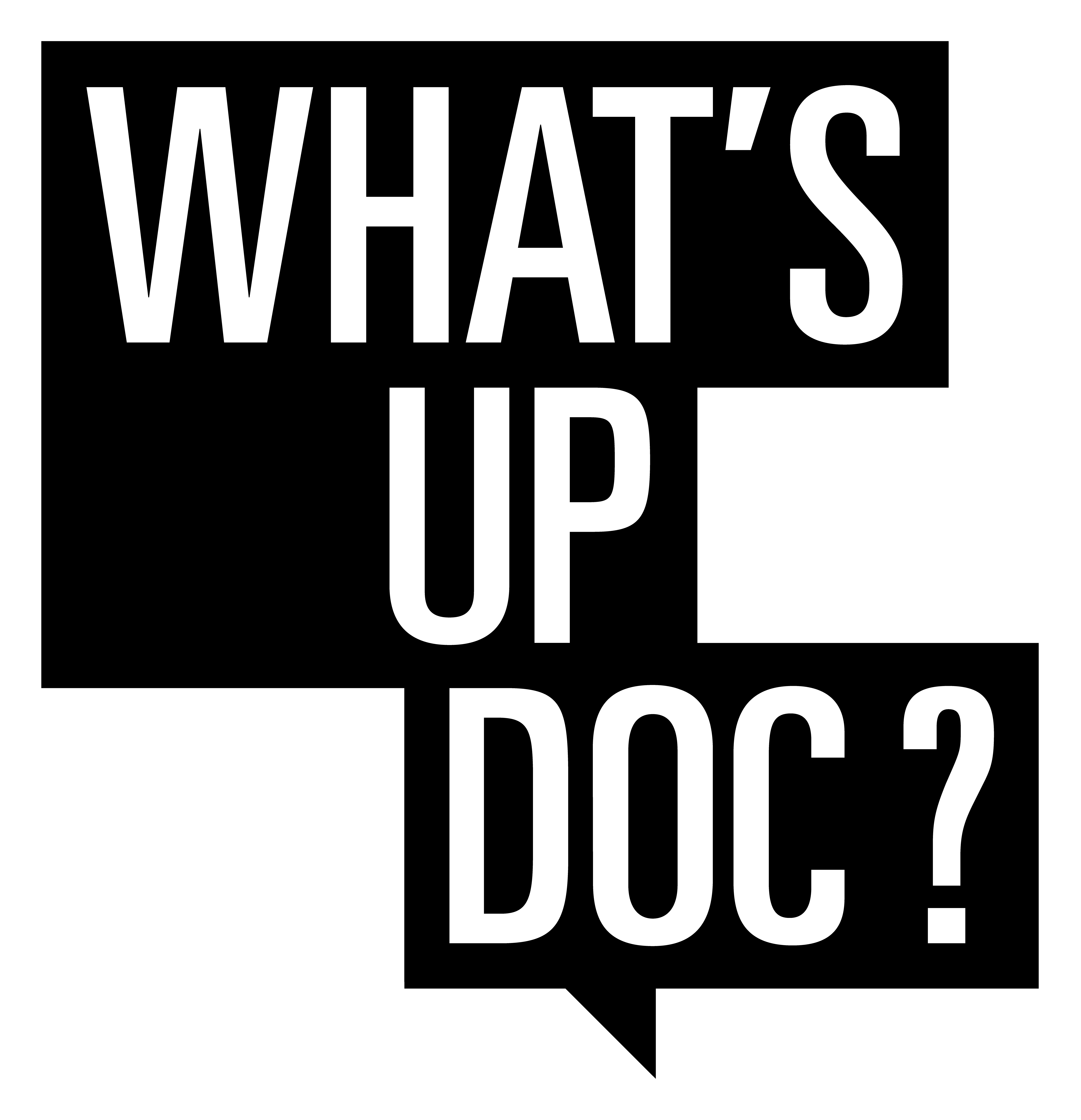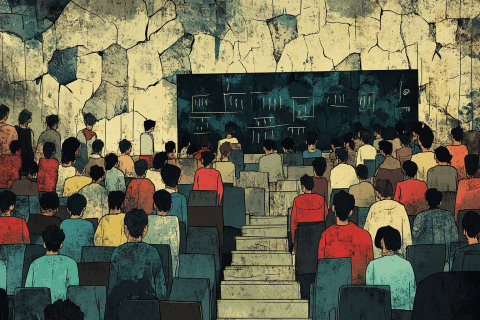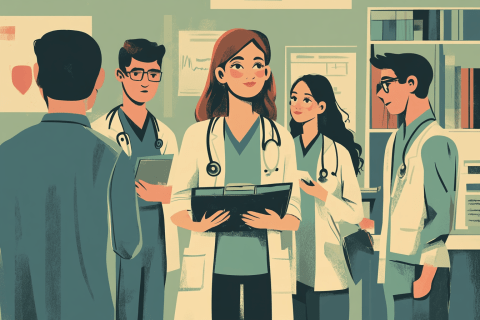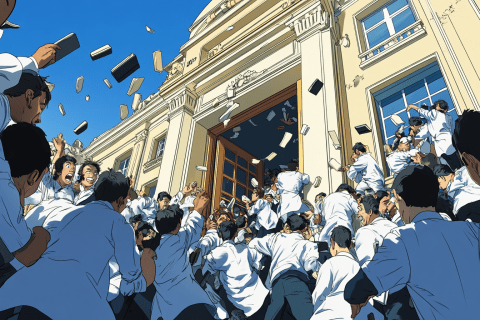Jeanne Barbotte © DR / Midjourney x What's up Doc
Elle manie les pièces depuis l’âge de 5 ans, mais ne se rêve pas encore en grand maître. Jeanne Barbotte, étudiante en cinquième année de médecine, participera en mai prochain au Top 12 féminin, un tournoi national pour élire la meilleure équipe de France. Mais l'étoile montante des échecs poitevins garde également en tête le concours de l’internat l’an prochain.
What’s up Doc : Cette passion pour le jeu d’échecs, c’est familial ?
Jeanne Barbotte : Oui. Mon père joue pour le loisir, il m’a appris à jouer quand j’avais 5 ans, comme à mes deux grands frères et à ma petite sœur. Dans la fratrie, tout le monde joue, et on est deux à avoir un niveau assez élevé, avec l’un de mes grands frères. On joue d’ailleurs parfois en équipe.
Les échecs t’ont-ils aidée dans ton parcours étudiant ?
JB. : Surtout pour la concentration et la patience, des qualités essentielles en études de médecine. Les parties d’échecs peuvent durer jusqu’à cinq ou six heures, ce qui demande énormément de patience. Être habituée à rester autant de temps devant un échiquier m’a aidée à le rester également devant un bureau, que ce soit pendant les révisions où les épreuves. Et cela continue aujourd’hui.
Pour l’apprentissage et la mémorisation aussi, non ?
JB. : Tout à fait. Quand on commence les échecs et qu’on apprend les ouvertures, c’est beaucoup de par cœur. On ne cherche pas vraiment la logique, c’est par la suite qu’on la développe. Pour les études de médecine, c’est la même chose : il y a beaucoup de par cœur au début, notamment en anatomie. Puis la logique apparaît au fils des ans, notamment avec la physiopathologie. Aux échecs comme en médecine, plus on grandit, plus on trouve de la logique dans ce que l’on apprend.
« Arrêter totalement la médecine pour faire carrière n’est pas dans mes projets »
Y-a-t-il des analogies possibles entre une partie d’échecs et une prise en charge médicale ?
JB. : Il y a trois grandes étapes dans une partie d’échecs : l’ouverture, le milieu de jeu et la finale. L’ouverture, c’est le début de la partie où l’on déploie son arsenal. Lors du milieu de jeu, on y voit plus clair sur le type de partie dans lequel on s’engage, les pièces s’échangent et le combat fait rage. La finale, c’est la fin du combat lorsqu’un joueur ne s’est pas directement imposé dans le milieu de jeu. Rapporté au milieu médical, l’ouverture peut désigner la situation clinique et les symptômes, qui vont nous indiquer vers quelles pathologies on va s’orienter. Ensuite, lorsque tout commence à s’assembler et on sait un peu plus où on va, on commence à poser un diagnostic. On détermine, par exemple, si la pathologie peut toucher différents organes, ou si elle est plus latente et ciblée. Puis il y a le diagnostic final avec la conduite du traitement. Comme aux échecs, on continue à bien réfléchir pour mettre en place le bon traitement et adapter ce qui est possible d’adapter.
Si tu as la possibilité de faire carrière dans les échecs, tu te vois mettre un terme à la médecine ?
JB. : Pour l’instant, arrêter totalement la médecine n’est pas dans mes projets. Les études me plaisent et je souhaite décrocher une spécialité qui me convient. Après, je n’exclue pas plus tard avoir un emploi du temps un peu moins chargé pour pouvoir faire un peu plus d’échecs. Mais cela dépendra aussi de mon métier et de mon cadre d’exercice.
Vivre des échecs est très compliqué et possible essentiellement à très haut niveau ; donc je ne me vois pas, aujourd’hui, m’y consacrer pleinement. Par contre, augmenter de niveau pour être un jour reconnue parmi les meilleures Françaises, pourquoi pas ? Mais il va falloir beaucoup travailler pour cela !
As-tu une idée de la spécialité que tu voudrais exercer ?
JB. : Pédiatrie, ou médecine générale avec un DU pédiatrique. Cela dépendra de mon classement. En tout cas, j’aimerais bien rester dans le milieu hospitalier. Je suis déjà passée en stage en pédiatrie l’année dernière et cela m’avait beaucoup plu. J’attends donc de passer en cabinet de médecine générale pour pouvoir comparer.
« Les échecs pourraient permettre de travailler la mémoire des malades d'Alzheimer »
Comment définirais-tu ton style de jeu ?
JB. : Quand j’étais plus jeune, mon coach me disait que j’étais très agressive, que j’attaquais beaucoup, voire trop. J’ai dû m’assagir avec l’âge, puisque maintenant je suis très calme et très positionnelle ! D’ailleurs, je trouve que cela se reflète beaucoup avec ma personnalité. Mon frère, c’est le contraire : il attaque beaucoup, et dans la vraie vie, il est plus extraverti et avenant.
Une thérapie par les échecs, cela fonctionnerait pour toi ?
JB. : Pourquoi pas ? De la même manière que la musicothérapie existe. Les échecs pourraient permettre de travailler la mémoire des personnes atteintes d’Alzheimer, sous réserve qu’elles savent déjà jouer un minimum. On pourrait les aider à mémoriser certaines combinaisons et à leur faire rejouer par la suite.
Les échecs peuvent être également utilisés pour les enfants sujets à l’hyperactivité. Lorsque j’étais petite, mon club à Niort comptait plusieurs enfants hyperactifs. Les échecs leur permettaient parfois de se canaliser et de rester concentrés… Mais cela ne marchait pas tout le temps !
Je pense que c’est un jeu qui peut être, de manière générale, mis à disposition des enfants hospitalisés, afin de leur proposer des moments calmes, tout en apprenant un nouveau jeu. Cela doit probablement déjà exister…
Quelles sont tes prochaines échéances au niveau échiquéen ?
JB. : Début octobre, je reprends les compétitions en solo et par équipe. Mais le gros rendez-vous, c’est en mai 2026. C’est le top 12 féminin : un grand tournoi par équipe sur plusieurs jours regroupant les 12 meilleures équipes féminines du pays. Nous sommes 4 filles de Poitiers à s’y être qualifiées l’année dernière. Cela risque d’être une belle compétition !