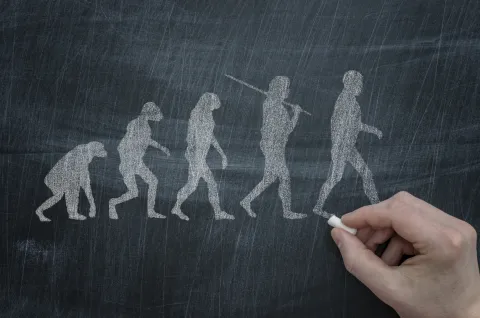© Youtube / Duke University School of Medicine
Audrey Blewer est docteure en épidémiologie, avec un master en santé publique. Actuellement professeure assistante à l’école de médecine de l’université Duke (Caroline du Nord, États-Unis), elle est principalement rattachée au département de médecine familiale et de santé communautaire.
En 2018, Audrey Blewer a réalisé une étude faisant un constat clair : les femmes ont moins de chance de recevoir un massage cardiaque par un témoin lorsqu’elles sont dans un lieu public. En 2024, la médecin publie une seconde étude, plus poussée afin de comprendre si l’origine ethnique et/ou le lieu de résidence pouvait interférer dans ce constat.
Résultat : Peu importe l’origine (ici blanc, noir ou hispanique, étant donné que l’étude a été réalisée aux États-Unis), les femmes ne sont pas égales aux hommes. Les chiffres sont alarmants, on parle de 14% de chance en moins de recevoir un massage cardiaque. Mais pas que, cela concerne aussi l’utilisation du défibrillateur.
Audrey Blewer explique comment cette inégalité face à la réanimation cardio-pulmonaire affecte la santé cardiovasculaire des femmes, et que peut-on faire pour améliorer cette situation.
What's Up Doc : Pourquoi ce sujet d'étude : les inégalités dans la réanimation cardio-pulmonaire ?
Audrey Blewer : Depuis mon master, je suis très motivée par l’étude de l’impact des maladies cardiovasculaires à l’échelle de la santé publique. J’ai été attirée par le domaine de l’arrêt cardiaque et de la réanimation, à la fois par ma formation et mon histoire personnelle : mon grand-père, très engagé civiquement, était pompier volontaire. Il a lutté contre des maladies cardiovasculaires pendant la majeure partie de sa vie, ce qui m’a profondément marquée et influencée.
Depuis une quinzaine d’années, je travaille dans le domaine de la réanimation cardiaque, de la science de la réanimation, de la réponse communautaire et du massage cardiaque pratiqué par des témoins. Je cherche activement à former davantage de gens à la RCP (réanimation cardio-pulmonaire), encourager les appels aux secours, et à favoriser l’utilisation des défibrillateurs.
« Pendant des décennies, les mannequins d’entraînement à la RCP étaient tous masculins. Il est temps que cela change. »
Ma thèse de doctorat portait déjà sur les disparités dans la formation et l’administration de la RCP par des témoins. Mon objectif est de faire en sorte que chacun ait la possibilité de recevoir une RCP et d’y être formé. C’est une question d’équité.
L’un de mes travaux de recherche a montré que les femmes sont significativement moins susceptibles que les hommes de recevoir une RCP en public. Ce constat date déjà de 2018, mais il a été confirmé en 2024.
Ce phénomène est particulièrement frappant dans les lieux publics, où la personne qui intervient est généralement un inconnu. À domicile, ce sont souvent les proches qui agissent, et la dynamique est différente.
Qu’est-ce que montre votre dernière étude en date ? Avez-vous été surprise par les résultats obtenus ?
A.B. : En 2024, nous avons cherché à savoir si la composition raciale d’un quartier avait un effet sur la probabilité qu’une femme reçoive une RCP. Nous avons été surpris de constater que, quel que soit le type de quartier, les femmes étaient toujours moins susceptibles de recevoir une RCP en public. Même après avoir pris en compte des facteurs comme les revenus ou le niveau d’éducation.
Cela suggère que des biais profonds, qui transcendent les contextes sociaux, influencent les comportements de secours en public.
Cela s'explique par le manque de formation du grand public ?
A.B. : Selon une étude nationale que nous avons publiée en 2017, environ 65 % des Américains interrogés avaient été formés à la RCP à un moment donné de leur vie. En revanche, seuls 18 % estimaient être capable de réaliser un massage cardiaque au moment de l’enquête. Cela montre un besoin évident de rafraîchir régulièrement les connaissances. Chaque États a sa politique : certains exigent une formation à la RCP pour obtenir un diplôme de fin d’études secondaires, mais il faut entretenir ces compétences tout au long de la vie.
Ndlr : En France, ce sont 40% des citoyens qui sont formés aux premiers secours. On imagine donc qu’une étude similaire portant sur la capacité des Français à réaliser un massage cardiaque efficacement aurait des résultats encore plus bas que ceux obtenus aux États-Unis.
« Que la personne soit un homme, une femme, une personne obèse ou menue. Il faut dépasser nos biais et sauver des vies. »
Pensez-vous que la représentation de l’anatomie féminine dans la formation joue un rôle ?
A.B. : Oui, c’est un point important. On commence à peine à intégrer des mannequins de réanimation avec une poitrine féminine. Pendant des décennies, les mannequins d’entraînement étaient tous masculins. Il est temps que cela change.
Ce n’est pas suffisant en soi, mais cela permet au moins de sensibiliser les gens. L’anatomie féminine est différente, et les gestes doivent s’adapter. Il faut que les gens soient préparés à intervenir, quel que soit le corps qu’ils ont en face d’eux.
Vous avez évoqué des biais sociaux profondément ancrés. Peut-on les combattre ? Et comment ?
A.B. : Selon une étude de 2019, l’une des raisons de cette disparité est la crainte. Les témoins, ont peur de pratiquer une RCP sur une femme en arrêt cardiaque. Ils redoutent que ce soit perçu comme un attouchement inapproprié. Ils ne veulent pas non plus blesser la victime.
Cela passe par l’éducation et les messages clairs. Une chose essentielle à retenir : lors d’un arrêt cardiaque, la personne est morte. Il est donc impossible de lui faire du mal. Il faut appeler les secours, commencer la RCP et utiliser un défibrillateur dès que possible.
En ce qui concerne la peur de commettre des attouchements inappropriés, il faut faire comprendre aux citoyens, via une formation efficace, que c’est une question de vie ou de mort. Poitrine ou pas, il faut agir. Certaines personnes confondent arrêt cardiaque et crise cardiaque. L’arrêt cardiaque est un problème électrique qui arrête le cœur immédiatement. Chaque seconde compte.
Les femmes sont aussi moins susceptibles de recevoir un choc électrique via un défibrillateur.
A.B. : Oui, et c’est un point crucial. Notre étude de 2024 montre également que les femmes ont moins souvent un défibrillateur automatique externe (DAE) appliqué. Cela s’explique aussi par la peur de toucher la poitrine ou de devoir dénuder la personne.
Il est urgent de briser ces tabous. Mon équipe et moi travaillons sur des stratégies de formations pour améliorer les réactions du public.
Un dernier message ?
A.B. : Je voudrais vraiment insister sur l’essentiel : il faut appeler les secours, appuyer fort et vite au centre de la poitrine, et utiliser un DAE si disponible — que la personne soit un homme, une femme, une personne obèse ou menue. Il faut dépasser nos biais et sauver des vies.