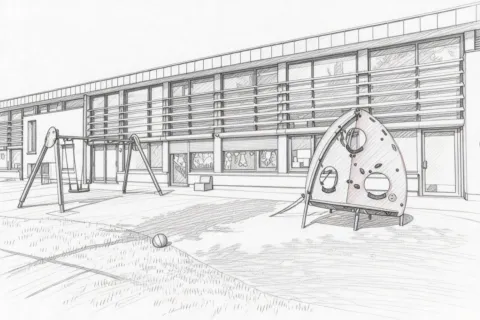Midjourney X What's up doc
La HAS publie ses recommandations dans la prise en charge du sepsis du nouveau-né, de l’enfant et de l’adulte. « L’ensemble des acteurs concernés par la prise en charge de la maladie ont élaborés ces recommandations dans le but d’améliorer le pronostic du sepsis par l’intermédiaire d’un parcours de soins intégré impliquant la ville et l’hôpital et couvrant la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et la réintégration socioprofessionnelle des patients », déclare la HAS.
Les recommandations se déclinent en cinq parties : prévenir, dépister, prendre en charge, prévenir les séquelles, mieux accompagner au long cours.
Pour vos patients, il est conseillé de respecter le calendrier vaccinal, de connaître les facteurs de risque et de respecter les règles d’hygiène. Si le sepsis est inévitable, c’est à vous de gérer et la HAS vous guide.
Mieux dépister
Pour dépister efficacement, il y a des différences entre enfant et adulte.
Chez l’enfant, les signes à rechercher incluent des troubles de conscience ou un changement de comportement, pouvant témoigner d’une atteinte neurologique. Une mauvaise perfusion périphérique, une augmentation de la fréquence respiratoire et une tachycardie, une baisse de la pression artérielle, ainsi que l’apparition et l’extension de purpura ecchymotique ou nécrotique, sont aussi significatifs.
Chez l’adulte, l’évaluation repose sur la présence d’au moins trois des six critères suivants : un âge supérieur à 65 ans, une température corporelle au-delà de 38°C, une pression artérielle systolique inférieure ou égale à 110 mmHg, une fréquence cardiaque excédant 110 battements par minute, une saturation en oxygène inférieure ou égale à 95 %, et des troubles des fonctions supérieures.
Mieux prendre en charge
Une prise en charge précoce du sepsis repose sur une action rapide et coordonnée. En ville, la HAS vous recommande de contacter immédiatement le 15 et d’éviter tout examen complémentaire chez l’enfant.
Chez l’adulte présentant un facteur de risque de sepsis, des prélèvements tels que des hémocultures (au moins 40 ml répartis dans deux ou trois paires de flacons aérobie et anaérobie), un ECBU et/ou un ECBC peuvent être réalisés en ambulatoire.
Le transport médicalisé vers un établissement disposant de soins critiques doit être systématique, quel que soit l’âge du patient.
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/expert-visiteur-pour-la-has-un-poste-de-terrain
À l’hôpital, un protocole standardisé doit être appliqué dans la première heure, incluant la pose d’une voie d’abord veineuse ou intra-osseuse, la réalisation d’hémocultures et du dosage du lactate, ainsi qu’une antibiothérapie intraveineuse adaptée.
La restauration de l’hémodynamique repose sur une prise en charge individualisée, avec un remplissage vasculaire rapide (10 à 20 ml/kg en 15-20 minutes) et l’introduction d’agents vaso-inotropes si nécessaire. En cas de non-résolution des signes cliniques après le traitement initial, l’admission en soins critiques est requise, en respectant les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign.
Mieux soigner au long terme
Pour prévenir les séquelles, un programme de réadaptation doit être initié dès les 48 premières heures d’hospitalisation, suivant une progression en six étapes, allant de la mobilisation passive à la déambulation.
Une réadaptation respiratoire est recommandée en cas de sepsis pulmonaire ou de ventilation artificielle. Ensuite, la prise en charge doit être adaptée et, si nécessaire, une orientation vers une structure de réadaptation doit être organisée par une équipe MPR ou une équipe référente.
En phase post-aiguë, l’orientation des patients vers des structures adaptées doit inclure une équipe pluridisciplinaire (kinésithérapeute, ergothérapeute, psychologue, etc.), avec un suivi ambulatoire sécurisé et coordonné.
Une consultation de suivi dans les trois mois suivant la sortie d’hospitalisation est essentielle. L’accompagnement au long cours inclut une évaluation psychologique systématique après le retour à domicile, un recours aux services d’aide sociale pour les patients en situation précaire, ainsi qu’un suivi clinique post-sepsis à trois mois et un an après l’hospitalisation.
A voir aussi

 Au CHU de Rennes, un bloc opératoire connecté au service de la sécurité et de la formation
Au CHU de Rennes, un bloc opératoire connecté au service de la sécurité et de la formation
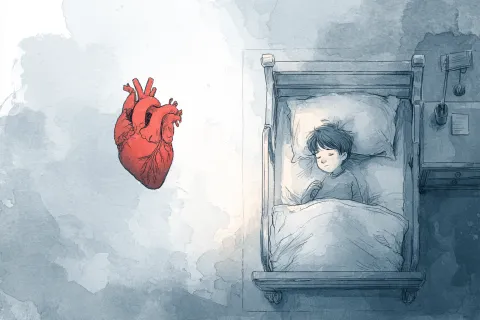
 Un enfant italien est décédé après une greffe cardiaque, les conditions de transport de l'organe mises en cause
Un enfant italien est décédé après une greffe cardiaque, les conditions de transport de l'organe mises en cause
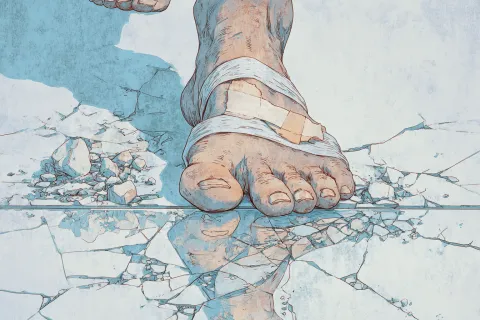
 Complications du diabète : 44 % d'amputations en plus dans les communes défavorisées
Complications du diabète : 44 % d'amputations en plus dans les communes défavorisées

 68 021 décès prématurés liés au tabagisme en 2023, malgré un léger recul
68 021 décès prématurés liés au tabagisme en 2023, malgré un léger recul

 SONDAGE : Excellence en santé : ce que les médecins jugent possible aujourd’hui… pour toutes les générations
SONDAGE : Excellence en santé : ce que les médecins jugent possible aujourd’hui… pour toutes les générations
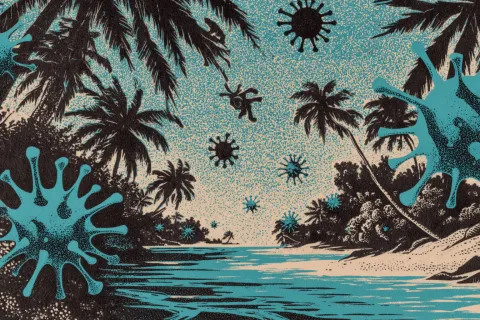
 Neuf cas de mpox recensés à Mayotte mais la situation reste « peu inquiétante » selon l'ARS
Neuf cas de mpox recensés à Mayotte mais la situation reste « peu inquiétante » selon l'ARS