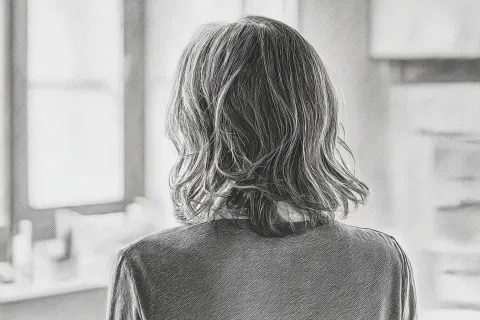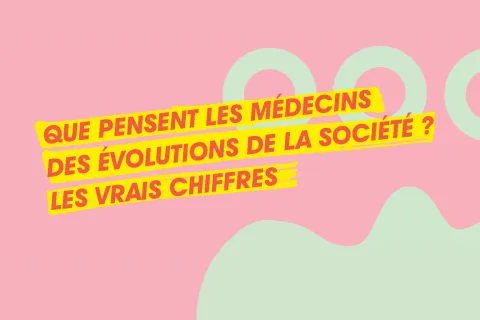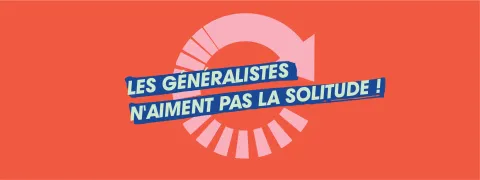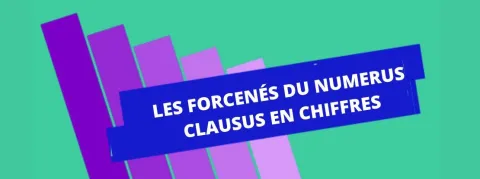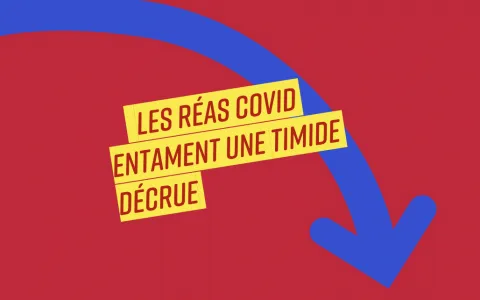Grand format
Grand format
What’s up Doc : Votre dernier ouvrage s’appelle Le Laboureur et les mangeurs de vent, titre poétique mais un rien énigmatique. Pouvez-vous nous l’expliquer ?
Boris Cyrulnik. Le mangeur de vent, c’est celui qui répète les stéréotypes, qui se laisse prendre par un courant majoritaire d’idée. Cela a pour lui un effet bénéfique : il n’a que des copains. C’est ce que j’appelle la chorale des perroquets, dont on a de nombreux exemples, y compris dans le champ médical, où des courants que l’on peut qualifier de criminels ont été déclenchés par des mangeurs de vent. Je rappelle par exemple qu’en 1949 un prix Nobel a été décerné au Dr Egas Moniz qui avait eu l'idée de traiter les patients psychiatriques par la lobotomie. Les universitaires discutaient tranquillement des meilleures techniques, de l’endroit par lequel il fallait passer pour atteindre le cerveau, certains utilisaient même un pic à glace…
Et les laboureurs ?
BC. Ce sont ceux qui, à l’inverse des « suiveurs », gardent leur liberté intérieure. Ils sont minoritaires, car ils ne souscrivent pas à la doxa. C’est par exemple ce qu’a fait Hannah Arendt quand elle a expliqué qu’Adolf Eichmann n’était pas un monstre, que ce n’était un petit monsieur sous l’emprise d’une doctrine qu’il n’avait jamais mise à l’épreuve de la réflexion. Quand elle a dit cela, Arendt a déclenché un véritable scandale : il était difficile d’accepter ce qu’elle appelait « la banalité du mal », mais elle avait raison.
Et vous, vous êtes un laboureur ?
BC. Oui, mais ce n’est pas volontaire. Dès l’enfance, j’ai éprouvé le plaisir de mettre en doute, de vérifier. Ce n’était pas un soupçon contre mon entourage, c’était la peur de me laisser embarquer par le vent de la doxa. C’est comme cela que j’ai quitté les Jeunesses communistes révolutionnaires à 16 ans, après un voyage à Bucarest où ce que j’avais vu ne correspondait pas à ce qu’on me disait de voir. J’ai alors perdu tous mes amis. Plus tard, quand j’ai fini médecine, j’ai refusé de choisir entre ceux qui disaient que la biologie explique tout et ceux qui disaient que la psychanalyse explique tout. J’ai encore une fois perdu tous mes amis.
Est-ce aussi ce penchant pour le labourage qui vous a incité à choisir les études de médecine plutôt que Sciences-Po, autre option que vous envisagiez ?
BC. Si j’avais été équilibré, j’aurais fait Sciences-Po, ou une école de cinéma, qui me faisait également envie. Par ailleurs, il n’y avait alors pas de concours à Sciences-Po, ce qui me tentait bien, alors que je savais bien qu’en médecine, on avait sans arrêt des examens et des concours (rires). Mais je n’étais pas équilibré, et j’avais besoin d’un diplôme qui me sécurise. Or la médecine est un métier qui permet d’être accepté.
Quels souvenirs gardez-vous de vos études de médecine, que vous avez effectuées à Paris ?
BC. Avant 1968, la médecine était une médecine de grands patrons, très hiérarchisée. Si on devait parler au patron, on passait par le chef de clinique, qui demandait au patron, qui répondait au chef de clinique, qui nous donnait la réponse… Tout cela alors que le fameux patron était à un mètre de nous ! Mais je dois également dire que la médecine était aussi une médecine de laboureur, et elle l’est peut-être encore : on nous enseignait quelque chose qui marchait très bien sur le papier : si on avait tel résultat au labo, il fallait faire ceci, et hop, le patient était guéri… Mais dans la réalité, nous avions un savoir qui était au moins autant issu de notre expérience que de l’enseignement de nos professeurs.
C’est aussi une période où vous avez exercé différents métiers…
BC. Oui, j’ai fait mes études de médecine en travaillant. J’ai été laveur de carreaux, maître-nageur sauveteur, vendeur sur les marchés aux puces… J’arrivais souvent en cours après avoir fait un effort physique qui était l’équivalent d’un jogging, et je retrouvais des camarades qui sentaient encore le café au lait et les croissants. J’ai arraché mes études, mais je n’étais pas forcément très brillant : ce n’était pas facile d’étudier des choses qui me paraissaient parfois dépourvues de sens après avoir lavé des carreaux de 5 heures à 8 heures du matin.
Pourquoi avez-vous choisi la psychiatrie ?
BC. La raison remonte à mon enfance. À la libération, j’ai beaucoup entendu les adultes dire qu’Hitler avait une syphilis méningée, qu’il était paranoïaque, et que c’est ce qui avait déclenché la guerre. Je trouvais cela stupide, je ne voyais pas en quoi la maladie d’un homme pouvait déclencher le suivisme de dizaines de millions d’autres. Et je me disais que lorsque je serais grand, je serais psychiatre, pour expliquer la véritable raison de la guerre.
Et pourtant, la psychiatrie d’alors ne ressemblait pas à celle que nous connaissons aujourd’hui…
BC. C’est vrai. Je me souviens qu’alors que j’hésitais encore sur ma spécialité, j’ai pu visiter un service de psychiatrie en banlieue parisienne : il n’y avait pas de lit, les patients dormaient sur la paille, et j’ai vu de mes yeux les infirmiers enlever et remettre la paille le matin avec des fourches. Les rapports avec les malades étaient des rapports de violence : quand on ouvrait une porte, il fallait vérifier si un malade n’allait pas nous sauter dessus…
Comment se sont passées les premières années de votre exercice professionnel ?
BC. Je n’étais pas bien classé à l’internat, je ne pouvais pas choisir un CHU, et je suis donc allé à Digne. J’y allais un peu à reculons, mais j’y ai passé les plus belles années de mon métier. On était des utopistes, mais pas des mangeurs de vent. Les malades mentaux étaient encore considérés comme incurables, mais on pensait qu’on allait les guérir… et on l’a fait.
C’est aussi l’époque où vous avez commencé à travailler sur l’éthologie…
BC. Oui, j’ai commencé par faire des résumés de congrès dans l’Encyclopédie médico-chirurgicale, et je suis entré dans le milieu éthologique, qui était très restreint à l’époque. Je peux même dire que j’ai d’emblée fait partie des meilleurs éthologues de France, ce qui n’était pas très difficile car nous n’étions qu’une poignée (rires).
Et comment avez-vous commencé à parler au grand public ?
BC. Par nécessité. Il n’y avait pas de circuit d’éthologie humaine, et comme la psychiatrie de l’époque nous demandait de choisir entre la pharmacie et le divan, j’ai d’emblée fait des publications non académiques. Ce n’est pas ce qui permet de grimper dans la hiérarchie, mais j’ai tout de même pu prendre un poste de chef de service près de Toulon, puis j’ai été invité à participer à l’enseignement à Marseille, en Belgique… C’est comme cela que j’ai pu dire ce que j’avais envie de dire, et que j’ai pu faire mon chemin un peu en marge du monde académique.
On dit que l’un de vos grands apports en éthologie est d’avoir vulgarisé le concept de résilience… Comment cela vous est-il venu ?
BC. Je ne l’ai pas vulgarisé, j’y ai travaillé, avec quelques autres. Comme c’est souvent le cas, quel que soit le domaine de recherche, ma motivation était en partie autobiographique. Quand j’étais enfant, on m’a beaucoup dit que, n’ayant pas de famille (les parents de Boris Cyrulnik sont morts en déportation, NDLR), je n’aurais aucune possibilité de faire des études et de réaliser mes rêves. Cela me blessait. Plus tard, quand je me suis occupé de La Salvate, qui est un service de postcure pour femmes à Toulon, j’entendais dire que mes patientes ne guériraient jamais, car un schizophrène qui guérissait n’était pas vraiment un schizophrène. J’étais choqué, et je voulais trouver une nouvelle manière de poser le problème des souffrances psychiques.
Comment réagissez-vous face à la situation de l’hôpital, que vous avez quitté en 1991 mais que vous continuez à côtoyer ?
BC. J’ai récemment assisté à un congrès d’internes, et j’ai été frappé par le désespoir des jeunes médecins. Je crois que ce désespoir vient de la dictature administrative, que j’ai moi-même eu à subir. À Toulon, quand je voulais faire un scanner, le directeur exigeait un tampon de l’administration pour l’autoriser, tampon que je n’ai d’ailleurs jamais demandé. De même, on nous demandait d’envoyer des doubles des arrêts de travail, ce que je n’ai pas fait davantage. Mais c’est pour cela que j’ai démissionné en 1991, pour travailler uniquement en libéral, tout en continuant mes activités d’enseignement.
Comment voyez-vous l’évolution de la situation du système de santé ?
BC. Je pense que dans les mois et années qui viennent, il va y avoir un grand chamboulement, comme c’est le cas après chaque période de catastrophe. Or nous avons eu une catastrophe sanitaire, qui va se doubler d’une catastrophe économique et sociale avec la guerre en Ukraine. Si nous arrivons à fonctionner de manière démocratique, cela pourrait être une occasion de repenser la manière dont fonctionnent les soins. Avec le virus, on a bien vu comment les économies qui ont été imposées au système de santé depuis des années ont en réalité coûté terriblement cher.
Dans ces conditions, que faut-il faire ?
BC. Une réforme est inévitable, il va falloir envisager les soins non seulement sous l’angle de la médecine, mais aussi sous l’angle de la prévention, de l’éducation, de la culture… Car plus on développera l’éducation, notamment chez les plus jeunes, moins on aura de troubles psychopathologiques à l’adolescence. C’est d’ailleurs pour cela que je me suis engagé, à la demande du Président de la République, dans le comité sur les 1 000 premiers jours de la vie. Si on rate ces 1 000 premiers jours, ce qui est le cas pour 1 enfant sur 3, cela coûte terriblement cher et cela fait énormément de malheureux. Pour cela, il faudra une nouvelle médecine, qui doit notamment être capable d’associer des non-médecins.
La santé aurait-elle, plus que jamais, besoin de laboureurs ?
BC. Vous m’avez entendu penser !

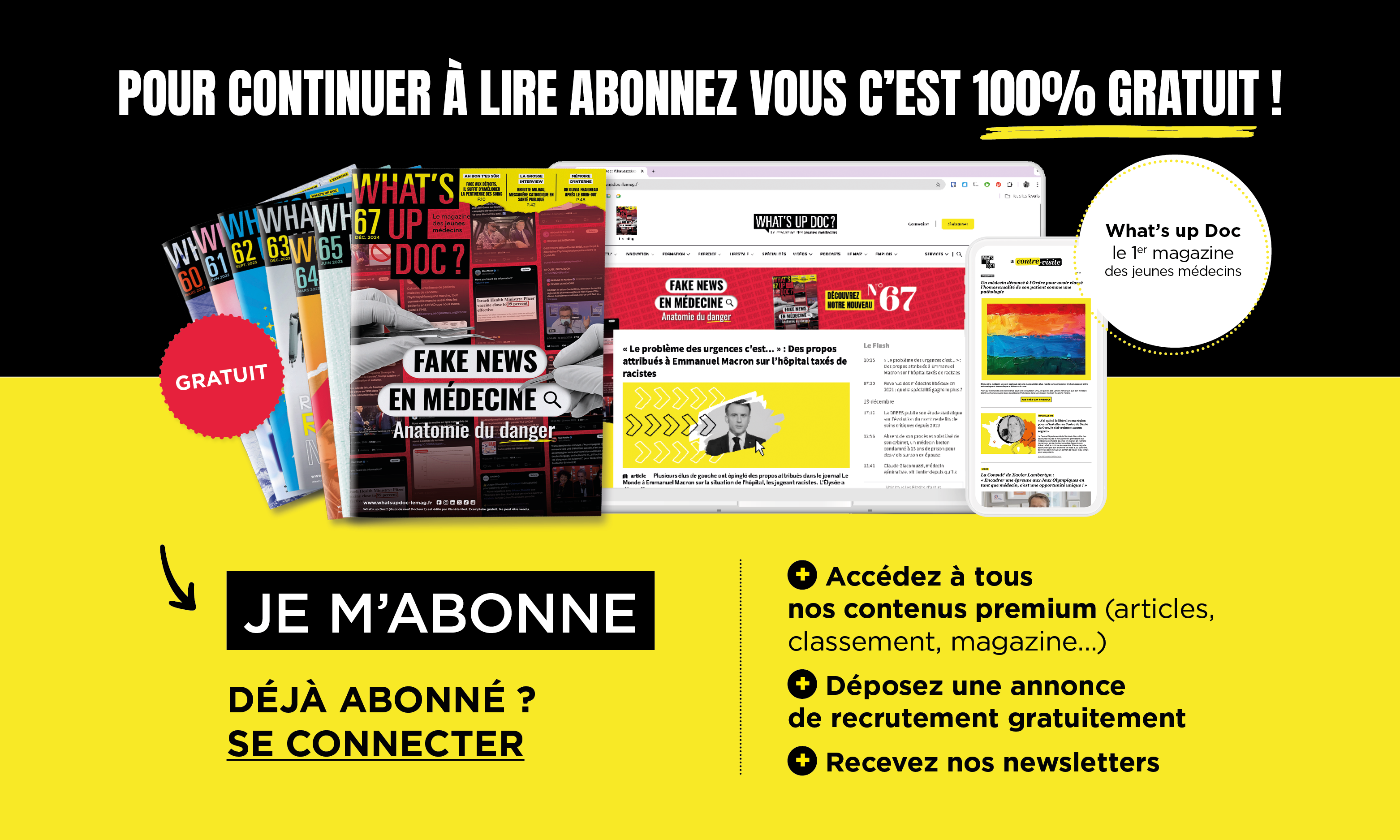

 Hausse de 5,33 % du revenu des médecins en 2024 : à relativiser selon la CARMF
Hausse de 5,33 % du revenu des médecins en 2024 : à relativiser selon la CARMF

 Cotisations ordinales 2026 : la facture s’alourdit pour les médecins en société
Cotisations ordinales 2026 : la facture s’alourdit pour les médecins en société

 La santé mentale au travail s'améliore un peu, sans retrouver son niveau d'avant-Covid
La santé mentale au travail s'améliore un peu, sans retrouver son niveau d'avant-Covid

 « Notre système est incapable de financer l’innovation » : Depuis Bruxelles, les médecins de bloc en exil interpellent le gouvernement
« Notre système est incapable de financer l’innovation » : Depuis Bruxelles, les médecins de bloc en exil interpellent le gouvernement

 Malgré la grève, la grippe et les intempéries, l'hôpital tient bon, dixit la FHF
Malgré la grève, la grippe et les intempéries, l'hôpital tient bon, dixit la FHF