
What’s up Doc. Vous avez étudié la médecine au Burundi dans les années 1970. Comment le cursus se passait-il ?
Denis Mukwege. Quand j'ai commencé mes études, la faculté de médecine de Bujumbura était soutenue par les coopérations française et belge. La plupart de nos enseignants venaient de l’école du Pharo, à Marseille (école militaire spécialisée en médecine tropicale et fermée en 2013, ndlr). En plus d’être professeurs de médecine, ils étaient colonels, ou même généraux de l’armée française. La formation était de très bonne qualité.
WUD. Bien qu’il n’en soit pas éloigné, le Burundi n’est pas votre pays d’origine. Comment le Congolais, ou plutôt le Zaïrois que vous étiez s’est-il retrouvé là-bas ?
DM. J’avais essayé de m’inscrire à la faculté de médecine de Kinshasa, mais cela n’a pas été possible et je me suis retrouvé à la faculté polytechnique (école d’ingénieurs de Kinshasa, ndlr). J’y ai passé deux ans, bien que cela ne corresponde pas du tout à ma vocation. J’ai fini par quitter Kinshasa pour avoir ce que je voulais.
WUD. L’orientation des élèves se faisait donc alors indépendamment de leurs souhaits ?
DM. Oui, il y avait des quotas par province, et les affectations dépendaient des disponibilités. La faculté de médecine était très demandée, et il n’y en avait qu’une, à Kinshasa. Les places étaient très limitées, et c’est comme cela que j’ai atterri en polytechnique.
WUD. D’où venait votre envie d’étudier la médecine ?
DM. C'est lié à quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais très jeune, à l’âge de 8 ans. J’accompagnais souvent mon père, qui était un pasteur protestant, au cours des tournées qu’il effectuait auprès des malades dans le cadre de son ministère. Un jour, alors qu'il rendait visite à un enfant, j'ai été très touché par le fait de le voir prier pour cet enfant sans pouvoir le soigner. Je lui ai dit que quand j’étais malade, il priait pour moi, mais il me donnait aussi des médicaments. C’est ainsi que j'ai décidé d’apprendre la médecine. Je voulais compléter ce que mon père faisait, être le médecin qu’il ne pouvait pas être, résoudre le problème qu’il ne pouvait pas résoudre. Toutes mes études ont été faites dans cette orientation. Je ne me voyais pas faire autre chose.
WUD. Comment êtes-vous venu à la gynécologie, qui n’est pas votre spécialité initiale ?
DM. J’ai effectivement fait ma thèse en pédiatrie, sur la vaccination des nouveau-nés contre l’hépatite virale B. J'étais revenu au Congo avec cette orientation pédiatrique. Je travaillais à Lemera, dans un hôpital très isolé des hauts plateaux du Sud-Kivu (Est de la RDC, alors appelée Zaïre, ndlr). C’est là que j'ai découvert que les femmes souffraient terriblement. Chaque jour, j'enregistrais des morts maternelles. Il s’agissait souvent de femmes qui venaient de très loin, transportées à dos d'âne pour venir accoucher à l'hôpital. Quand elles arrivaient, beaucoup avaient tellement saigné qu’il n’y avait plus rien à faire. J’ai réalisé que je ne pouvais pas m’occuper des enfants si les femmes n’étaient pas vivantes.
WUD. Et c’est ce qui a guidé vos pas vers la France.
DM. Oui. En 1984, j’ai décidé de faire ma spécialité en gynécologie-obstétrique à Angers. Je suis revenu au Congo cinq ans après. J’ai commencé à organiser la zone où je travaillais, avec des centres où les femmes pouvaient être prises en charge si nécessaire. Avec l’association France-Kivu d’Angers, nous avons aussi construit quelques centres de santé, et une école de sages-femmes.
WUD. Puis la guerre est arrivée
DM. Oui. En 1996, tous ces efforts ont été réduits à néant. Un jour où j’étais absent pour évacuer un malade, des soldats ont détruit l’hôpital, les malades ont été tués dans leur lit, des infirmiers ont été massacrés, tout le monde a dû fuir… C’est le drame de ma vie. Quand on tue vos malades, on vous assassine presque. J’ai eu du mal à recommencer mon métier après cela. Pendant presque deux ans, je n’étais pas bien.
WUD. Mais vous avez repris votre stéthoscope…
DM. Oui. J’étais à Bukavu, la capitale du Sud-Kivu, et je voyais que même en pleine ville, les infrastructures étaient insuffisantes pour prendre en charge les femmes lorsque c’était nécessaire. J’ai donc pris mon courage à deux mains, et j’ai commencé à faire des accouchements et des césariennes sous une tente. Je voulais seulement être utile en faisant des opérations qui ne nécessitaient pas un équipement sophistiqué.
WUD. Comment avez-vous découvert l’utilisation du viol comme arme de guerre ?
DM. Il se trouve que la première femme que j’ai soignée sous cette tente n’était pas venue pour accoucher, mais parce qu’elle avait été violée à 500 mètres de l'hôpital. Ses violeurs avaient intentionnellement détruit son appareil génital. Ils ne voulaient pas la tuer, sinon ils auraient pu tirer dans la tête. C'était le 1er septembre 1999. Je croyais que c'était un cas isolé. En réalité, il y en a eu des milliers, et nous faisions face à une pratique systématique. Je ne m’imaginais alors pas l’ampleur que le drame allait prendre. Dix-huit ans après, le drame est toujours là.
WUD. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la prise en charge des victimes, dont vous êtes malgré vous devenu un spécialiste ?
DM. Ces mutilations portent surtout atteinte à la continence urinaire. Nous réparons donc la vessie pour restaurer le mécanisme de continence. Lorsque les lésions touchent le rectum, la femme perd les matières fécales et nous réparons l’organe pour que la femme puisse être continente. C’est parfois l’appareil génital qui est détruit, ce qui ne permet plus l'acte sexuel. Nous faisons alors des plasties génitales.
WUD. Que sont devenues les tentes de 1999 ?
DM. Elles ont été pillées. Nous avons réhabilité deux vieilles maisons situées à huit kilomètres au sud de Bukavu. Elles appartenaient à l'armée, et nous y avons continué nos activités. Nous avons construit un bâtiment après l'autre, nous avons aujourd’hui une capacité de 450 lits, et l’hôpital est maintenant connu sous le nom d’hôpital de Panzi.
WUD. Est-ce parce qu'il n'est pas possible de travailler correctement au sein du système de santé congolais que vous avez dû construire votre propre hôpital ?
DM. Je tiens à préciser que je suis un médecin de l’Etat congolais. L'hôpital de Panzi a été construit sous notre impulsion, mais ce n'est pas un hôpital privé. Il joue le rôle de l'hôpital général de référence dans une zone de santé appelée Ibanda.
WUD. Vous avez tout de même accès à des fonds que d'autres hôpitaux n'ont pas…
DM. Aucun hôpital congolais ne reçoit de subside de l’Etat. Nous avons, comme les autres, des fonds qui proviennent de différentes organisations.
WUD. Quels sont les principaux problèmes rencontrés par les médecins congolais ?
DM. La question principale est celle de l'accès aux soins. Vous avez des malades, vous savez comment les prendre en charge, mais ils ne peuvent pas payer les examens complémentaires, les les médicaments, ou les interventions chirurgicales. Aujourd’hui nous traitons toutes les victimes de violence sexuelle gratuitement. C’est également le cas pour les personnes vivant avec le VIH, ou avec les enfants mal nourris. Mais nous n’avons pas les moyens de faire de même pour les autres malades. Je vous rappelle que nous ne recevons aucun soutien de l’Etat congolais.
WUD. Comment se fait-il qu’un Etat comme la RDC, richissime au moins en théorie, ne soutienne pas davantage son système de santé ?
DM. C'est lié à la mauvaise gouvernance, comme dans beaucoup de pays africains. Les gouvernants sont une petite classe qui va se faire soigner à Paris ou à Bruxelles. Notre Constitution garantit à tous les soins de santé primaires. Mais la corruption fait qu'une infime minorité a tout, tandis que la majorité croupit dans une misère noire.
WUD. Voilà des propos bien politiques… Pourquoi voit-on le médecin que vous êtes prendre de plus en plus position dans le débat public congolais ?
DM. Beaucoup d'intellectuels congolais pensent que la politique est réservée à certaines personnes, et que les autres doivent subir. Mais je ne peux pas me résigner : j’estime qu’en tant que citoyen, en tant qu’intellectuel, je dois dire ce qui ne marche pas dans mon pays. Malheureusement, dès que vous donnez votre opinion sur un thème ou un autre, on vous pose une étiquette et des stéréotypes. Or qui va parler, si le médecin ne parle pas ? Je suis en contact permanent avec la population, et je vois qu’elle souffre. Comme médecin, je donne ma voix aux malades. C'est un devoir citoyen, pas de la politique politicienne.
WUD. Dire, comme vous avez pu le dire, que le président de la République doit partir, cela fait donc partie de votre rôle de médecin ?
DM. Rien de plus normal qu’un médecin s’exprime quand il n’est pas d’accord avec le système. Je connais des confrères français qui ont une opinion sur le pouvoir en France, et qui l’expriment. Il n’y a pas de devoir de réserve, et on voit d’ailleurs souvent les soignants français dans la rue. J’exprime donc mon point de vue sur le pouvoir congolais.
WUD. On vous a prêté l’intention de briguer les suffrages pour le scrutin présidentiel en cours. Etaient-ce de simples rumeurs ?
DM. Il y a un fait : je ne suis pas candidat, à quelque niveau que ce soit. Je suis un citoyen libre, qui utilise sa liberté d'expression et de pensée pour amener la société à un changement positif. Je l'ai fait, quelle que soient les intentions que l'on peut me prêter.
Bio express
1955. Naissance à Bukavu (RDC, alors appelée Congo belge)
1983. Diplômé de la faculté de médecine de Bujumbura au Burundi.
1986. Spécialisation en gynéco-obstétrique à Angers
1996. L’hôpital qu’il dirige à Lemera est détruit lors de la 1ère guerre du Congo.
1999. Découvre le problème du viol comme arme de guerre et fonde l’hôpital de Panzi
2018. Reçoit le prix Nobel de la paix avec la militante yézidie Nadia Mourad
Biblio express
2016. Plaidoyer pour la vie, Editions de l’Archipel
2014. Panzi, Editions du Moment (avec Guy-Bernard Cadière)
A voir aussi

 Traitement contre le VIH : le Kenya, quatrième pays africain à déployer le Yeztugo
Traitement contre le VIH : le Kenya, quatrième pays africain à déployer le Yeztugo
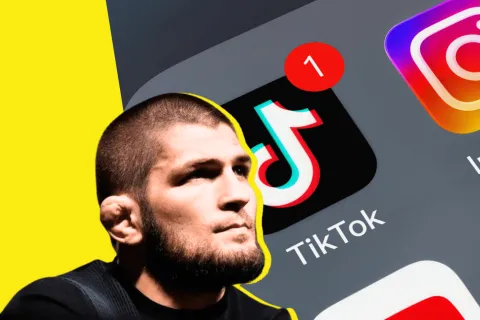
 La mode des oreilles « en chou-fleur » sur les réseaux sociaux inquiète les médecins
La mode des oreilles « en chou-fleur » sur les réseaux sociaux inquiète les médecins

 James Van Der Beek, éternel Dawson, est mort à 48 ans d’un cancer colorectal : un signal d’alarme pour la prévention médicale
James Van Der Beek, éternel Dawson, est mort à 48 ans d’un cancer colorectal : un signal d’alarme pour la prévention médicale











