
What's up Doc : Vous êtes souvent perçu comme un défenseur de la psychiatrie. En quoi celle-ci a-t-elle besoin d'être défendue, alors qu’on connaît peu de défenseurs de la cardiologie ou de la gastroentérologie, par exemple ?
Pr Antoine Pelissolo. Au départ ce n’était pas un projet conscient, volontaire, cela s’est fait progressivement. J’ai commencé par parler dans les médias des sujets de santé mentale, pas des questions de moyens. Mais le contexte général, les problèmes que nous rencontrons en tant que professionnels, et donc ceux que les patients rencontrent, m’ont naturellement orienté vers des interventions plus militantes. Dans mon esprit, il s’agit de défendre la psychiatrie tout autant que l’hôpital public, dont elle est en quelque sorte le parent pauvre.
On utilise en effet
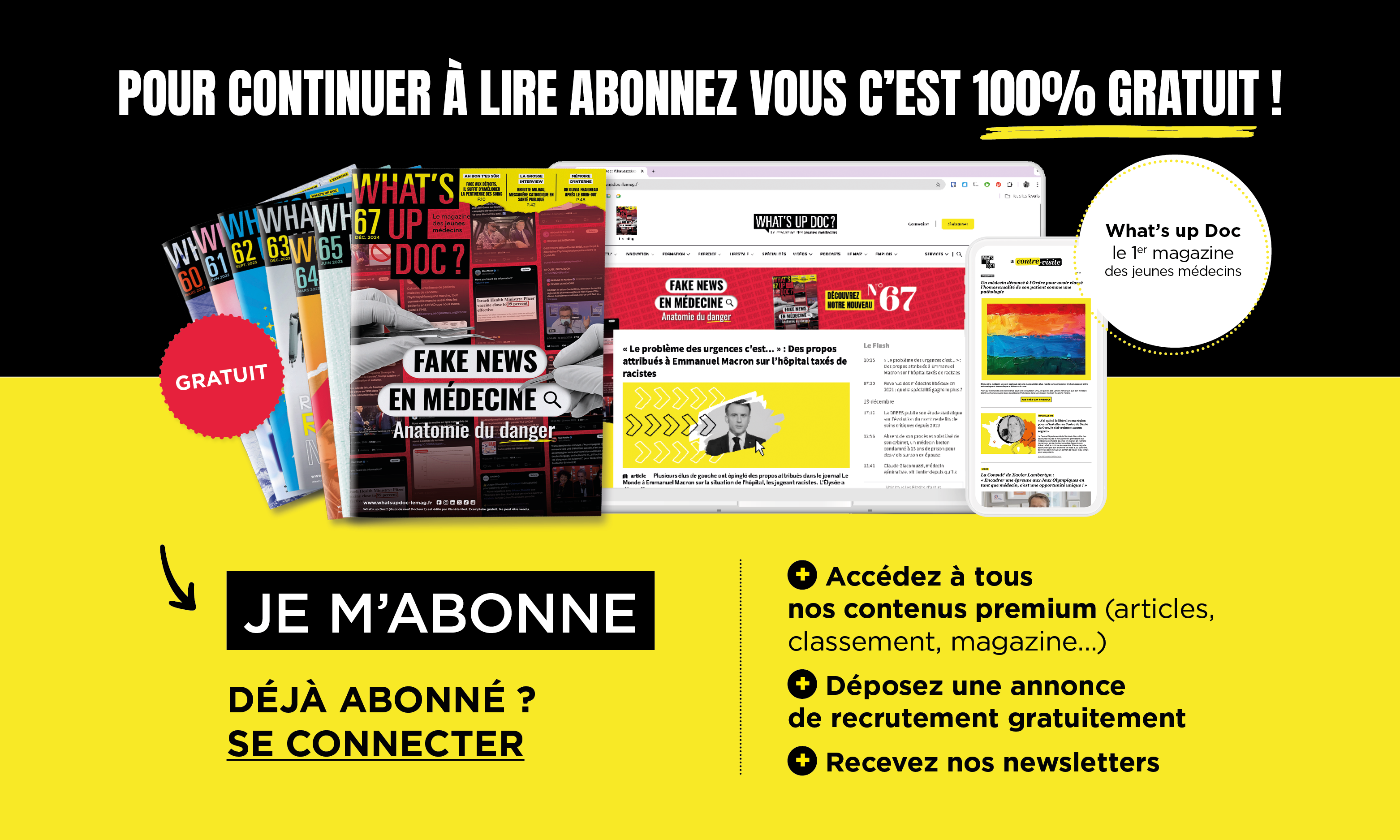
A voir aussi







