
© Midjourney x What's up Doc
1 581 déclarations d'incidents, soit près de 5 par jours. Ce chiffre, collecté par l’observatoire de la sécurité du CNOM, en collaboration avec IPSOS, représente une hausse de 27% par rapport à 2022.
Et cette augmentation de la violence n’est pas récente. À bien regarder les statistiques, les médecins subissent trois fois plus d’agressions qu’il y a 20 ans, date de la création de cet observatoire.
Et pourtant, « C’est seulement la face visible de l’iceberg, la majorité des médecins victimes d’agressions ne les déclarent pas », a commenté ce matin le Dr Jean-Jacques Avrane, coordonnateur de l’observatoire, lors d’une conférence de presse.
Un silence que le généraliste impute à un excès d’empathie des médecins : « ils ne veulent pas charger leur patient, ils pensent qu’ils peuvent arranger la situation eux-mêmes ».
Les femmes médecins sont plus agressées que les hommes
Les femmes médecins sont, comme l’année d’avant, les plus sujettes aux violences (56%, alors que la profession est globalement paritaire).
Dans 62% des cas, les violences sont commises par le patient lui-même, dans 16% par un accompagnant et dans 13% par une autre personne inconnue du cabinet (membre de la famille, patient d’un autre cabinet).
Comme les années précédentes, les généralistes, « en première ligne », sont largement plus visés avec 64% des cas déclarés.
Parmi les autres spécialités, ce sont les psychiatres qui sont les plus touchés, probablement « en raison de la population médicale qui est plus difficile à gérer ». Viennent ensuite dans l’ordre les ophtalmos, les médecins de travail et les dermatos.
En règle générale, « ce sont des spécialités qui ont parfois des délais d’attente très longs, ce qui peut expliquer, pas justifier, les incidents », analyse Jean-Jacques Avrane.
De la violence verbale dans la grande majorité des cas
Si les temps d’attentes jugées excessifs concernent 10% des incidents recensés, les motifs de violences les plus fréquents concernent la prise en charge médicale (38%). Les refus d’ordonnances comptent pour 19% et les falsifications de documents pour 12%.
Comme l’année d’avant, la région Hauts-de-France, qui compte beaucoup de médecins, est la plus touchée. Mais en rapportant le nombre d’incidents au nombre de médecins, ce sont des territoires comme le Cher ou la Charente-Maritime qui arrivent en tête.
La moitié des incidents ont lieu en centre-ville, là où on trouve le plus de médecins, mais « on note toutefois une petite augmentation des agressions en milieu rural », de 21 à 24%, note Jean-Jacques Avrane.
Dans la majorité des incidents recensés, il s’agit de violences verbales et de menaces (73%). Les violences physiques, les vols (ordonnanciers et tampons pour les plus fréquents) et les actes de vandalisme représentent tous trois environ 8%.
Mais, même si elles ne sont pas nombreuses, certaines agressions interpellent par leur gravité. 6% des agressions occasionnent une incapacité totale de travail (ITT), un chiffre stable depuis 2021.
Pourtant, la majorité des médecins victimes de violences ne donnent pas de suite judiciaire (seulement 31% portent plainte et 7% déposent une main courante).
« On aimerait que la tendance s’inverse », explique Jean-Jacques Avrane qui encourage chaque médecin à « systématiquement déclarer les incidents et déposer plainte en conséquence ».
Vers une évolution de la loi
Pour faciliter les choses, la loi est en passe d’être modifiée. Une proposition de loi portée début janvier prévoit notamment que l’employeur puisse se constituer partie civile et porter plainte à la place de la victime.
Un amendement porté par le CNOM permet également à la victime de se domicilier, sur sa plainte, à l’adresse de l'Ordre auquel il est inscrit, par peur de représailles.
Le texte prévoit également d’aggraver la sanction pénale en cas de violences, et d’élargir le délit d’outrage à tous les professionnels de santé.
Côté pratique, le CNOM œuvre également pour le développement des dispositifs de sécurité en cabinet ou à l’hôpital, où des affiches de prévention à destination des patients ont été élaborées.
Un « bouton poussoir » permettant aux professionnels de santé de signaler une situation de danger et d’obtenir de l’aide dans des délais courts a déjà été expérimenté dans plusieurs territoires du pays et pourrait être généralisé.
L’Ordre a également mis en place un « référent sécurité » dans chaque département, notamment pour aider le médecin dans les démarches administratives et judiciaires.
« Et chaque conseil départemental ordinal a signé un protocole de sécurité qui permet une meilleure coordination entre la police et les ARS dans la gestion des incidents », détaille le médecin conseiller, qui ajoute que « la hausse des violences envers les médecins se constate de manière générale à l’échelle européenne ».
En Italie, le gouvernement a adopté vendredi 27 septembre une série de mesures destinées à protéger davantage les médecins des agressions après plusieurs incidents ces dernières semaines.
A voir aussi

 Point d'étape de l'épidémie de grippe : un rebond jugé peu probable selon Santé publique France
Point d'étape de l'épidémie de grippe : un rebond jugé peu probable selon Santé publique France
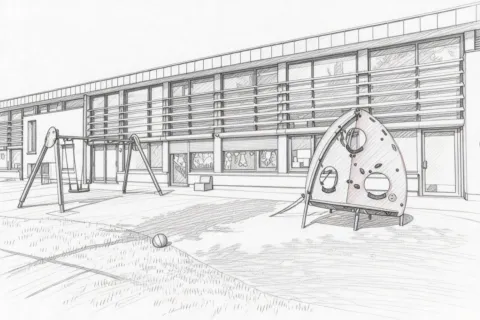
 Des enfants enfermés et maltraités en pédopsychiatrie : l’hôpital de la Fondation Vallée sous inspection de l’ARS
Des enfants enfermés et maltraités en pédopsychiatrie : l’hôpital de la Fondation Vallée sous inspection de l’ARS
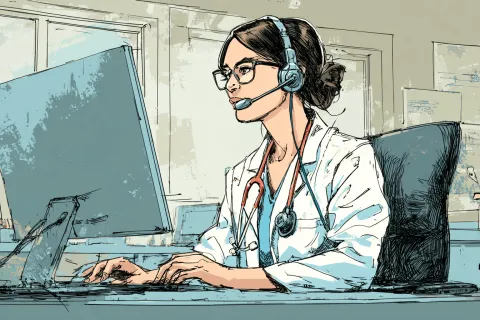
 Certains médecins pourront bientôt dépasser les 20% de téléconsultations, annonce Stéphanie Rist
Certains médecins pourront bientôt dépasser les 20% de téléconsultations, annonce Stéphanie Rist

 Urgences du CHU de Caen : la CGT alerte sur un danger grave et imminent
Urgences du CHU de Caen : la CGT alerte sur un danger grave et imminent

 Grève des médecins : un impact limité avec seulement 13,5% de baisse des feuilles de soins
Grève des médecins : un impact limité avec seulement 13,5% de baisse des feuilles de soins

 Un généraliste de 29 ans crée le premier centre multi-spécialités de suivi du diabète : « J'ai voulu en finir avec "le grand bricolage" qu'est la prise en charge du diabète »
Un généraliste de 29 ans crée le premier centre multi-spécialités de suivi du diabète : « J'ai voulu en finir avec "le grand bricolage" qu'est la prise en charge du diabète »

 Accidents du travail : 90 millions d'euros accordés pour la prévention des risques
Accidents du travail : 90 millions d'euros accordés pour la prévention des risques






