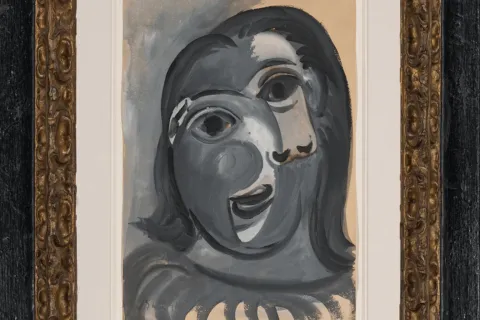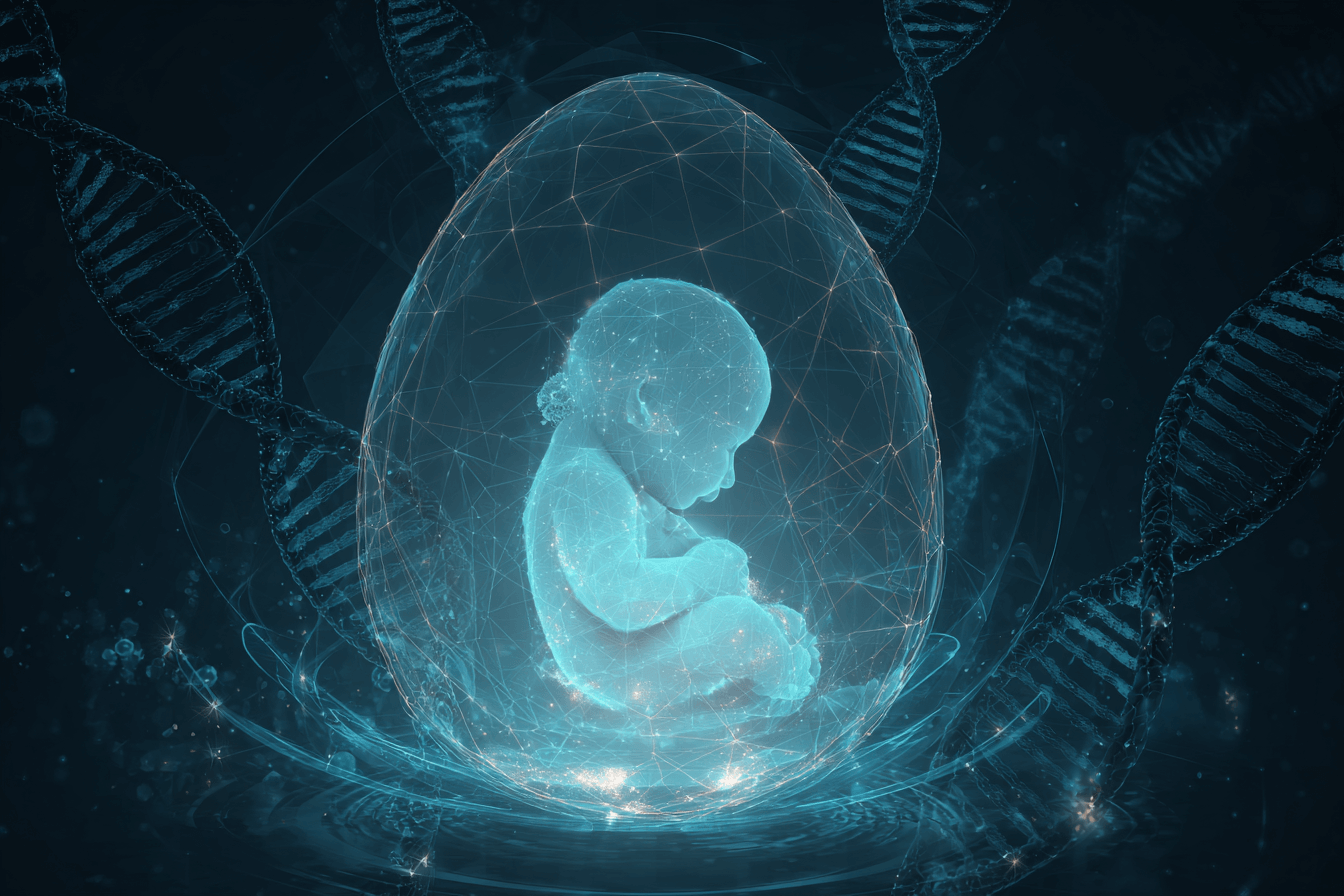
© Midjourney x What's up Doc
Dans une étude publiée mardi dans la revue Nature Communications, des chercheurs décrivent comment ils ont transformé des cellules cutanées en ovocytes capables d'être fécondés par un spermatozoïde.
C'est un pas important vers une idée qui relève pour l'heure de la science-fiction : traiter l'infertilité de certaines femmes, qui ne sont pas ou plus en mesure de produire des ovocytes, en créant ces derniers à partir d'autres cellules.
« Cela permettrait aussi à des couples du même sexe d'avoir un enfant apparenté génétiquement aux deux partenaires », avance auprès de l'AFP l'une des auteures de l'étude, Paula Amato, chercheuse à l'Oregon Health & Science University aux Etats-Unis.
L'enjeu est de taille alors que des pays, comme la France, font face à une insuffisance de dons de gamètes par rapport à la demande.
Mais Paula Amato prévient tout de suite. Il faudra au moins une dizaine d'années pour que ses recherches profitent éventuellement à des patientes infertiles.
Gamétogenèse in vitro
Son travail s'inscrit dans un champ de recherche en plein essor : la « gamétogenèse in vitro ». Il a déjà donné lieu à des avancées marquantes : début 2025, des chercheurs japonais avaient fait naître des souris de deux pères biologiques.
L'étude de Nature va cependant bien plus loin. Cette fois, ce sont des cellules humaines qui ont servi à l'expérience, au point de se développer en embryons même si ces derniers ont vite été détruits.
Les chercheurs, basés aux Etats-Unis, ont retiré les noyaux d'ovocytes, puis les ont remplacés par ceux tirés de cellules de la peau. Cette technique, dite de « transfert de noyau », est connue depuis longtemps pour permettre de cloner des animaux sans fertilisation, telle l'emblématique brebis Dolly en 1996.
Mais, ici, il s'agissait de faire en sorte que la cellule puisse être fécondée par un spermatozoïde. Cela n'est possible que si elle compte 23 chromosomes, auxquels viennent s'adjoindre les 23 du spermatozoïde.
Or, comme toutes les cellules non reproductives, celles de la peau comptent 46 chromosomes. Les chercheurs en ont donc retiré la moitié, via une technique qu'ils ont baptisée « mitoméiose ».
Puis, ils ont tenté de fertiliser ces cellules avec des spermatozoïdes. Sur ces candidats ovules, une petite dizaine se sont développés en embryons de quelques jours, un stade théoriquement suffisant pour les implanter chez une patiente lors d'une fécondation in vitro.
Entre espoirs scientifiques et craintes éthiques
Reste que ces embryons comprenaient de nombreuses anomalies, signe que la recherche n'en est qu'au stade de l'expérience de laboratoire et non d'une avancée médicale concrète.
Mais ces résultats sont suffisamment majeurs pour susciter l'engouement de plusieurs chercheurs. C'est une avancée « enthousiasmante » qui pourrait « ouvrir un jour la voie à la création de cellules semblables aux ovocytes et aux spermatozoïdes pour ceux qui n'ont pas d'autre choix », a jugé la chercheuse Ying Cheon, spécialiste en médecine de la reproduction à l'université britannique de Southampton, dans une réaction à l'organisme Science Media Centre.
D'autant que d'autres scientifiques suivent une voie différente mais aussi prometteuse : ils cherchent plutôt à « reprogrammer » des cellules non reproductives, pour les ramener à un stade où elles seraient indifférenciées, c'est-à-dire pas encore devenues spécifiquement des cellules de la peau, du cœur, du cerveau... Là encore, la promesse est de s'en servir pour créer un ovocyte capable de générer un embryon.
Et toutes ces recherches sont suffisamment avancées pour que des régulateurs se posent déjà la question du cadre à donner un jour à une telle avancée médicale, à l'instar en France de l'Agence de biomédecine.
Celle-ci, dans une publication jeudi sur son site, estime que la création artificielle de gamètes « pourrait profondément bouleverser le paysage de la reproduction humaine ».
Elle est « susceptible de modifier, en profondeur, la dynamique de formation des familles, les normes sociales autour de la reproduction, et les liens génétiques qui les sous-tendent », estime cette agence publique.
Craignant un risque d'« eugénisme » au vu du grand nombre d'embryons qu'une telle technique permettrait de générer, elle appelle à « la mise en place d’un cadre éthique et juridique international (...) pour éviter une course à l'innovation non régulée ».
Avec AFP