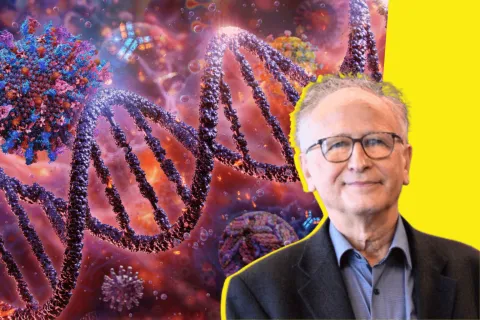iStock
Sous son air de fleur toute simple, la pervenche de Madagascar cache de grands pouvoirs. Originaire de l’île de Madagascar, cette jolie plante vivace aux pétales roses ou blancs, d’abord nommée Vinca rosea puis reclassifiée Catharanthus roseus, n’est pas seulement une vedette ornementale dans nos parcs en France. Elle est à l’origine de médicaments essentiels, notamment en cancérologie.
Une plante de médecine traditionnelle
Si vous visitez quelques pays tropicaux, vous pourrez vite vous retrouver face à cette plante, dans les jardins, sur les trottoirs, à la lisière des forêts, aux abords des plages…
Dans ces régions, C. roseus est une plante médicinale de première importance. Depuis des siècles, fleurs, feuilles ou racines, en infusion, en décoction ou en jus, sont utilisées en médecine traditionnelle pour traiter l’hypertension artérielle, les infections cutanées, les troubles respiratoires, la dengue ou encore le diabète. C’est cette dernière indication qui, dans les années 1950, attire l’attention de deux scientifiques canadiens Robert L. Noble et Charles Beer.
La découverte de deux anticancéreux majeurs
En testant des extraits de la plante sur des rats, ils n’observent aucune modification sur la glycémie (le taux de sucre dans le sang, ndlr) mais constatent une chute brutale des globules blancs. Ils isolent de ces extraits un premier composé : la vinblastine.
Dans le même temps, c’est la course à la découverte de nouvelles molécules actives. Les plantes médicinales sont une cible de choix et sont étudiées en masse. La compagnie pharmaceutique Eli Lilly teste l’activité antitumorale de nombreux extraits dont ceux de C. roseus. L’extrait de pervenche de Madagascar prolonge la vie de souris atteintes de leucémie. Elle isole des feuilles un deuxième composé : la vincristine.
Lors d’un congrès en 1958, la rencontre des équipes canadienne et états-unienne aboutit à une collaboration fructueuse conduisant, quelques années plus tard, à l’approbation par l’US Food Drug Administration (FDA) de l’utilisation de la vinblastine (Velbe) et de la vincristine (Oncovin) comme médicaments anticancéreux.
Une révolution en chimiothérapie
L’élucidation de leur structure chimique montre que ce sont des alcaloïdes retrouvés très majoritairement chez les plantes. Ils sont appelés vinca-alcaloïdes. À partir de ces produits naturels, un premier dérivé semi-synthétique (la vinorelbine, Navelbine) est produit par l’équipe du Pr Pierre Potier de l’Institut de chimie des substances naturelles à Gif-sur-Yvette (Essonne), qui s’intéresse depuis quelques années à leur synthèse. Suivront d’autres dérivés (vinflunine [Javlor], vindésine [Eldisine]) qui enrichissent l’arsenal thérapeutique.
Ces molécules cytotoxiques ciblent une structure dynamique essentielle à la division des cellules tumorales appelée fuseau mitotique et stoppent la prolifération de ces cellules.
Les vinca-alcaloïdes et leurs dérivés sont aujourd’hui utilisés en chimiothérapie pour traiter différentes formes de tumeurs solides, de lymphomes et de leucémies, notamment la leucémie lymphoblastique aiguë, ce qui permet de sauver la vie de nombreux enfants. Dans certains cas, ce sont les seuls traitements existants.
Les molécules, produites par l’industrie pharmaceutique par une méthode mise au point par l’équipe du Pr Potier, impliquent la condensation chimique de deux précurseurs, la vindoline et la catharantine, pour obtenir les vinca-alcaloïdes biologiquement actifs.
Un rendement dérisoire, un coût exorbitant et des pénuries
Malheureusement, la plante produit ces molécules en très faible quantité, l’obtention de 1 g de vincristine nécessitant une tonne de feuilles. La pervenche de Madagascar est donc cultivée à grande échelle, notamment en Inde et utilisée comme matière première.
Ce mode de production, basé sur l’exploitation unique d’une ressource végétale disponible principalement « à l’étranger », explique le coût élevé des traitements (plusieurs dizaines de millions de dollars pour 1 kg de vincristine) et des ruptures d’approvisionnement des vinca-alcaloïdes, comme en 2019 et en 2021, ce qui a conduit à des difficultés pour traiter les patients aux États-Unis et en France, notamment.
Ces tensions ont poussé le gouvernement français à classer la vincristine parmi la liste des médicaments essentiels, dont la production doit être sécurisée et relocalisée sur le territoire national.
Percer les secrets de production de la pervenche de Madagascar
Des approches alternatives doivent être développées. Depuis la fin des années 1970, des équipes de recherche du monde entier, dont notre unité de recherche « Biomolécules et biotechnologies végétales (BBV) » de l’Université de Tours, s’efforcent de décrypter les voies de synthèse des vinca-alcaloïdes et de déterminer quelles sont les enzymes végétales, ces catalyseurs biologiques, qui conduisent à leur production.
Cinquante ans plus tard, toutes les enzymes sont enfin identifiées ainsi que les gènes codant ces enzymes, les deux dernières étapes (parmi plus de 30 nécessaires !) ayant été élucidées en 2018. Nous connaissons désormais le mécanisme de production dans la plante. Mais comment le reproduire ?
La solution : des cellules-usines de levure
Et si la solution venait de la levure de boulanger ? Ce champignon (Saccharomyces cerevisiae), utilisé pour fabriquer notre pain, est sans danger pour l’humain, facile à manipuler et à cultiver.
Les années 2000 ont en effet vu l’émergence de nouvelles technologies permettant la production de molécules naturelles dans des organismes hétérologues microbiens tels que la levure Saccharomyces cerevisiae, avec un premier succès : la production d’artémisinine, médicament originellement extrait de l’armoise annuelle (Artemisia annua) et utilisé pour combattre le paludisme.
Cette stratégie appelée bioproduction permet ainsi de transformer les levures en « cellules-usines » capables de produire des molécules complexes indépendamment de la plante.
En 2018, un consortium international, dont notre équipe fait partie, combinant connaissances de la pervenche de Madagascar et expertises en bioproduction obtient un financement européen (Horizon 2020), (projet MIAMi) pour développer une levure productrice de vinca-alcaloïdes.
Pari réussi : publiés dans la prestigieuse revue Nature en 2022, nos travaux révèlent le succès du transfert de plus de 34 gènes codant les enzymes végétales impliquées dans la synthèse des vinca-alcaloïdes.
Nous disposons désormais de « cellules-usines » de levures produisant les deux précurseurs, vindoline et catharanthine, nécessaires pour la synthèse de la vinblastine. Les recherches actuelles visent désormais à améliorer les rendements et à passer progressivement à l’échelle industrielle.
Source : Université de Tours.
La pervenche de Madagascar, un modèle pour l’avenir
L’histoire ne s’arrête pas là. La pervenche de Madagascar a livré quelques-uns de ses secrets et est désormais une plante phare, modèle sur lequel on peut s’appuyer. Ces avancées ouvrent la porte à la bioproduction d’autres produits naturels rares issus des plantes mais aussi des organismes marins et possédant des activités thérapeutiques.
C’est le cas de l’étoposide, un autre anticancéreux majeur produit par la pomme de mai (Podophyllum peltatum), sur lequel notre équipe travaille particulièrement afin de relocaliser sa production en région Centre-Val de Loire.
De nouveaux médicaments à inventer
Au-delà de la reproduction de l’existant, cette stratégie ouvre la voie à l’invention de nouvelles molécules par ingénierie des levures qui pourraient ainsi modifier la structure initiale. Cela permettrait de moduler leur activité pharmacologique et d’étendre ainsi les possibilités d’utilisation thérapeutique.
La première pierre est posée avec la production d’alstonine. Cette molécule bioactive, identifiée notamment dans la pervenche de Madagascar et utilisée en médecine traditionnelle au Nigéria pour traiter certaines affections liées à la santé mentale, suscite un grand intérêt scientifique pour son profil psychotique original.
En 2024, notre collaboration avec l’Université technique du Danemark a permis de produire l’alstonine dans la levure, mais aussi une alstonine modifiée, ce qui laisse envisager son utilisation dans de nombreux traitements. Des résultats prometteurs…![]()
Audrey Oudin, Maître de conférences, Université de Tours
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
A voir aussi

 Maladie du greffon contre l’hôte : un traitement de Sanofi désormais recommandé par l'EMA
Maladie du greffon contre l’hôte : un traitement de Sanofi désormais recommandé par l'EMA
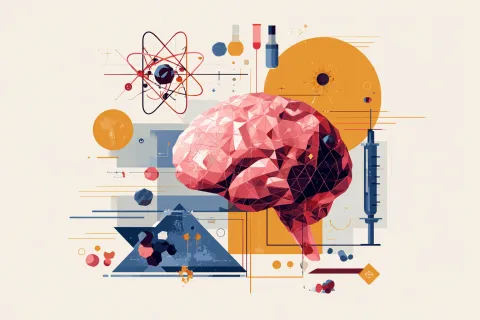
 659 millions d'euros de bénéfices : Servier encaisse grâce à son traitement contre le cancer du cerveau
659 millions d'euros de bénéfices : Servier encaisse grâce à son traitement contre le cancer du cerveau
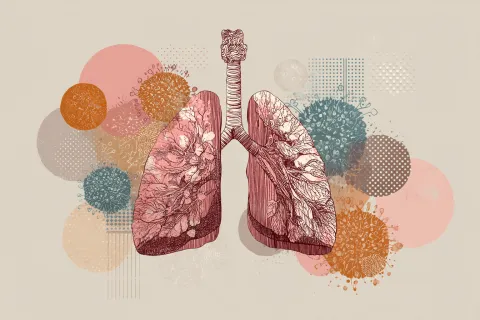
 Prévenir la bronchiolite : le vaccin Arexvy désormais étendu à tous les adultes
Prévenir la bronchiolite : le vaccin Arexvy désormais étendu à tous les adultes
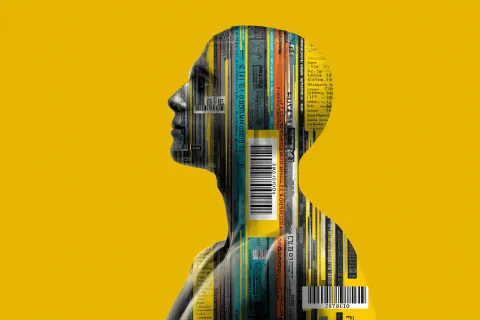
 Microbiote, fertilité, intolérances alimentaires... Le nouveau business des bilans de santé à thème
Microbiote, fertilité, intolérances alimentaires... Le nouveau business des bilans de santé à thème

 Traitement de l'eczéma : résultats encourageants pour l'amlitelimab de Sanofi
Traitement de l'eczéma : résultats encourageants pour l'amlitelimab de Sanofi

 TDAH : les prescriptions de Ritaline et autres traitements ont explosé en Europe
TDAH : les prescriptions de Ritaline et autres traitements ont explosé en Europe

 Test salivaire pour diagnostiquer l'endométriose : à quand le remboursement pour toutes ?
Test salivaire pour diagnostiquer l'endométriose : à quand le remboursement pour toutes ?

 Allergies alimentaires sévères : GSK investit 2,2 milliards de dollars dans un anticorps nouvelle génération
Allergies alimentaires sévères : GSK investit 2,2 milliards de dollars dans un anticorps nouvelle génération
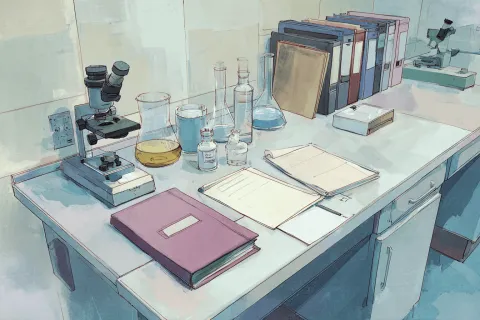
 Vaccin contre le chikungunya : le fabricant Valneva retire son produit des États-Unis
Vaccin contre le chikungunya : le fabricant Valneva retire son produit des États-Unis