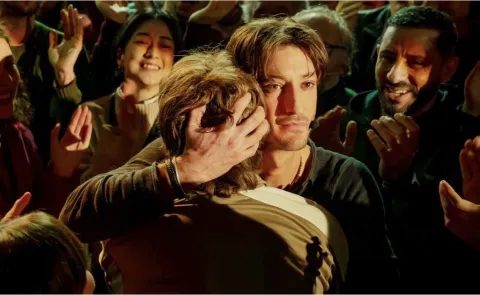Kate Winslet et Andy Samberg dans Lee Miller de Ellen Kuras.
© DR.
Un film qui, s'il se contente de remplir la mission d'oeuvre de commande qui semble lui avoir été assignée, n'en demeure pas moins efficace puisqu'il s'agit de mettre en lumière le destin extraordinaire de cette femme que le courage a fini par broyer.
Lee Miller, ou simplement Lee, en version originale. Un titre-patronyme qui annonce la couleur : il s'agira là, plus que d'évoquer la vie de cette femme, de la réhabiliter, de la faire sortir de l'ombre relative dans laquelle l'Histoire l'a reléguée. Cette femme a eu mille vies. Pourtant, on comprend vite que Kate Winslet, à l'origine du projet, et sa réalisatrice ont souhaité resserrer leur focale sur la parenthèse terrible qu'a constitué la Seconde Guerre Mondiale, en tant qu'expérience tout autant fondatrice que destructrice. Tout ce qui a précédé, hormis un épisode traumatique antérieur qui servira de révélateur dans les dernières scènes, est gommé. Le début de cette période coïncide avec la rencontre avec son futur mari, Roland Penrose, homme sans ambiguïté dont la présence désincarnée ponctue le film de ses scènes les moins réussies, et l'on comprendra à la toute fin que non, il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'une probable décision de la production - encore Kate Winslet, donc - de se placer sous les auspices de la famille Penrose, qui gère ses archives et son héritage mémoriel. Un hommage, et pourquoi pas, car la femme le vaut bien, mais qui ne sortira pas des sentiers battus - sa relation avec son collègue de Life, David Sherman, est ainsi expurgée de façon gênante, bien que soit particulièrement bien rendue la façon dont la situation de guerre génère leur intimité.
« À l'encontre de la froideur avec laquelle il a été accueilli par la critique, ce film n'a rien de déshonorant »
Que garder, au final, du film ? Dire tout d'abord, à l'encontre de la froideur avec laquelle il a été accueilli par la critique, qu'il n'a rien de déshonorant. Il s'inscrit dans la tradition, très productive ces dernières décennies, des films célébrant le patriotisme anglais durant la WW2, rappelant des oeuvres récentes telles qu'Une vie ou, surtout, L'Ombre de Staline, d'Agnieszka Holland, dont la trajectoire du héros-journaliste est similaire à s’y méprendre. Ce qui relie toutes ces oeuvres, c'est leur façon de montrer comment l'on entre indirectement et progressivement en guerre, dans la guerre, par une circonstance qui, parce qu'elle rencontre des traits de caractère ou se connecte à des expériences plus enfouies, revêt soudain une impérieuse nécessité. C'est aussi un certain décalage entre la noirceur progressive de la réalité dans laquelle le héros - ici l'héroïne - est plongé, et l'atmosphère toujours surprenamment réconfortante que constituent les coulisses de son intervention, hôtels cosmopolites, officines diplomatiques ou salles de rédaction. Un peu comme un filet de sécurité, en somme, avec toujours l'énigme, pour qui n'a pas vécu ces périodes, de la véracité de ces moments de respiration, où tout, même le répit, semble adopter une intensité particulière.
« "La" scène de la salle de bains d'Hitler est réalisée avec didactisme et sans esbroufe. On souhaiterait qu'elle se soit déroulée ainsi »
Ce qui impressionne particulièrement chez Lee Miller, c'est l'acharnement avec lequel elle s'est peu à peu déparée des différentes strates qui constituaient sa sécurité à elle, s'enfonçant en eaux toujours un peu plus profondes, aux confins de l'humanité, comme si c'était là le seul moyen de se confronter à une vérité invisible et indéchiffrable. C'est ainsi que, dérivant de tableaux de combats en scènes d'épuration à Saint-Malo, elle accoste au coeur d'un Paris dissocié par sa propre libération puis est aimantée par le coeur de la tragédie allemande et le ventre de la bête immonde. "La" scène de la salle de bains d'Hitler, au sein de ses appartements dans lesquels elle émerge presque par hasard avec David Sherman, est réalisée avec didactisme et sans esbroufe. On souhaiterait qu'elle se soit déroulée ainsi. Elle a abouti à sa photo la plus célèbre, celle où, pour l'occasion, elle redevint modèle l'espace d'un instant. Comme si, au moment de se confronter à l'origine du Mal, elle ne pouvait plus assumer d'être derrière l'objectif, témoin impuissant, voyeuse et complice, dans une tentative symbolique de purification et de reprise de contrôle. Le parallèle fait avec son passé traumatique, dont elle prend conscience et qu'elle ne peut soudain plus taire, a pu paraître grossier. Il correspond pourtant à ce qui est fréquemment constaté cliniquement, et qui constitue le socle commun aux violences sexuelles et aux crimes de masse.
Un mot de Kate Winslet, qui aurait mérité un dispositif plus fouillé et plus élaboré, à l'image du travail effectué par Olivier Dahan pour Simone, mais qui prouve une nouvelle fois, avec cette prestation en miroir de celle, oscarisée, de The Reader, que rien de ce qui est humain ne lui est étranger.