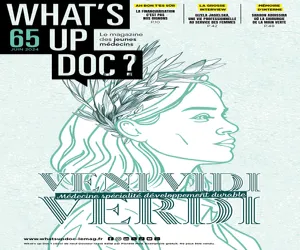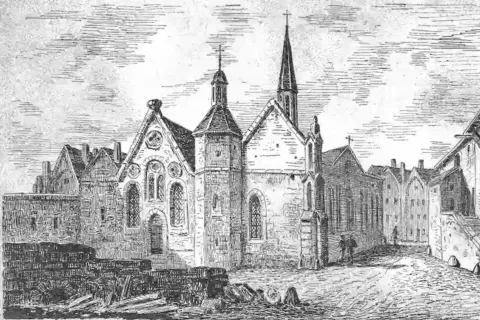Billie Blain dans Cassandre d'Hélène Merlin.
© DR
Un premier film qui aborde la thématique de l'inceste par la sincérité et le courage de l'autobiographie autant que par l'illustration et les échappées que permet la fiction.
La mécanique des ombres. C'est par ce titre alternatif qu'Hélène Merlin a choisi de désigner son premier film, annonçant d'emblée la perspective particulière dans laquelle elle souhaite se placer. Si les conséquences personnelles de l'inceste qu'elle décrit et le douloureux processus de reconstruction constituent un pudique fil narratif, symbolisé par la mue de la marionnette en marionnettiste, c'est bien dans les coulisses d'un système qu'elle nous invite, ce sont bien les causes qui y ont conduit qu'elle expose et dissèque. C'est le ventre de sa propre famille qu'elle ouvre, geste insensé dont l'intention semble autant cathartique que pédagogique.
« Un film avec les codes classiques du conte, à la fois grinçant, macabre et moral »
Ce geste porte en lui les excès de l'enfance, le désordre qu'entraînent le bouleversement et la désorganisation traumatiques imprègne parfois la réalisation. A l'opposé de la narration qui, telle une digue contenant le chaos, se veut plutôt implacablement structurée, intolérante à la zone grise, presque binaire, comme s'il s'agissait de vomir les nuances relativistes et la permissivité que cette organisation familiale vante ad nauseam dans une logorrhée farcesque et étouffante. La métaphore équestre parcourt le film, le haras et le manoir constituant deux univers radicalement différents, parfois jusqu'à la caricature, censés illustrer la distinction entre dressage et apprentissage, le tout conférant à l'oeuvre les codes classiques du conte, à la fois grinçant, macabre et moral.
« La jeune Billie Blain porte en elle cette indispensable alliance de force et de sensibilité »
Deux aspects permettent à cet esquif de ne pas se fracasser contre les écueils du classicisme et du simplisme. Le fond, tout d'abord : rarement l'incestualité avait été aussi précisément et aussi pertinemment mise à nu. En filmant cette famille claquemurée, la réalisatrice souligne la parenté entre les mécaniques incestuelle et sectaire, réunissant les différentes composantes régissant les modèles familiaux à transaction incestueuse en un seul foyer : au système de pensée dictatorial et paranoïaque du père répondent, en écho inversé, la promiscuité, l'absence de limites et la confusion des places et des espaces opérées par la mère, dont le fait d'armes consiste à avoir posé nue en couverture d'Hara-Kiri (!). Ces deux-là ne peuvent se réunir que dans leur enfermement et la supériorité qu'ils lui attribuent. Faisant le malheur de leurs enfants, et l'on ne pourra s'empêcher de remercier Hélène Merlin pour le regard qu'elle pose sur ceux-ci, la jeune Cassandre bien entendu, mais aussi, et c'est à souligner, son frère, qu'elle filme comme une seconde victime, celle d'un endoctrinement viriliste que la permissivité maternelle mènera au passage à l'acte, avec une absence de colère permettant d'appréhender la complexité de certaines formes d'inceste frère-soeur.
C'est la lumière qui émane constamment d'eux, synonyme d'espoir, qui constitue le deuxième intérêt de ce film constellé de belles échappées, au sens d'échappatoire, autant extérieures qu'intérieures. C'est effectivement tout autant en elle qu'autour d'elle que Cassandre va puiser les ressources nécessaires à sa libération. La jeune Billie Blain porte en elle cette indispensable alliance de force et de sensibilité pour y parvenir.