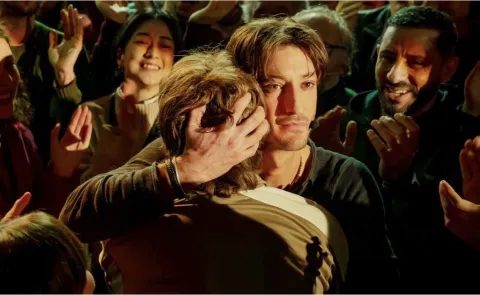La suite de Vice Versa est d’une finesse surprenante, décrivant avec clarté, et sous un angle qui ravirait le regretté Aaron T. Beck, l’édification de la personnalité comme métaphore du sortir de l’enfance.
Vice Versa 2 tient sa force dans la logique de suite qu’il établit avec le premier opus, que l’on pensait difficilement surpassable, et dans l’efficacité illustrative des concepts neuropsychologiques rigoureux sur lesquels se basent son scénario simple et malin.
S’il s’autorise à entrouvrir, là encore très subtilement, la porte du psychotraumatisme, le film reste sur sa lancée typiquement anglo-saxonne. Ainsi l’on ne s’étonnera pas que la jeune Riley se confronte avant tout, changements internes et externes obligent, à une haute anxiété de performance. C’est d’ailleurs celle-ci qui capte l’attention, petite bête apeurée que les autres émotions vont se mettre en quête d’apprivoiser. Cela rappelle à quel point c’est le stress chronique qui est à l’origine de l’émergence des symptômes - la scène décrivant la genèse d’une attaque de panique est particulièrement réussie.
On pourra regretter que les émotions primaires passent un peu au second plan, mais c’est là encore au service de ce que le film veut montrer : plus intenses en raison des bouleversements hormonaux, elles favorisent leur propre évitement, jusqu’à l’alexithymie. Le film est ainsi construit comme une odyssée, un retour à soi, une lutte fructueuse qui permet de comprendre les aléas et les troubles auxquels elle risque d’aboutir quand elle ne l’est pas assez. Une auto-thérapie qui, par comparaison, constitue un support ludique pour les professionnels autant que les patients.