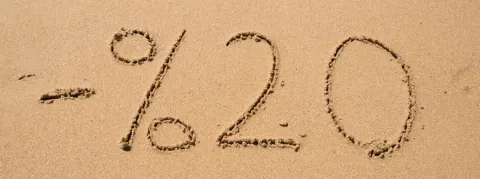Plusieurs documents ont montré que la maltraitance des corps était normalisée, voire institutionnalisée.
Ces révélations ont conduit à la constitution de l’association Charnier Paris-Descartes qui entend obtenir justice pour les donneurs. Plusieurs individus et l’université elle-même ont été mis en examen pour atteinte à l’intégrité des cadavres. Rappelons que le don du corps à la science et, surtout, l’utilisation de ces corps répondent à quelques exigences éthiques et juridiques.
L’instrumentalisation historique des cadavres
Historiquement, l’acquisition de connaissances médicales a été possible grâce à la dissection de cadavres. Durant la Renaissance, c’est la profanation de tombes qui a permis d’en apprendre plus sur l’anatomie humaine. Ainsi les découvertes de Léonard de Vinci ont-elles été possibles grâce à l’étude de cadavres. L’exécution des condamnés à mort a également été instrumentalisée pour que les scientifiques expérimentent sur le corps des suppliciés. Le physicien Giovanni Aldini fit par exemple ses expériences galvaniques sur des cadavres décapités pour identifier des phénomènes électriques dans le fonctionnement du corps humain.
L’encadrement du don de corps
L’adoption de la loi relative à la liberté des funérailles le 15 novembre 1887 constitue le fondement du don de corps à la science. Il a ensuite été précisé par l’article R.2213-13 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit notamment :
« Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l’intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l’indication de l’établissement auquel le corps est remis. »
La principale exigence liée au don du corps apparaît : c’est le consentement de l’individu. Il doit avoir été formulé ante-mortem. Cela témoigne du fait que la volonté humaine continue d’avoir des effets post-mortem.
De manière générale, le consentement à l’expérimentation médicale est un prérequis indispensable. L’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prohibe l’expérimentation non consentie, à l’instar de la Convention d’Oviedo en ses articles 5 et 16. Cette interdiction n’est pas prévue par la Convention européenne des droits de l’Homme mais a été énoncée par le juge européen dans son arrêt Bataliny contre Russie qui a assimilé une telle expérimentation à un traitement inhumain et dégradant. Dans cette affaire, un individu avait été forcé de prendre un traitement expérimental. Son consentement et la nécessité médicale de l’expérimentation faisaient défaut.
Cependant, ces textes visent plus particulièrement le cobaye humain vivant. Le législateur français distingue d’ailleurs la recherche impliquant la personne humaine vivante, encadrée par les articles L.1121-1 et suivants du Code de la santé publique, et le don du corps à la science qui ne répond qu’à l’article R.2213-13 du Code général des collectivités territoriales.
En principe, le cobaye vivant consent à une expérimentation pour laquelle il bénéficie d’informations spécifiques. Celui qui accepte de donner son corps à la science ne dispose pas de données relatives au traitement qu’il sera amené à subir. Ce consentement manque de lisibilité, cette activité étant mal circonscrite. Le défaut d’harmonisation des pratiques au sein des centres de don des corps conduit les individus à consentir à une utilisation méconnue de leurs dépouilles. Les différents témoignages des proches de donneurs montrent que ces derniers n’avaient pas conscience de l’utilisation qui pouvait être faite de leurs corps après le don. Ce défaut de précision est toutefois amorti par des principes protecteurs.
Quelques principes protecteurs du cadavre
Certains éléments de protection acquis du vivant de la personne persistent par-delà la mort. Dans un arrêt du Conseil d’État de 1993, le juge administratif a étendu l’application des principes déontologiques fondamentaux relatifs à la protection de la personne aux cadavres. En considérant que ces principes continuent de s’appliquer après la mort de l’individu, le juge retient que cette protection du corps humain n’est pas seulement liée à la personnalité juridique, laquelle cesse au moment du décès. L’individu décédé doit donc être protégé du seul fait de son humanité. Le législateur a entériné cela avec l’adoption de l’article 16-1-1 du code civil :
« Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »
La principale difficulté tient dans l’application de cet énoncé de principe. Cette exigence de traitement respectueux, digne et décent du cadavre semble trop floue pour assurer une protection effective de ce dernier. Surtout, la mise en œuvre de cette règle est délicate puisque nul ne peut en assurer le contrôle. Pourtant, la protection du cadavre est, selon le juge de la Cour de cassation, une notion d’ordre public.
Il s’agit de protéger non seulement le cadavre, mais également les sentiments des vivants qui ne doivent pas souffrir de la manière dont seront traités leurs proches défunts. Le code pénal réprime d’ailleurs les atteintes à l’intégrité du cadavre. Cette incrimination est très large et englobe divers actes perpétrés sur le corps d’une personne décédée (ex : nécrophilie, membres découpés, accélération de la décomposition d’un corps, etc.).
Un défaut d’encadrement fragilisant la protection des cadavres
La pratique expérimentale sur le cobaye vivant est l’objet de très nombreuses normes nationales, européennes, internationales.
Les recherches sur le cadavre souffrent, elles, d’un encadrement insuffisant. Plusieurs pistes doivent être envisagées pour assurer une meilleure protection des corps donnés à la science. Une harmonisation des modalités de don, d’information, de consentement et de traitement des corps devrait être envisagée sur le plan national, voire international.
Le terme de « don » témoigne d’une réification du corps de la personne après son décès. Il conviendrait d’assurer une traçabilité complète entre le moment du don et l’inhumation ou la crémation. Cela permettrait non seulement aux familles de savoir ce que sont devenus leurs proches, mais également d’éviter qu’un trafic de corps et/ou de membres puisse être mis en place.
Le principe de non-patrimonialité du corps humain empêche de lui conférer une valeur monétaire. L’article 16-5 du code civil prévoit en ce sens :
« Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles. »
Cet article devrait empêcher la vente des corps donnés à la science : cela a pourtant déjà été réalisé, notamment pour des crash-tests dans l’industrie automobiles. Cela vaut à plus forte raison encore lorsque les donneurs n’ont pas été informés de telles possibilités.
Toutefois, seule une meilleure prise en charge institutionnelle des corps donnés à la science permettra de les protéger efficacement. Les révélations relatives au fonctionnement du CDC Paris-Descartes soulignent l’existence de dysfonctionnements systémiques contraires au principe de respect dû au corps humain. Un groupe de travail a d’ores et déjà formulé diverses recommandations tendant à renforcer la protection des corps donnés à la science. Elles s’articulent autour de trois principes fondamentaux : la gratuité, l’anonymat et le respect. Il s’agira de mobiliser les pistes envisagées pour compléter les dispositions existantes et garantir une meilleure effectivité de la protection des cadavres.
![]()
Elise Roumeau, Doctorante & ATER en droit privé - Centre Michel de l'Hospital, Université Clermont Auvergne (UCA)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
|
Déclaration d'intérêts de l'auteure : Elise Roumeau ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche. |