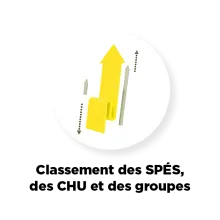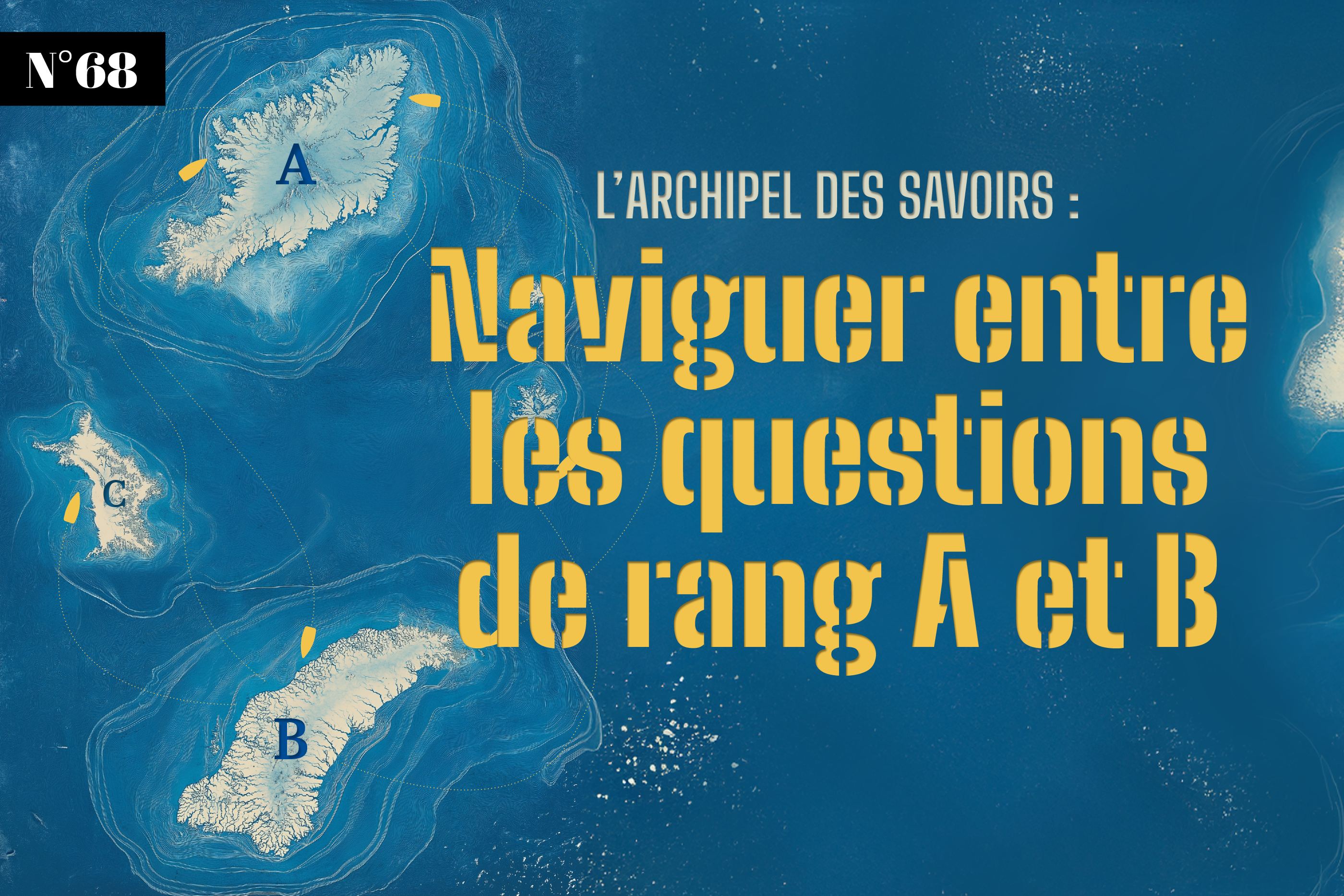
© DR.
« Le principal changement, c’est la temporalité », énonce le Pr Hervé Devilliers du Collège national des enseignants de thérapeutique, médecin interniste, PU-PH au CHU de Dijon, qui enseigne aussi la lecture technique d’articles. En effet, avec la R2C le choix a été de concentrer l’acquisition des connaissances sur la 4e et 5e années et d’évaluer les connaissances exigibles pour l'internat en fin de 5e année (DFASM3), la 6e se voulant plus professionnalisante (ECOS, stages et modules optionnels). « Dans l’esprit des étudiants, et je ne peux leur donner tort, on leur enlève un an de préparation au concours le plus important. On leur met une pression nouvelle qui n’est pas nécessaire. Dès la 4e année, ils sont déjà en train de chercher des aménagements de stages pour pouvoir travailler la théorie plus que la pratique et performer lors de l’examen », estime Hervé Devilliers.
Demandez le programme
Le programme a-t-il été allégé pour autant ? C’est ce qu’assurent les auteurs de la réforme, arguant que la distinction entre rangs A, B et C a été faite pour cela. « Dans la pratique, les étudiants ont l’impression que ce programme est toujours aussi conséquent et qu’ils ont moins de temps pour l’ingurgiter », poursuit Hervé Devilliers. Selon lui, la vérité est à mi-chemin : « On observe à la fois des enseignements qui n’ont pas toujours su s’adapter aux exigences de la réforme, des enseignants qui n’ont pas tous refondu leurs cours, des collèges produisant des listes de connaissances utiles à leur discipline – en rang A ou B – sans que diminue l’épaisseur des livres… »
Pourtant c’est promis, le volume de cours a été diminué pour favoriser l’investissement personnel des étudiants, « lesquels doivent cependant avoir parcouru le cours. Quant à nous, nous devons faire ressortir ce qui est important dans la masse de connaissances, mettre en perspective pour leur donner un peu de recul… ». Faire le lien entre le contenu des livres et les éléments pratiques importants implique, pour les étudiants, « un travail en amont et la gestion – oppressante – du calendrier de cours. D’autant que le nombre d’items est fixé par décret et donc incompressible, et que dans beaucoup de facs, les cours et les stages s’enchaînent sans transition. Certains étudiants préfèrent travailler à leur rythme, apprendre les collèges et étudier les annales, quand d’autres suivent le rythme soutenu imposé par la Faculté. »
Un classement repensé et un trou démographique
« L’idée de départ n’est pas mauvaise, juge Baptiste, interne d’urologie en premier semestre – qui a donc passé les EDN en octobre 2023 –. Dans l’ancien système, les 9 % d’étudiants les plus mal classés devenaient quand même internes avec moins de 10/20, alors qu’on peut penser qu’ils n’avaient pas les connaissances pour. Mais ce qui a été compliqué avec la réforme, c’est que nous avons eu proportionnellement moins de postes parce que de nombreux étudiants ont redoublé leur 5e année pour avoir plus de temps pour se préparer au concours. »
L’autre grand changement de ces nouvelles épreuves classantes est la volonté de réguler le volume des connaissances à acquérir. Pour chacun des 13 groupes de spécialités, se superposent des items de rang A, pour lesquels un minimum de 14/20 est requis, et des questions de rang B déterminant le classement de l’étudiant à la spé choisie. Plus de stress pour les étudiants ? « C’est vrai pour les ECOS mais pas pour les EDN, répond Baptiste qui, visant ophtalmo ou uro, a obtenu la seconde et tous les CHU souhaités. De plus, concernant les choix, tu peux toujours te projeter comme avant, par simulation. »
https://www.calameo.com/whatsupdoc-lemag/read/00584615425d503a6c978
Travailler moins pour travailler mieux ?
Atteint-on l’un des objectifs visés par la création de ces groupes de spés, soit le fait que les étudiants travaillent pour leur avenir professionnel et ne bachotent pas ? « Les statistiques sur les premiers résultats montrent que les différences de classement d’un groupe de spécialités à l’autre sont marginales », rapporte Hervé Devilliers. Ce qui se vérifie aussi dans le mode de préparation des étudiants : « On pourrait penser qu’il ne faut apprendre que les connaissances requises des questions B des spés souhaitées : ce n’est pas du tout le calcul que nous avons fait dans mon groupe de travail, détaille Baptiste. Nous n’avons rien négligé et appris les A et les B des 13 groupes, notamment parce que lors de l’épreuve, le rang de la question n’est pas identifié. De plus, réussir une question de rang A de santé publique, médecine légale ou biologie médicale – spés que personne n’a envie de faire –, te fait gagner plus de places qu’une bonne réponse en cardiologie rang A ... » Même approche pour Anne, en premier semestre de radiologie à Paris : « Les notes sont pondérées mais je ne savais pas exactement ce que je souhaitais faire et ai préparé le concours en me disant que je voulais avoir le choix. Finalement, c’est ensuite que l’on se projette, qu’on se renseigne sur les spés qu’on ne connaît pas – en faisant des simulations, à ce propos le calendrier des 4 phases d’enregistrement pour être bien comptabilisé dans l’algorithme est à retenir –. Je ne regrette pas mon choix de la radiologie, où je touche à toutes les spés, sans peur de m’enfermer, avec de plus le développement de la radiologie interventionnelle qui permet des gestes non invasifs sur le patient… sans pour autant se sentir dans un gros bloc d’orthopédie ! »
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/classement
Des défis qui restent à relever
Côté enseignants, Hervé Devilliers qualifie cette énième réforme « d’usine à gaz et de tannée administrative », pour un bénéfice théorique escompté absolument pas atteint « en raison des compromis qui ont été faits sur les vraies innovations que sont les ECOS et les points de parcours. » La nouvelle plateforme nationale d’enseignement ? « Fonctionnelle mais complexe à utiliser. » Quant à la distinction entre rangs A et B qui doit être prise en compte dans les examens, elle est laissée à la main de chaque université. Autant de nouveaux défis pour les enseignants : Hervé Devilliers a, dans ce cadre, cocréé un DU de pédagogie pour former à la rhétorique mais aussi aux aspects pratiques de la réforme, et invite tous les enseignants de France à y participer.
A voir aussi

 Classements 2026 des CHU au sein de chaque spécialité : les gagnants et perdants de l’attractivité spé par spé
Classements 2026 des CHU au sein de chaque spécialité : les gagnants et perdants de l’attractivité spé par spé

 Classements 2026 des spécialités au sein des CHU : ce que disent les choix des internes
Classements 2026 des spécialités au sein des CHU : ce que disent les choix des internes
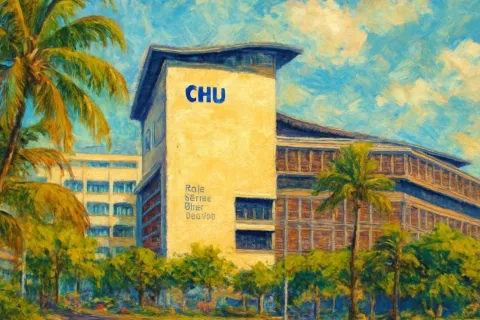
 Victoire pour les internes : ils ont fait condamner le CHU de La Réunion sur le temps de travail
Victoire pour les internes : ils ont fait condamner le CHU de La Réunion sur le temps de travail
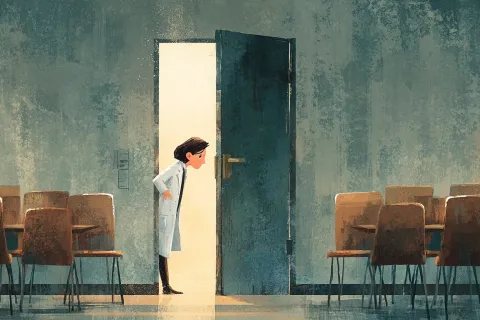
 Quatrième année d'internat de médecine générale : la réforme patine, les internes décrochent
Quatrième année d'internat de médecine générale : la réforme patine, les internes décrochent

 Classement des groupes de spécialités 2026 : quel groupe est le plus sélectif ? Et le moins ?
Classement des groupes de spécialités 2026 : quel groupe est le plus sélectif ? Et le moins ?

 Classement des CHU 2026 : Montpellier prend la tête, Marseille et Toulouse accélèrent, Limoges et Angers décrochent
Classement des CHU 2026 : Montpellier prend la tête, Marseille et Toulouse accélèrent, Limoges et Angers décrochent