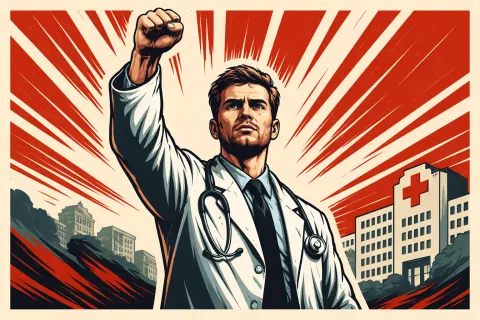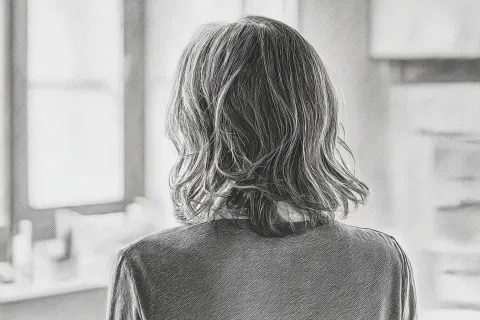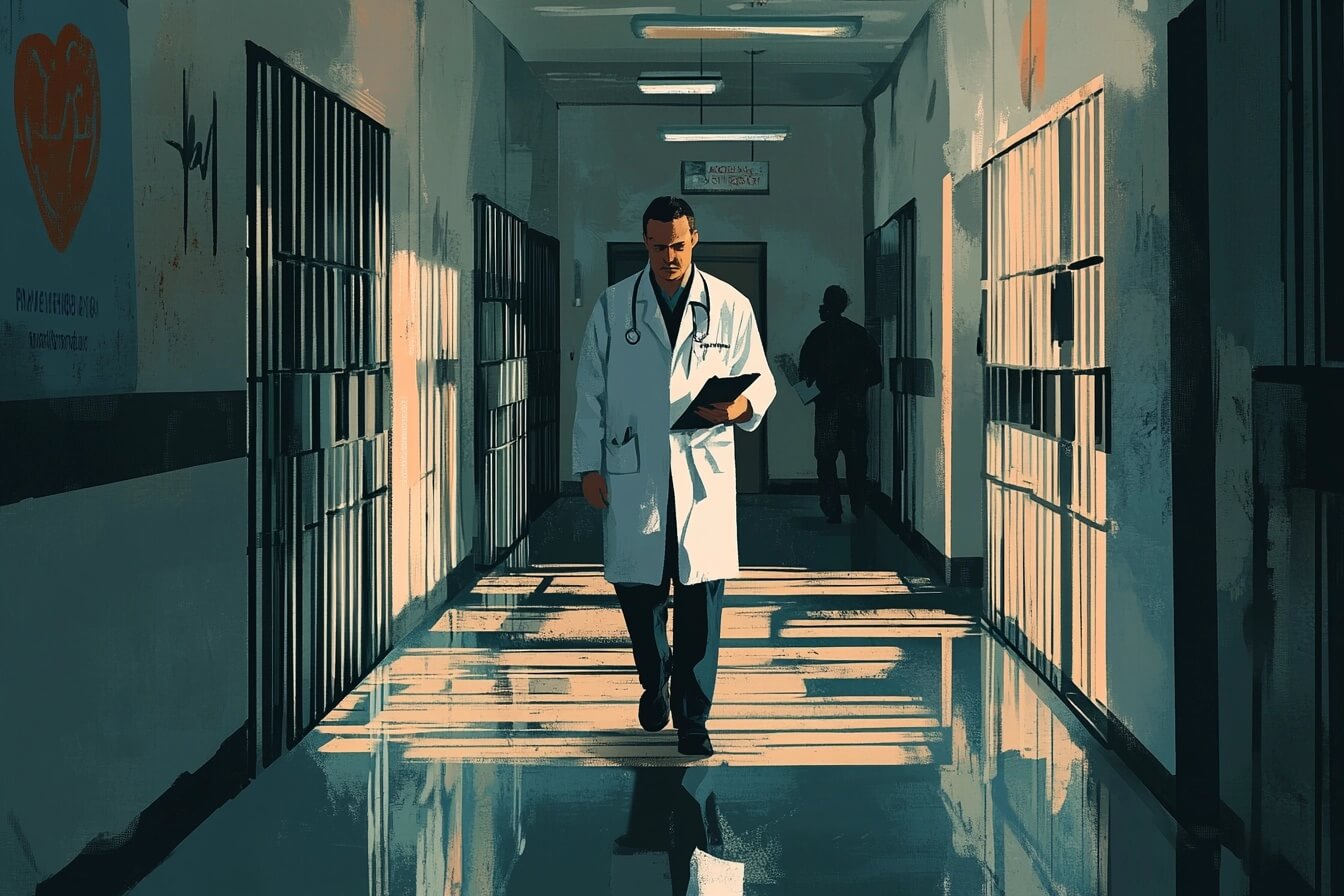
© Midjourney x What's up Doc
Une population carcérale en explosion, des soignants en tension
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la population écrouée est passée de 35 000 personnes en 1968 à plus de 80 000 en 2022. Le taux d’occupation des maisons d’arrêt atteint jusqu’à 239 %. Conséquence directe : les équipes médicales sont sous pression.
- Jusqu’à 66 % de postes vacants de psychiatres dans certains établissements.
- Des difficultés de recrutement généralisées, aussi bien pour les généralistes que les soignants paramédicaux.
- Des conditions d’exercice dégradées : locaux inadaptés, logiques sécuritaires, obstacles aux extractions.
Le médecin, ni soignant de second rang ni auxiliaire de justice
En prison, le médecin n’est pas un acteur subordonné à l’administration pénitentiaire. Son indépendance professionnelle e
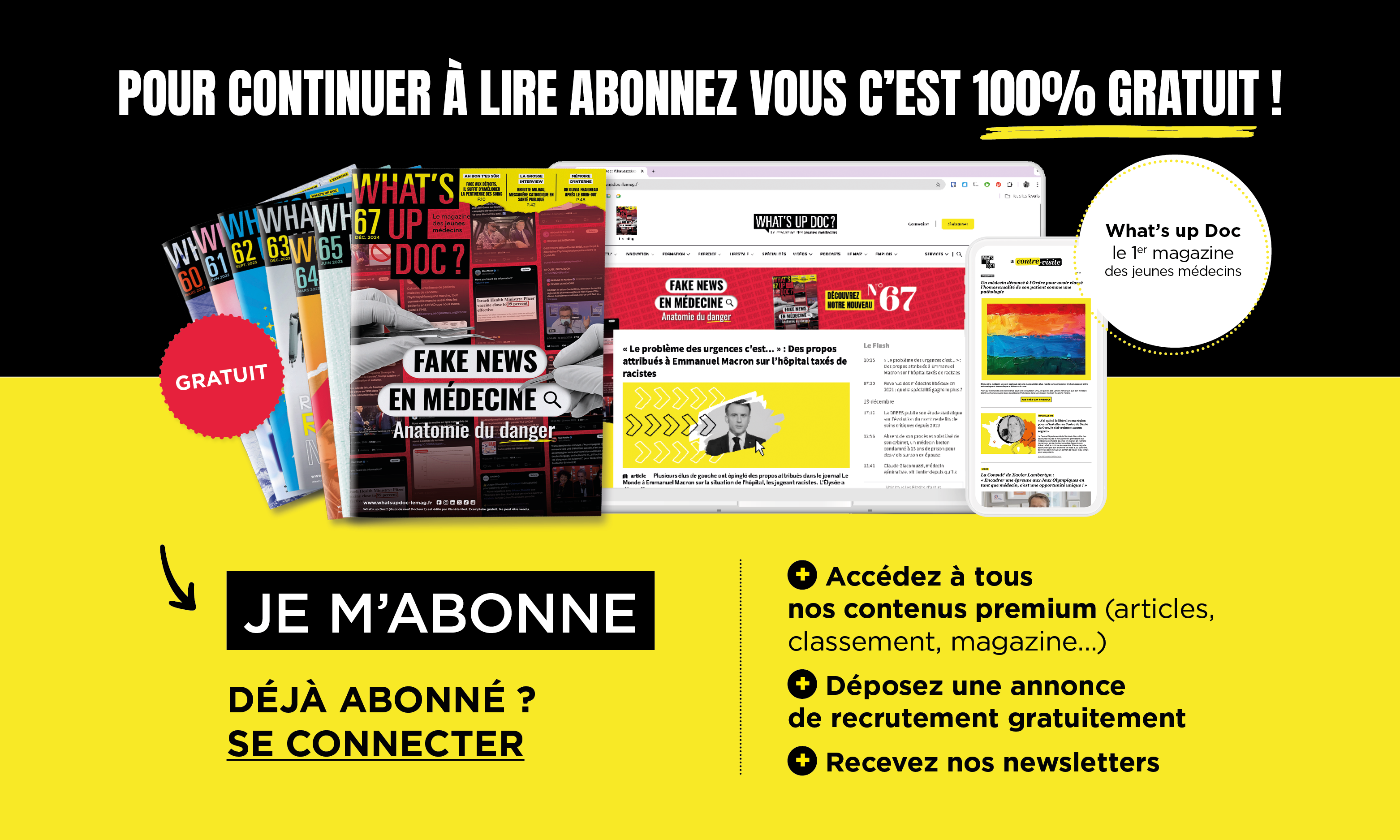
A voir aussi

 La santé mentale au travail s'améliore un peu, sans retrouver son niveau d'avant-Covid
La santé mentale au travail s'améliore un peu, sans retrouver son niveau d'avant-Covid

 « Notre système est incapable de financer l’innovation » : Depuis Bruxelles, les médecins de bloc en exil interpellent le gouvernement
« Notre système est incapable de financer l’innovation » : Depuis Bruxelles, les médecins de bloc en exil interpellent le gouvernement

 Malgré la grève, la grippe et les intempéries, l'hôpital tient bon, dixit la FHF
Malgré la grève, la grippe et les intempéries, l'hôpital tient bon, dixit la FHF

 Plus de 1 000 médecins spécialistes sont exilés symboliquement en Belgique depuis hier
Plus de 1 000 médecins spécialistes sont exilés symboliquement en Belgique depuis hier

 Début de la grève ! Fermetures de cabinets et déprogrammations de rendez-vous au menu
Début de la grève ! Fermetures de cabinets et déprogrammations de rendez-vous au menu