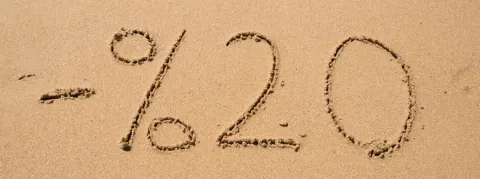Les découvertes qui ont émergé dans le sillage des travaux de Louis Pasteur, « inventeur » du vaccin contre la rage, et de Robert Koch, découvreur du bacille de la tuberculose, ont permis de faire reculer de nombreuses maladies infectieuses. En mettant au point de nouvelles technologies, des physiciens, des chimistes, des biologistes, des informaticiens, ont fait progresser le diagnostic (grâce aux techniques d’imagerie, par exemple) et la prise en charge (notamment grâce aux progrès de la chirurgie et aux résultats de la recherche biomédicale).
Et demain, qui sait quelles innovations vont émerger ? Déjà, les thérapies géniques font naître l’espoir de venir un jour à bout du cancer et des maladies génétiques, tandis que les nouvelles approches d’immunothérapies ont transformé les pronostics de nombreux cancers, et sont même envisagées dans le traitement de la maladie d’Alzheimer.
Ces progrès, qui s’accélèrent et semblent illimités tant sont foisonnantes les techniques innovantes, répondent à la volonté de l’être humain de lutter toujours mieux contre les maladies qui l’affectent, de repousser les limites du vieillissement, voire de vaincre la mort elle-même, comme n’hésitent pas à l’envisager les tenants du transhumanisme. Mais ces avancées entraînent aussi une rupture épistémologique nécessitant une réflexion éthique questionnant les limites de leurs champs d’application.
De la médecine classique à la médecine « 4P »
Les progrès de la médecine ont pu un temps laisser croire au triomphe de la médecine préventive et curative. Mais, comme nous l’a rappelé récemment la pandémie de Covid-19, de nouvelles pandémies peuvent encore émerger. Par ailleurs, nous avons appris que tous les progrès ne sont pas nécessairement acquis : avec la prescription trop large des antibiotiques, nous avons vu s’installer des résistances qui menacent aujourd’hui notre capacité à lutter contre certaines maladies bactériennes. Et plusieurs scandales sanitaires ont aussi mis crûment en lumière le fait que les médicaments sont des pharmaka -, à la fois poison et remède : ils peuvent non seulement avoir des effets secondaires très importants, mais qui plus est, un traitement peut s’avérer très efficace pour un patient tout en étant inutile et délétère pour un autre.
Alors que notre médecine conventionnelle segmentait les malades en différents appareils corporels et psychiques, on voit désormais s’amorcer le tournant de la médecine 4P : personnalisée, préventive, prédictive et participative. « Personnalisée », car cette médecine tient compte du profil génétique et épigénétique de l’individu. « Préventive », car elle prend en considération les problèmes de santé en se concentrant sur le mieux-être et non sur la maladie. « Prédictive », elle l’est par l’adaptation des traitements les plus appropriés pour le patient. « Participative », enfin, car les patients sont incités à être co-responsables en ce qui concerne leurs santés et leurs modalités de prises en soins.
Si ce modèle de médecine « 4P » est tentant, plusieurs limites, socioéconomiques et éthiques, se profilent malgré tout.
Les dilemmes de la médecine 4P
On voit déjà surgir un premier dilemme éthique en ce qui concerne la médecine « prédictive ». Celle-ci est désormais capable, grâce aux progrès de la génétique, de déterminer la probabilité qu’a une personne de développer certaines pathologies (par exemple, une rétinite pigmentaire, un cancer du sein, ou une maladie de Huntington…), bien avant qu’elle ne tombe malade. Si les avantages en matière de prise en charge sont clairs, il est toutefois important de garantir que ces données ne puissent être utilisées pour exposer les personnes à des demandes précises d’employeurs, assureurs ou prêteurs, dans des contextes d’embauche ou d’obtention de service.
La question de la participation des patients ne va pas de soi, elle non plus. Certes, avec la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, nous avons quitté le modèle paternaliste du médecin qui savait ce qui était bon pour « son » malade afin d’adopter un modèle plus égalitaire, faisant du patient un alter ego dans les prises en charge le concernant. Pour autant, appliquer à la lettre ce principe en faisant fi de la vulnérabilité engendrée par l’annonce d’une maladie grave ou incurable serait abandonner son patient à des choix thérapeutiques ou existentiels impossibles.
Tournons-nous à présent vers l’intelligence artificielle (IA), souvent présentée comme le Graal lorsqu’il s’agit de faciliter le travail des médecins. Si, dans le diagnostic d’un mélanome malin par exemple, l’IA semble déjà en mesure de faire mieux et plus vite que le dermatologue, qu’en est-il de la relation médecin-patient ? La machine n’a pas de visage pour rencontrer le visage du patient, se sentir « convoqué » par sa souffrance et responsable de lui. Elle ne remplacera jamais la qualité du regard, la bonté, la bienveillance, ni même la tendresse. En aucune façon, l’intelligence artificielle ne pourra remplacer la relation humaine entre le médecin et le patient.
Une médecine à deux têtes
Depuis Hippocrate, le médecin sait deux choses : qu’il va « guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours », et que d’abord il ne doit pas nuire (« primum non nocere »). L’exercice de la médecine est un long chemin d’apprentissage d’humilité, et de sagesse pratique. Mais cet art est aussi soumis aux exigences sociétales, et son enseignement, ainsi que les technosciences, tendent à déshumaniser les relations médecins-malades et instaurer une perte de sens chez les soignants.
Comme le soulignait le philosophe Michel Serres, aujourd’hui « les médecins doivent développer et entretenir parallèlement deux têtes : l’une scientifique, l’autre empirique ». La première se consacre à la médecine fondée sur les preuves (evidence-based medicine) en anglais), la seconde à l’acquisition d’un savoir expérientiel, important non seulement pour établir un diagnostic, mais aussi pour établir une relation médecin-malade de qualité.
En tant que médecins, nous devons proposer des traitements établis selon les règles de la médecine basée sur les preuves. Mais celle-ci a également des limites : si les essais thérapeutiques dont les résultats sont positifs sont habituellement publiés dans les revues scientifiques (et peuvent donc être analysés par les professionnels de santé), les résultats négatifs sont rarement publiés, ce qui a notamment pour effet de biaiser la vision que nous avons de l’état des connaissances. En outre, ce n’est pas parce qu’un résultat est positif qu’il doit nécessairement être mis en œuvre…
Des limites à s’imposer
La limite pondère, protège du chaos et de la démesure, elle est nécessaire au « vivre ensemble », à la relation de soin, qui ne peut se satisfaire d’une injonction progressiste sans scrupule. Être capable de réaliser une prouesse technique n’exonère pas de se poser la question de la légitimité de son application, au risque parfois de verser dans l’obstination déraisonnable, ou d’entraîner des séquelles invalidantes.
Médecine technique médecine tragique, nous interpelle la neurochirurgienne et philosophe Anne-Laure Boch. N’avons-nous pas fabriqué de grands handicapés, après des réanimations risquées post-accident vasculaire cérébral ou traumatiques, n’y a-t-il pas eu d’obstination déraisonnable ?
La question des limites se pose dans de nombreux domaines biomédicaux. D’importants dilemmes éthiques et sociaux freinent considérablement l’application aux humains des découvertes et des techniques dues à la recherche, en particulier dans le domaine de la reproduction et du clonage. Les techniques d’insémination, de fécondation in vitro, d’injection intraovulaire de spermatozoïde et de conservation des gamètes, permettent aujourd’hui de donner la vie là où elle était auparavant impossible. Ces nouvelles possibilités posent la question de la légitimité des indications : là encore, tout ce qui est possible est-il souhaitable ? Le médecin a-t-il l’obligation de satisfaire les demandes qui lui sont adressées au motif qu’il possède la technique ? Ne risque-t-il pas alors de devenir un simple prestataire de service dans une société consumériste ?
Dans le domaine de la génétique, la technique CRISPR-Cas9 permettant de guérir des maladies génétiques constitue un formidable espoir. Mais, si grâce à elle il devient possible de remplacer un gène pathologique par un gène non pathologique, on comprend également qu’elle ouvre la porte au remplacement d’un gène jugé « insatisfaisant » par un gène plus « performant », ouvrant ainsi la porte au transhumanisme et à l’humain augmenté.
Afin de guider les réflexions, les philosophes américains Tom Beauchamp et James Childress édictaient en 1979 quatre principes éthiques : le respect de l’autonomie du patient, la bienfaisance, la non-malfaisance (ne pas nuire), et ceux de justice et d’équité (la juste répartition des moyens).
Les moyens, justement, constituent une autre limite à laquelle doit se confronter la médecine : les limites matérielles, financières en particulier, rendent difficiles la mise en place de soins égaux pour tous, accessibles immédiatement et en tous lieux.
La médecine face aux limites économiques
Le progrès biomédical a un coût, et celui-ci est élevé, qu’il s’agisse de financer la recherche scientifique et le développement visant à mettre au point et produire des molécules, des équipements ou des dispositifs médicaux innovants. Les énormes investissements requis nécessitent en outre d’être rapidement amortis, du fait de l’obsolescence rapide de ceux-ci. Cela n’est pas sans conséquence sur la façon dont s’oriente la recherche biomédicale, ou dont se structure le système de production ou l’offre de soin. En outre, au-delà des coûts de recherche et développement, ces progrès coûtent également cher du seul fait de leur réussite : l’augmentation de l’espérance de vie des malades engendre en effet de plus en plus de maladies chroniques, qui devront à leur tour être prises en charge.
La limitation des coûts est une préoccupation majeure des gestionnaires, et impacte l’organisation des systèmes de santé, organisés selon le dogme du « flux tendu ». Avec les limites que l’on sait, là encore rappelées par la pandémie de Covid-19 : nous avons appris avec effroi, début 2020 que nous ne produisions plus les principes actifs des médicaments ni les équipements de protections de types masques ou tenues à usage unique nécessaires pour faire face à la pandémie.
La médecine, enfin, est aussi confrontée à d’autres limites, moins directes.
Des limites écologiques et juridiques
Les évolutions sociétales et leurs conséquences sur le domaine juridique ont aussi profondément bouleversé la pratique médicale. Bien que la notion d’erreur médicale ait toujours existé, la demande sociétale évolue vers un droit à réparation de tout dommage, qu’il y ait eu faute médicale ou pas. L’aléa thérapeutique vient donc transformer l’obligation morale de moyens en lui substituant, de fait, l’obligation de résultat.
Enfin, la médecine est aussi impactée par les désastres écologiques. En perturbant l’environnement, nos modes de vie nous exposent à de nouveaux risques (événements climatiques extrêmes, passages dans l’espèce humaine de maladies d’origine animale…). Pour en diminuer l’impact, il faudra une transformation des modes de production et de consommation, adapter nos modes d’existence, de déplacement. La pandémie de Covid-19 a déjà en ce sens apporté des signaux forts, montrant que de nouveaux modes de vie sont possibles en quittant les grandes villes et adoptant les modes de consommations de proximité ainsi qu’en privilégiant des énergies plus écologiques.
Nous le voyons, la médecine n’a pas fini de se confronter aux limites, qu’elles lui soient inhérentes ou résultent des évolutions de nos sociétés. Y faire face ne sera pas simple, mais gageons qu’une sagesse pratique et éthique viendra éclairer son chemin…
![]()
Véronique Lefebvre des Noettes, Psychiatre du sujet âgé, chercheur associé au Laboratoire interdisciplinaire d'étude du politique Hannah Arendt, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
Déclaration d’intérêts
Véronique Lefebvre des Noettes ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.