
Ehsan* renverse un sachet rempli de médicaments sur le bureau de sa psychiatre à Paris. Il n'a jamais retrouvé le sourire depuis qu'il a quitté l'Afghanistan et les comprimés n'arrivent plus à calmer son mal-être.
Depuis qu'il connaît la date de l'entretien pour sa demande d'asile en France, il ne dort plus. « Je stresse, je tremble, je ne me sens jamais bien », marmonne cet Afghan de 27 ans, mains jointes entre les cuisses.
Voûté sur son siège, regard dans le vide et cheveux hirsutes, il se confie au Dr Andrea Tortelli, qui le suit au Groupement hospitalier universitaire (GHU) de Paris, dont une unité tente de rafistoler des âmes fracassées par le parcours migratoire et la précarité.
En France depuis trois ans, Ehsan venait pourtant de trouver une chambre d'hôtel porte de la Villette, après neuf mois à la rue.
Andrea Tortelli jette les plaquettes de médicaments à la poubelle. Avant l'entretien qui décidera de son avenir en France, dans quelques jours, il faut se reposer, s'aérer l'esprit, lui suggère-t-elle.
« J'aimerais sortir, mais ça fait dix mois que je suis en sandales », rétorque Ehsan en ce mercredi froid de novembre, pointant ses pieds marqués par des engelures.
Dans ce centre de soins du XXe arrondissement de Paris, qui a ouvert ses portes à l'AFP, 120 patients sont suivis régulièrement, dont 80% d'Afghans.
La cellule du GHU dédiée à la santé mentale s'est montée, il y a un an, pour accompagner les exilés dans la durée.
« Stress post-migratoire »
Elle apparaît cependant comme un sparadrap sur une plaie béante. En attendant le renfort de deux médecins, l'établissement parisien n'est ouvert que deux jours par semaine. Les demandes pleuvent, les consultations s'enchaînent.
Samir*, autre Afghan de 26 ans, ne trouve plus le sommeil non plus : il a épuisé toutes les voies de recours pour obtenir le statut de réfugié et, d'un jour à l'autre, peut être renvoyé vers la Roumanie, son premier pays d’entrée dans l'Union européenne.
« Je n'ai plus envie de rien. Mon cœur s'est fermé », dit le jeune homme.
Il n'a plus de nouvelle de sa famille, restée en Afghanistan, depuis près d'un an. Il se lève, regarde dans le vide, se rassoit. « Tout ça me rend fou ! »
Ces derniers temps, il « perd patience » : « quand les gens me parlent, je stresse, j'ai envie de me casser la tête ou de leur casser la tête ».
« La précarité, la faim, la rue, la peur d'être renvoyés chez eux... Tout cela aggrave les traumas », analyse Andrea Tortelli, responsable de l’unité.
Un « stress post-migratoire » nomme-t-elle, regrettant que les pouvoirs publics ne s'intéressent à ces troubles mentaux que lorsqu'ils rejaillissent sous forme de faits divers.
Bol d'air
Dans les centres médico-psychologiques spécialisés, vers lesquels les centres d'accueil orientent les migrants en détresse, les listes d'attente s'étalent sur plusieurs mois.
« En 2012, nous avions estimé le nombre d'exilés souffrant de troubles psychologiques à 125.000. Aujourd'hui, on serait plutôt autour de 140.000 », affirme Sibel Agrali, directrice du Centre Primo Levi, où sont suivis plus de 400 patients de 48 nationalités.
En France, seule une quinzaine de centres de soins proposent aux exilés un suivi psychologique « adapté », selon un rapport publié en 2018 par ce centre avec Médecins du monde.
Une autre étude publiée lundi par Médecins sans frontières et le Comité pour la santé des exilés (Comede) souligne que les mineurs isolés étrangers suivis souffrent pour moitié de troubles mentaux générés par leurs conditions de vie en France.
Au Dr Tortelli, Donya* répète qu'elle ne supporte plus sa colocataire. Dans son centre d'accueil, cette Afghane de 72 ans partage sa chambre avec une femme qui « achèvera de (la) rendre malade », dit-elle.
« Parfois j'ai l'impression de mourir. La seule chose qui me calme, c'est d'ouvrir la fenêtre. Mais ma colocataire, aussitôt, la referme », souffle-t-elle, au bord des larmes.
Elle reconnaît que les consultations du GHU lui « font du bien ». Comme un bol d'air.
*Les prénoms ont été modifiés
Avec AFP
A voir aussi

 JO de Milan-Cortina : la fracture d’une championne de ski met un coup de projecteur sur les urgences italiennes
JO de Milan-Cortina : la fracture d’une championne de ski met un coup de projecteur sur les urgences italiennes

 Traitement contre le VIH : le Kenya, quatrième pays africain à déployer le Yeztugo
Traitement contre le VIH : le Kenya, quatrième pays africain à déployer le Yeztugo
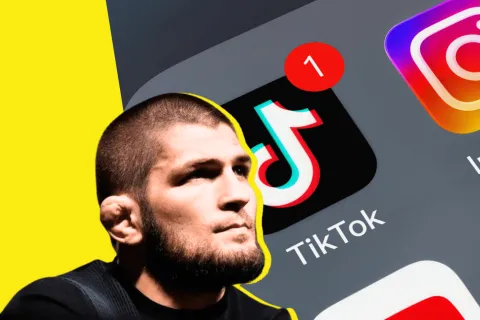
 La mode des oreilles « en chou-fleur » sur les réseaux sociaux inquiète les médecins
La mode des oreilles « en chou-fleur » sur les réseaux sociaux inquiète les médecins










