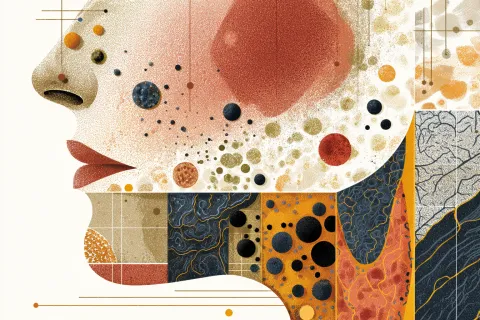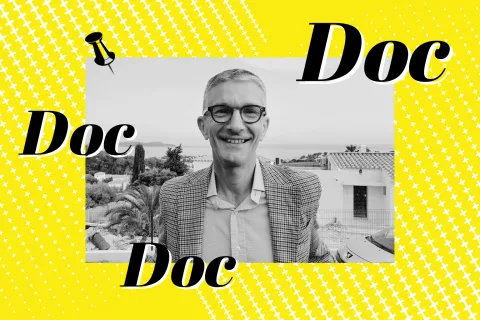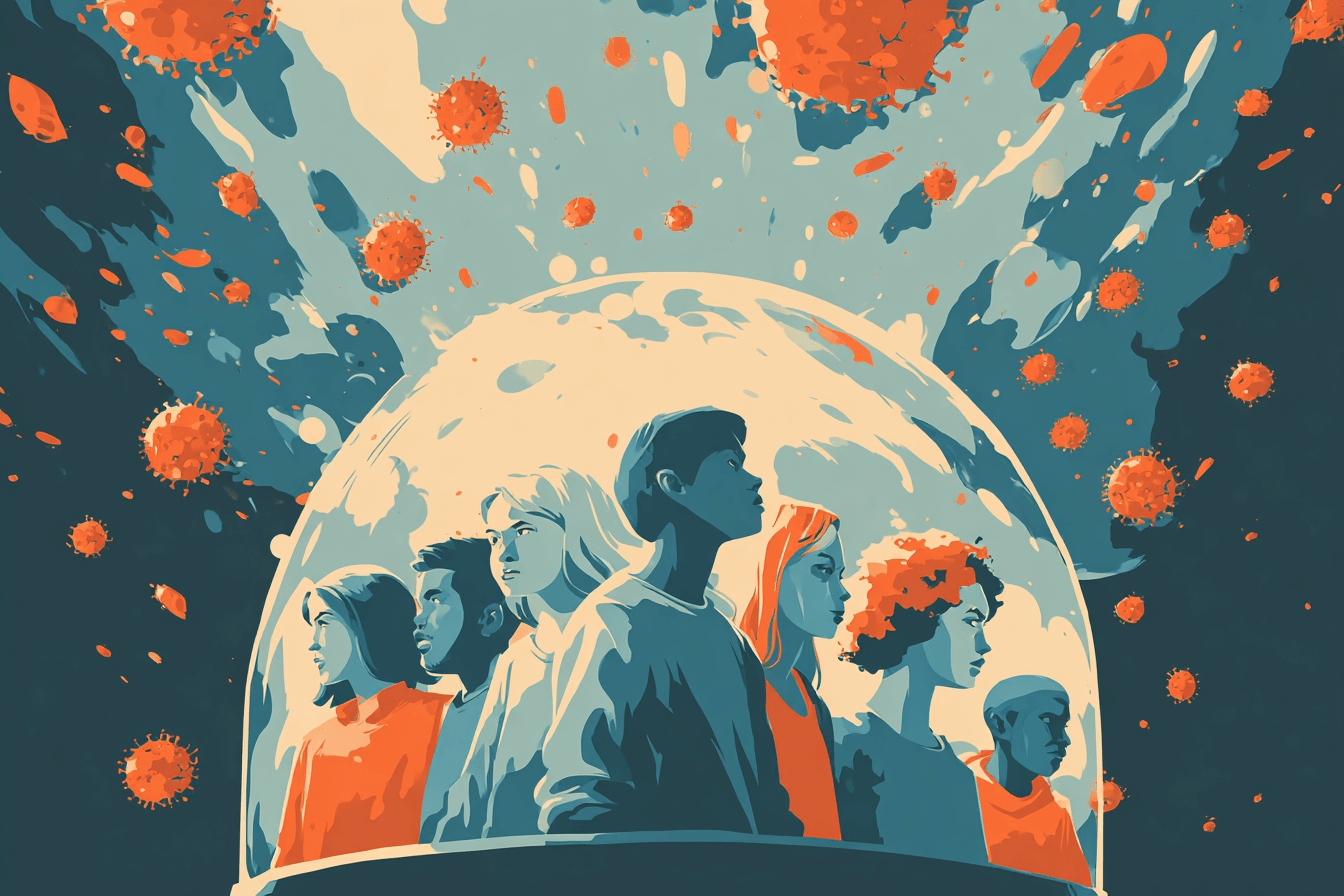
© Midjourney x What's up Doc
« La vaccination anti-HPV réduit probablement de 80 % l’incidence du cancer du col de l’utérus chez les personnes qui ont été vaccinées à 16 ans ou auparavant », conclut cette étude réalisée par l’organisme Cochrane.
Cochrane est une organisation qui réunit de nombreux chercheurs internationaux dans l’idée de réaliser des études visant à faire référence sur l’état des connaissances sur un sujet donné. La qualité de ces travaux fait largement consensus dans le monde médical et scientifique malgré quelques critiques méthodologiques.
Plus c'est tôt, plus c'est efficace
L’intérêt de la vaccination anti-HPV est déjà largement établi. De nombreux pays mènent désormais des programmes de vaccination auprès des adolescents, mais se heurtent fréquemment à des réticences sur fond de vaccinoscepticisme.
Dans ce contexte, Cochrane, qui s’était déjà penché sur le sujet à la fin des années 2010, a publié deux nouvelles revues de la littérature scientifique existante, beaucoup de nouvelles études ayant été réalisées dans l’intervalle.
La première revue, qui ne se base que sur les essais cliniques des laboratoires, conclut à la sécurité de ces vaccins mais non à leur efficacité contre le cancer du col de l’utérus, ces études manquant de recul temporel.
En revanche, la seconde, qui compile plus de 200 études menées après coup pour mesurer l’impact des campagnes de vaccination, conclut clairement à un effet décisif pour éviter l’apparition de ces cancers.
Cet effet est d’autant plus fort que la vaccination est réalisée tôt : à un âge plus avancé, nombre de jeunes ont déjà été exposés au virus en devenant sexuellement actifs, ce qui atténue l’impact protecteur du vaccin.
Quant à d’autres cancers – vulve, anus, pénis – liés à HPV, le vaccin semble efficace mais les preuves sont « de moins bonne qualité » en raison de la rareté de ces pathologies, qui ont donné lieu à moins d’études.
Comme la première étude, celle-ci se montre par ailleurs rassurante sur les effets secondaires : « la vaccination anti-HPV n’est pas associée à un plus gros risque d’effets secondaires à long terme, ou d’infertilité », concluent les chercheurs.
Avec AFP