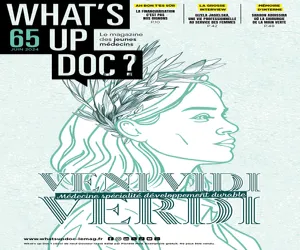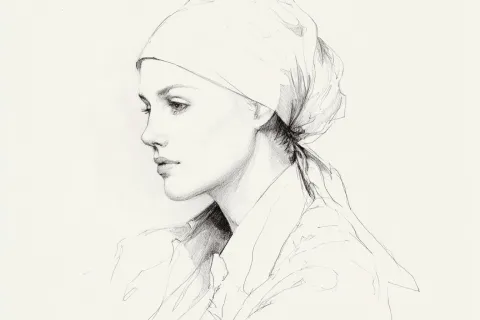© Midjourney x What's up Doc
Aux États-Unis, l’alcool est responsable d’environ 100 000 cas de cancer et de 20 000 décès par cancer chaque année, ce qui en fait la troisième cause évitable de cancer. À titre de comparaison, les accidents de la route liés à l’alcool causent environ 13 500 décès par an aux États-Unis.
(En France, en 2018, 28 000 nouveaux cas de cancers étaient attribuables à l’alcool, soit 8 % des cas incidents de cancer, avec une répartition de 11 % chez les hommes et 4,5 % chez les femmes. Les accidents de la route en lien avec une consommation d’alcool et/ou de stupéfiants ont causé près de 1 250 décès en 2024, l’alcool étant impliqué dans les trois quarts des cas, ndlr).
Les scientifiques ont soupçonné dès les années 1980 que l’alcool pouvait provoquer le cancer. Des études épidémiologiques ont, depuis, montré que la consommation d’alcool augmente le risque de cancers de la cavité buccale, de la gorge, du larynx, de l’œsophage, du foie, du côlon et du rectum, ainsi que du sein. D’autres travaux ont révélé une association entre consommation chronique ou alcoolisation massive ponctuelle et cancer du pancréas.
En 2 000, les responsables du National Toxicology Program des États-Unis ont conclu que la consommation de boissons alcoolisées devait être considérée comme cancérogène avéré pour l’être humain. En 2012, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), l’agence spécialisée dans le cancer de l’OMS, a classé l’alcool parmi les cancérogènes du groupe 1. L’appartenance d’une substance à cette catégorie, la plus élevée dans la classification du CIRC, indique qu’il existe des preuves scientifiques suffisantes pour conclure qu’elle cause des cancers chez l’être humain. Les Centers for Disease Control and Prevention et les National Institutes of Health s’accordent eux aussi à dire que les preuves sont concluantes : l’alcool est bien à l’origine de différents types de cancers.
Par ailleurs, aux États-Unis (comme en France, ndlr), les autorités sanitaires soulignent que même de faibles quantités d’alcool – moins d’un verre par jour – augmentent le risque de cancer.
Malgré tout, nombre de citoyens ne savent pas que l’alcool cause des cancers. En 2019, moins de 50 % des adultes aux États-Unis avaient conscience des liens entre consommation d’alcool et risque cancérogène.
En France, le lien entre alcool et cancer est également sous-estimé par une partie de la population. L’enquête Baromètre cancer de 2021, menée par l’Institut national du cancer, a révélé que 38,6 % des personnes interrogées pensent que « ce sont surtout les alcools forts qui augmentent le risque de cancer », tandis que 23,5 % estiment que « globalement, boire un peu de vin diminue le risque de cancer plutôt que de ne pas en boire du tout », alors même que le « French paradox » est désormais battu en brèche, ndlr.
En outre, l’édition 2023 de la National Survey on Drug Use and Health a relevé que plus de 224 millions d’Américains, âgés de 12 ans et plus, avaient consommé de l’alcool à un moment de leur vie – soit plus de 79 % des personnes de ce groupe d’âge. La consommation d’alcool augmentait déjà avant la pandémie de Covid-19, ce qui constitue un sujet de santé publique préoccupant.
En France, selon les données recueillies par Santé publique France, la consommation quotidienne d’alcool diminue régulièrement depuis trente ans. On constate toutefois que, si les « alcoolisations ponctuelles importantes » ont tendance à diminuer chez les jeunes hommes, elles augmentent de manière sensible chez les femmes de plus de 35 ans. Dans les deux cas, les disparités régionales sont marquées, ndlr.
En tant que chercheuse, j’étudie les effets biologiques de la consommation modérée et de longue durée d’alcool. Mon équipe travaille à élucider les mécanismes par lesquels l’alcool accroît le risque de cancer, en particulier via les atteintes portées aux cellules immunitaires et au foie.
L’administrateur de la santé publique des États-Unis a appelé à faire figurer le risque de cancer sur les étiquettes d’avertissement des bouteilles d’alcool.
Comment l’alcool provoque-t-il le cancer ?
Le cancer survient lorsque des cellules se mettent à croître de manière incontrôlée dans l’organisme. L’alcool peut favoriser la formation de tumeurs en endommageant l’ADN, provoquant des mutations qui perturbent la division et la croissance cellulaires.
Les chercheurs ont identifié plusieurs mécanismes pouvant expliquer comment la consommation d’alcool mène au développement de cancers. Un rapport publié en 2025 par l’administrateur de la santé publique des États-Unis (surgeon general of the United States) a répertorié quatre voies principales par lesquelles l’alcool peut causer le cancer :
- le métabolisme de l’alcool,
- le stress oxydatif et l’inflammation,
- les altérations des niveaux hormonaux,
- les interactions avec d’autres cancérogènes (comme la fumée de tabac).
L’expression « métabolisme de l’alcool » – la première voie par laquelle cette substance peut provoquer des cancers – désigne les processus grâce auxquels l’organisme dégrade et élimine l’alcool. Une fois ingéré, ce dernier subit, sous l’effet de diverses enzymes, des transformations chimiques qui vont permettre son élimination (on dit qu’il est « métabolisé »). Le premier sous-produit de ces réactions est l’acétaldéhyde, une substance elle-même classée comme cancérogène. Les scientifiques ont montré que certaines mutations génétiques peuvent amener l’organisme de certains individus à décomposer l’alcool plus rapidement, entraînant des niveaux accrus d’acétaldéhyde.
La seconde voie par laquelle l’alcool augmente le risque de survenue de cancer implique d’autres molécules nocives, appelées « radicaux libres ». L’alcool peut déclencher la libération de ces molécules chimiquement très réactives, qui endommagent l’ADN, les protéines et les lipides des cellules par un processus dit de « stress oxydatif ». Mon laboratoire a montré que les radicaux libres issus de la consommation d’alcool peuvent influer directement sur la manière dont les cellules synthétisent et dégradent les protéines, entraînant la production de protéines anormales qui entretiennent une inflammation propice à la formation de tumeurs.
Le risque de cancer peut également être accru par l’alcool d’une troisième façon, en raison de la capacité de cette substance à modifier les niveaux hormonaux. On sait qu’une consommation modérée d’alcool peut non seulement augmenter les niveaux d’œstrogènes, mais aussi favoriser la poursuite de la consommation. Or, des travaux ont montré que le risque de cancer du sein peut être augmenté par le niveau d’œstrogène. L’alcool amplifie également le risque de cancer du sein en réduisant les niveaux de vitamine A, laquelle régule les œstrogènes.
Enfin, l’alcool augmente le risque de cancer en interagissant avec d’autres substances cancérogènes. On sait par exemple que les personnes qui boivent et fument présentent un risque accru de développer un cancer de la bouche, du pharynx et du larynx. C’est parce que l’alcool facilite l’absorption, par l’organisme, des cancérogènes contenus dans les cigarettes et les cigarettes électroniques.
En l’état actuel des connaissances, le risque de cancer associé à l’utilisation à long terme des vapoteuses semble bien moindre que celui des cigarettes de tabac, mais il n’en est pas pour autant nul (comparé au fait de ne pas en utiliser) ; en cause, la présence de certains constituants potentiellement mutagènes ou cancérogènes dans les aérosols générés par les cigarettes électroniques, qui pourrait influer sur le risque de certains cancers, notamment en cas d’utilisation prolongée. Des données complémentaires doivent cependant encore être recueillies pour évaluer ledit risque, ndlr.
En outre, le tabagisme, à lui seul, peut également provoquer une inflammation, induisant des radicaux libres qui endommagent l’ADN.
Quelle dose d’alcool est sans danger ?
Si vous buvez de l’alcool, vous vous êtes peut-être déjà demandé s’il existe une dose minimale permettant une consommation sans risque. La réponse des cliniciens et des scientifiques risque de ne pas vous plaire : la consommation d’alcool n’est jamais sans risque.
Le risque de cancer augmente dès le premier verre et s’accroît avec la quantité consommée, quel que soit le type de boisson alcoolisée ingérée.
Aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention, le National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism et l’administrateur de la santé publique des États-Unis préconisent de ne pas dépasser un verre par jour pour les femmes et deux verres pour les hommes
En France, les repères de consommation d’alcool « à moindre risque » n’établissent pas de distinction entre les sexes. Pour communiquer sur le sujet, les autorités ont retenu la formule : « [Pour votre santé, l’alcool c’est maximum deux verres par jour, et pas tous les jours(https://www.drogues.gouv.fr/campagne-alcool-nouveaux-reperes-de-consommation-moindre-risque) »], ndlr.
La consommation d’alcool est donc une cause de cancer hautement évitable.
Il n’existe toutefois pas, à ce jour, de méthode pour déterminer le risque individuel de développer un cancer lié à l’alcool. Le profil génétique propre à chacun, le mode de vie, l’alimentation et d’autres facteurs peuvent influer sur la propension de l’alcool à mener à la formation de tumeurs. Une chose est sûre : reconsidérer ses habitudes de consommation peut contribuer à protéger sa santé et à réduire son risque de cancer.
Pranoti Mandrekar, Professor of Medicine, UMass Chan Medical School
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
Source:
Pour aller plus loin
Les pages des sites Alcool info service et Santé publique France consacrées aux effets de l’alcool sur la santé ;
la page du site du réseau NACRe consacrée aux liens entre alcool et cancer ;
la page du site de l’Assurance maladie destinée à l’évaluation de sa consommation d’alcool.