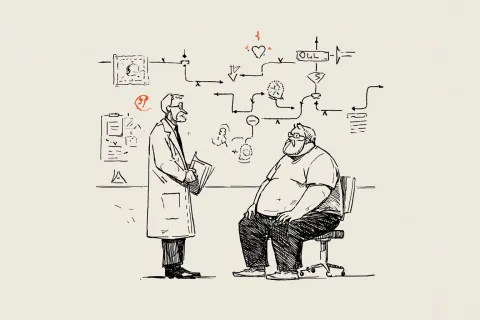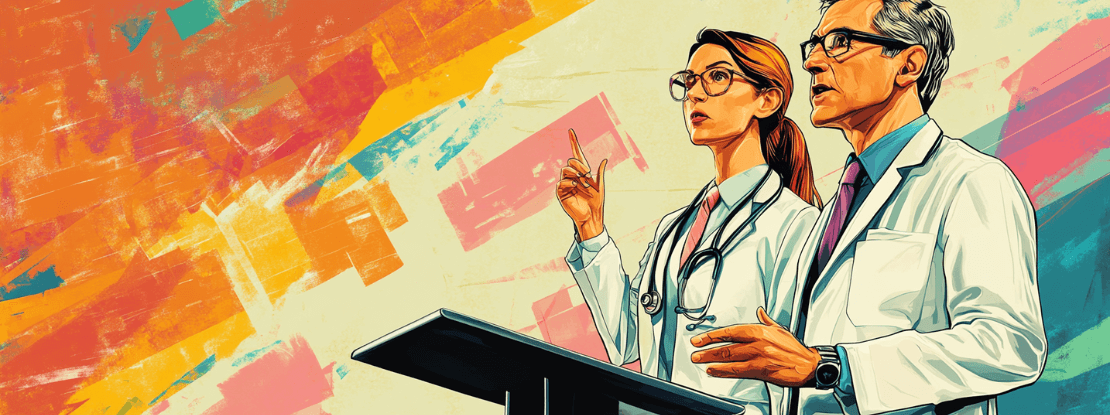
© Midjourney x What's up Doc
L’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2025 a été à l’origine d’une âpre bataille politique ; la majoration de 5% du ticket modérateur sur les consultations et les médicaments cristallisant une opposition sur les moyens à mettre en œuvre pour éponger la hausse continue des dépenses de santé, dans un contexte économique morose.
Comme prévu, cette hausse va se répercuter directement sur les ménages, le président de la Mutualité française venant d’annoncer une hausse substantielle de tarifs des complémentaires santé : +6 % en moyenne en 2025. Une hausse qui semble se faire « au niveau strictement nécessaire pour pérenniser la protection de tous » et dans un contexte où « sans une refonte structurelle », les dépenses « continueront d’augmenter jusqu’à que nous ne puissions plus y faire face ». Qu’un responsable d’assurance alerte sur l’impossibilité d’assurer un des piliers de notre société (la santé) devrait effectivement nous alerter et susciter l’initiation d’une réflexion de fond.
« Ceux qui paieront verrons leur revenu disponible chuter, les autres renonceront aux soins »
A l’heure où la consommation de soins et de bien médicaux (CSBM) pèse près de 9% du PIB et croit continuellement (+24% en 10 ans pour la CSBM/habitant), les mesures budgétaires de court terme ne sont qu’un pansement de fortune sur une plaie béante. La majoration du ticket modérateur revient à augmenter le reste à charge du patient, directement ou via la hausse des tarifs des complémentaires santé. Ceux qui paieront verrons leur revenu disponible chuter, les autres renonceront aux soins. Ces reculs étant, faut-il le rappeler, un moteur majeur de la colère populaire. Les autres mesures ne sont guère plus efficaces : négocier les prix des médicaments et des dispositifs médicaux avec les industriels (déjà très bas en France) dans un contexte de forte tension mondiale sur la demande pourrait exposer notre pays à un risque supplémentaire de pénuries de médicaments. Enfin, la quête de nouveaux gains d’efficience économique contraint le système de santé à un fonctionnement à flux tendu permanent, altérant ainsi sa robustesse, qualité pourtant indispensable dans un monde mouvant et incertain (pandémie, vagues de chaleur, cyber attaques etc…)¹. La responsabilité politique ce n’est pas, comme entendu trop souvent, s’inquiéter du déficit budgétaire de 2025, mais plutôt se préoccuper des conséquences sociales et sanitaires des choix politiques en matière de santé.
« Nous sommes au point de bascule où cette conception d’une santé « curative » devient incompatible avec les contraintes budgétaires, humaines et écologiques »
Dès lors que faire ? Étant admis que cette situation est insoutenable, n’est-ce pas plutôt notre modèle sanitaire que nous devons questionner ? Depuis les années 1950, la part des soins dits « curatifs » est devenue prépondérante dans les politiques de santé publique, au détriment de la prévention et de la promotion de la santé. Ces soins curatifs, dopés par la recherche et l’innovation médicale, par un financement des acteurs globalement basé sur l’acte, et par une forte demande liée au vieillissement et à l’explosion des maladies chroniques dont une large partie sont aujourd’hui évitables (pollutions multiples, alimentation, addictions etc), nécessitent de consommer des quantités croissantes de ressources (humaines, financières et matérielles). Nous sommes au point de bascule où cette conception d’une santé « curative » devient incompatible avec les contraintes budgétaires, humaines et écologiques. L’impasse financière actuelle n’est donc qu’un symptôme de ces choix qui nous conduisent vers une impasse globale. Il est donc urgent de penser un modèle de santé qui améliorerait la robustesse de la population face à l’adversité, réduisant de fait la demande de soins curatifs et donc les dépenses. Toutefois, une telle bifurcation qui nécessite une planification ne produira des effets sur les déterminants de la santé qu’à moyen et long terme, un tel changement de paradigme engageant la société dans son ensemble.
« Les dépenses de santé supplémentaires sur la dernière décennie n’ont en moyenne permises ni la prévention des maladies, ni la prolongation de la vie, ni l’amélioration de la vitalité physique et mentale des individus »
À court terme, bien que la poursuite de certains efforts d’efficience bien ciblés (écoconception des soins, sobriété énergétique) et la recherche de nouveaux canaux de financement comme la taxation de certaines activités économiques affectant négativement la santé restent souhaitables, la réflexion prioritaire à mener est plus profonde et concerne les objectifs de notre système de soins. En 1952, l’OMS a défini la santé publique comme « l’art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d’améliorer la santé et la vitalité physique et mentale des individus par le moyen d’une action collective concertée (…) ». Or, depuis les années 2010, la croissance des dépenses de santé dans les pays comme la France est quasi dé-corrélée de l’espérance de vie à la naissance et de l’espérance de vie en bonne santé, ces deux indicateurs étant globalement stables autour de 82 ans pour le premier et 64 ans pour le second. En d’autres termes, les dépenses de santé supplémentaires sur la dernière décennie n’ont en moyenne permises ni la prévention des maladies, ni la prolongation de la vie, ni l’amélioration de la vitalité physique et mentale des individus. Ne serions-nous pas en train de confondre la fin et les moyens ? En effet, soigner ne doit pas être vu comme une finalité mais comme un moyen utile à l’accession au bonheur. Entendu ainsi, la finalité d’un système de santé ne peut pas être de soigner pour soigner, mais plutôt d’offrir durablement à la population un niveau de santé physique et mentale permettant d’au moins prétendre à la vie heureuse.
À rebours du discours prônant la hausse continue des budgets alloués à la santé, il nous semble évident que le modèle actuel n’est pas durable et qu’une part des dépenses de santé, non guidée par cette prétention d’accession à la vie heureuse, relève de l’obstination déraisonnable. Une réflexion collective, citoyenne et éclairée est indispensable pour mener à bien cette évolution de la pensée en santé, dans une perspective de soutenabilité financière et environnementale et dans une logique de robustesse et de bien-être populationnel. Gageons que cette démarche apportera des solutions qui permettront de garantir la viabilité de nos systèmes assurantiels sans dégrader la santé de la population.
¹ Voir les travaux du biologiste Olivier Hamant, Antidote au culte de la performance : la robustesse du vivant, publiée chez Gallimard (Tracts) en 2023.
Auteurs : Caroline Abdul Malak (médecin praticien hospitalier), Thibault Maillet (médecin praticien hospitalier), Laurie Marrauld (maîtresse de conférence à l'École des hautes études en Santé Publique), Denis Rome (directeur d’hôpital), Paul-Simon Pugliesi (médecin, praticien hospitalier, chef de service)
Co-signataires : Guillaume Beltramo (maître de conférence, praticien hospitalier), Marine Cargou (praticien hospitalier), Rangolie Kaveri (Biologiste, Établissement français du sang), Denis Guyotat (professeur de médecine), Olivier Hamant (chercheur à l’INRAE, École normale supérieure de Lyon), Jean-Pierre Quenot (professeur de médecine, chef de service), Nicolas Ridoux (directeur d’hôpital)