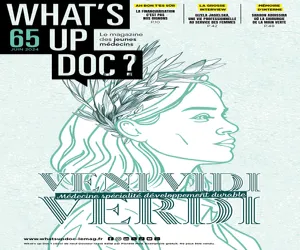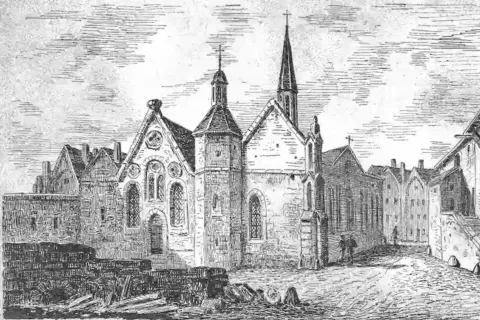Cécile de France dans Par amour d'Elise Otzenberger.
© DR.
A la fois intrigant et rebattu, le film d'Elise Otzenberger ne réussit jamais à nous emmener aussi loin que ses intentions.
Il y a quelque chose qui, tout au long de la vision de Par amour, empêche le film de prendre réellement. Peut-être parce que piégé par le message principal qu'il cherche à transmettre, et qui apparaît rapidement comme excessivement injonctif, celui de la nécessité de croire, induisant en quelque sorte la réticence du spectateur. La frustration est d'autant plus grande que le film semble porté par une ambition aussi singulière que l'atmosphère que la réalisatrice instaure immédiatement. Une capacité à faire cohabiter le banal et l'insolite, à faire sourdre une dimension parallèle à partir d'une poésie du quotidien composée de pavés glissants, de quiétude provinciale et d'architecture municipale. Un dispositif en clair obscur au sein de l'espace circonscrit que constitue un appartement, progressivement envisagé comme la caisse de résonance d'un stress, une tanière de conte de fées à mi-chemin entre le merveilleux et le dangereux. Un écho, au final, au délire qui se constitue sous nos yeux, qui se propage, contagieux et systémique.
« Chaque scène, qui pourrait être originale en soi, renvoie à un sentiment de déjà vu »
Le film se heurte assez rapidement à deux écueils. Le premier, véniel, est de ne jamais réellement nous surprendre. Chaque scène, qui pourrait être originale en soi, renvoie à un sentiment de déjà vu qui n'attend même pas la fin de la séance pour se concrétiser. Ainsi, sous couvert d'une démarche originale, le film est précédé de tentatives similaires trop récentes - on pense constamment à Just Philippot - mais surtout habité par l'antécédent massif que constituent les univers de M. Night Shyamalan et Jeff Nichols, au point de se résumer en une synthèse des deux oeuvres fantastiques qui ont bâti la célébrité de ce dernier, Midnight Special et surtout Take Shelter. Avec irrémédiablement un réflexe de comparaison préjudiciable à la version française.
Le deuxième problème réside dans un scénario qui, en cherchant à nous perdre, finit surtout par se perdre lui-même, dans son récit comme dans ses intentions. En mêlant chronique familiale, conte fantastique, suspense mental et fable éco-anxieuse, la réalisatrice ne sort de l'ambiguïté, comme c'est l'adage, qu'à ses dépens, et finit par tisser une métaphore assez lourde, symbolisée par un épilogue qui, s'il se voudrait ouvert, échoue à résoudre la confusion de l'ensemble et à nous faire accéder aux réels enjeux de tout cela.