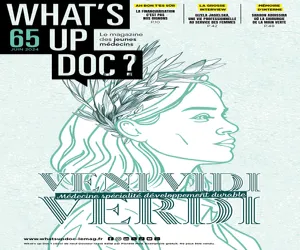© DR
What’s up Doc : Comment êtes-vous arrivé si vite à un poste de chef de service ?
Mateusz Chodorowski : Durant mon internat, je suis passé à deux reprises à l’hôpital de Landerneau, au début et à la fin de mon parcours. Sachant que je voulais y travailler, j’avais demandé à ce qu’on m’aménage, lors de mon dernier semestre, un jour par semaine à l’hôpital, pour préparer mon arrivée. À cette période, on avait fait l’acquisition d’une IRM. J’ai participé à toute la mise en place de la machine, à son paramétrage sur du temps que Brest acceptait de m’accorder. Ça m’a beaucoup plu, la gestion, l’encadrement de projet, des choses non purement médicales auxquelles on n’est pas vraiment formé pendant le cursus.
Parallèlement, l’ancien chef de service n’étant plus là qu’un jour par semaine, il a commencé à progressivement me proposer certaines tâches administratives que j’ai acceptées avec grand plaisir. Suite à des modifications de gouvernance à Brest, il a été décidé en concertation entre ce chef, la direction et moi-même que je prenne la chefferie de service. Le passage de flambeau a eu lieu le 1er février.
Décrivez-nous le service dont vous avez pris la tête ?
MC. : Le service d'imagerie de Landerneau compte une trentaine de personnes. Une quinzaine de manipulateurs, des secrétaires dont certaines que l’on partage avec le service des urgences, un cadre de santé, deux angiologues, mon binôme, ainsi que sept autres médecins du CHU de Brest, qui sont présents un jour par semaine chacun. Tout l’effectif médical dans le service est partagé avec le CHU. C’est une entraide très positive : déjà pour les patients, qui ont accès à un niveau d’expertise CHU. Et pour nous médecins, c’est aussi très pratique : ça permet de nous maintenir à un excellent niveau, de toujours avoir quelqu’un à solliciter, par exemple sur des cas potentiellement épineux, et de transférer des demandes d’examen d’une structure à l’autre.
« Côté innovation, il a été acté récemment que la transition écologique deviendrait la priorité de l’hôpital de Landerneau »
N'est-ce pas impressionnant diriger des personnes qui ont presque deux fois votre âge et une carrière déjà riche ?
MC. : Si. Ça fait très bizarre de me dire que du jour au lendemain, je suis devenu le supérieur hiérarchique de ceux qui m’ont formé, qui m’ont appris la médecine et la radiologie. Même au CHU de Brest : du point de vue médical, je suis désormais au même niveau hiérarchique que des professeurs.
Pour autant, je n’ai pas eu souci particulier, c’est arrivé progressivement. De plus, j’essaie d’avoir une approche la moins verticale, et la plus ouverte et transparente possible. Même s’il m’appartient parfois de devoir trancher et prendre les décisions, je le fais en discutant avec les personnes concernées et en entendant les arguments des uns et des autres.
Ce qui est drôle, c’est que je me suis très vite retrouvé à participer à des réunions d’attribution de postes, de déploiement des internes, d’ouverture de terrains de stage alors que je venais moi-même de finir mon internat !
Vous avez donc également des ambitions universitaires ?
MC. : Oui, depuis très jeune. Mon poste à Landerneau me permet de consacrer du temps à la faculté, comme si j’étais en CHU. L’hôpital ayant la volonté de développer son volet recherche, j’ai également été nommé responsable opérationnel recherche et innovation, afin de structurer les activités de recherche. Côté innovation, il a été acté récemment que la transition écologique deviendrait la priorité de l’hôpital. J’encadre d’ailleurs quelque thèses et travaux de mémoires sur ce sujet. On a aussi développé, avec l’ARS, des séminaires sur la pertinence de prescription d’examen en imagerie pour les 6e année, de manière à les sensibiliser sur la question.
À ce propos, vous promouvez une approche « Green IRM », en quoi ça consiste ?
MC. : Outre la consommation énergétique que représentent les examens d’imagerie médicale, on utilise des produits de contraste : l’iode au scanner et le gadolinium en IRM. Une grande partie des flacons n’est pas utilisée et est déversée dans les eaux usées, soit directement, soit par les urines des patients. Or, les stations d’épuration ne sont pas du tout conçues pour traiter l’iode ou le gadolinium, ce qui implique qu’on en retrouve dans l’eau potable. Le but, c’est de récupérer ce qu’on appelle les fonds de bouteille, soit le surplus qui n’a pas été injecté aux patients. Pour le gadolinium précisément, l’objectif c’est de le réutiliser à usage non médical, potentiellement dans la recherche. C'est un projet né à Brest, mais qui a actuellement une portée nationale, puisque beaucoup de centres d’imagerie y participent.
A voir aussi