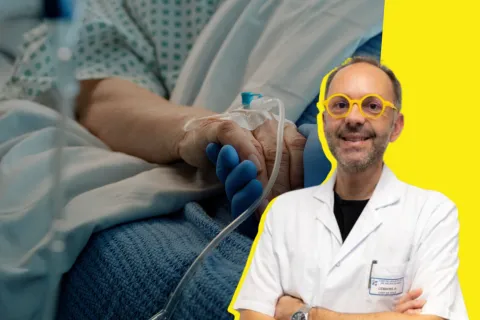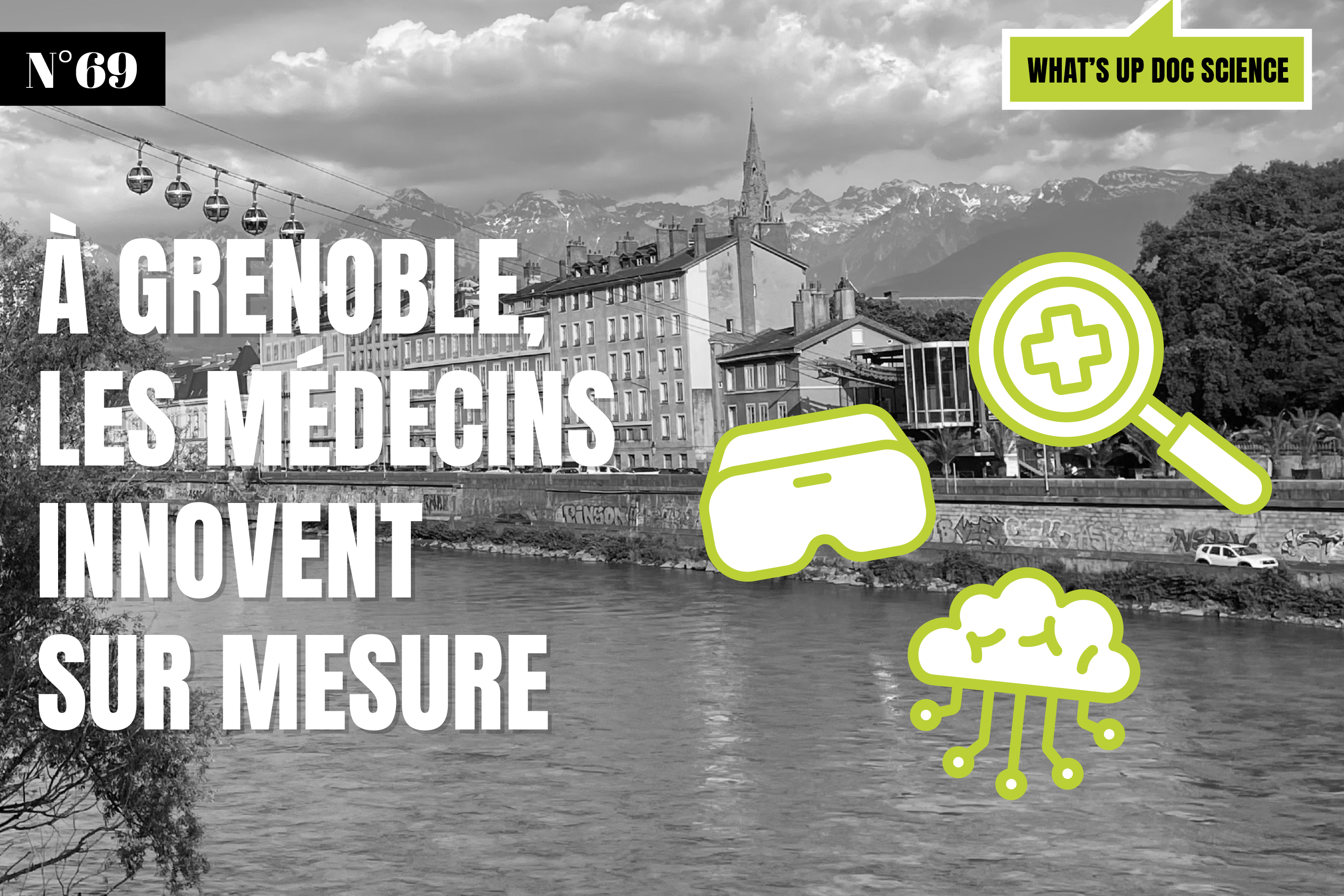
© DR.
« Quand tu as rando après ton service », ou piscine, ou running... Les abris du tram de Grenoble sont placardés de messages dynamiques avec des professionnels en tenue de travail et baskets qui enchaînent, après leur journée, avec un sport de plein air. Ils ont bonne mine et profitent du site pour sauter d’une activité à une autre.
Cela tient du triathlon quotidien et illustre le dynamisme de la place. Grenoble n’est pas forcément réputée pour son air pur ? Qu’à cela ne tienne, il y a 3 massifs autour pour prendre de la hauteur : Chartreuse, Vercors et Belledonne. Ce sont d’ailleurs les noms des 3 entrées principales du CHU Grenoble-Alpes (CHUGA). Un bon moyen de se repérer.
Avec près de 400 médecins engagés dans des projets scientifiques, la dynamique est bien réelle au CHU. « On s’est mis au service des cliniciens-chercheurs », résume Camille Ducki, la directrice de la Recherche et de l’Innovation. Une stratégie autour de 4 axes-phares : neurosciences, traumatologie, maladies respiratoires du sommeil et génomique.
Le tout adossé à des dispositifs solides : conseil scientifique élu, appels d’offres internes, financement transparent, personnel dédié : 200 personnes au total impliquées dans la recherche, dont 80 % dans les services. Et une directrice qui connaît la recherche. Pharmacienne, elle a commencé sa carrière comme attachée de recherche clinique (ARC).
Au CHU de Grenoble, on innove à tous les étages
Dès leur arrivée les internes sont ciblés, aiguillés, accompagnés, voire propulsés vers un Master 2 Recherche. « L’appétence naît aussi dans les services où il y a une vraie culture de la recherche », observe Camille Ducki.
« L’envie vient à ceux qui voient », confirme Gilles Barone-Rochette, professeur en cardiologie interventionnelle et pilote de projets alliant IA et imagerie. « La présence du CEA, le lien avec les start-up, les gros partenariats, attirent les jeunes vers la recherche à Grenoble. » Le praticien essaye le plus possible de faire participer les jeunes dès les premières réunions pour qu’ils voient comment cela se construit, surtout avec des ingénieurs qui n’ont pas le même langage que les médecins.
« Cette recherche, c’est bien plus que simplement inclure des patients dans un essai randomisé. Mais c’est aussi tellement plus exigeant en termes de temps. » Pour développer de nouvelles idées, il y a les « ateliers d’idéation », où les médecins formulent des besoins concrets à des chercheurs… ou à des start-up. « Est-ce que vous avez un rêve ? Quelque chose que vous aimeriez solutionner dans votre pratique ? », leur demande-t-on. Il y en a eu 2 cette année. Le ton est donné.
Enfin, Grenoble oblige, l’écosystème technologique joue à plein. Microtechniques, accélérateur de particules, supercalculateur, Institut multidisciplinaire en intelligence artificielle (MIAI), entrepôt de données... « On part des besoins cliniques pour aller vers l’innovation technologique », précise la Direction. Un modèle de recherche enraciné dans le soin. « Les projets doivent toujours revenir à la clinique », confirme Gilles Barone-Rochette.
Choisir Grenoble pour la recherche
« Je n’ai pas choisi Grenoble par hasard. » Stephan Chabardès, étudiant à Grenoble, se passionne déjà pour l’anatomie fonctionnelle quand il découvre les travaux pionniers du Pr Alim-Louis Benabid sur la stimulation cérébrale profonde. Coup de cœur immédiat : « Je lui écris une lettre et il m’accepte sur un quiproquo, pensant que c’était pour 6 mois, alors que c’était pour l’internat. Une fois sur place, j’ai eu la chance de rester. J’ai appris la neurochirurgie fonctionnelle aux côtés du meilleur expert et j’y suis encore. » Entre neurochirurgie et recherche, il implante des électrodes pour traiter le Parkinson, l’épilepsie et maintenant aussi les TOC ou la dépression résistante avec Mircea Polosan, le chef du service psychiatrie.
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/pre-eclampsie-un-biomarqueur-prometteur-ne-grenoble
L’objectif : moduler les circuits neuronaux ou restaurer les fonctions cérébrales altérées. Grâce au partenariat avec le CEA, cela va encore plus loin avec le développement des sondes infrarouges pour ralentir la maladie de Parkinson, ou encore les interfaces cerveau-machine pour permettre à des patients tétraplégiques de piloter un mouvement.
Ici, la proximité entre cliniciens, ingénieurs et chercheurs crée une synergie rare. On innove parce qu’on en a les moyens, mais surtout parce qu’on en a le besoin. Avec le but au final de rendre la parole, redonner du mouvement, de l’autonomie.