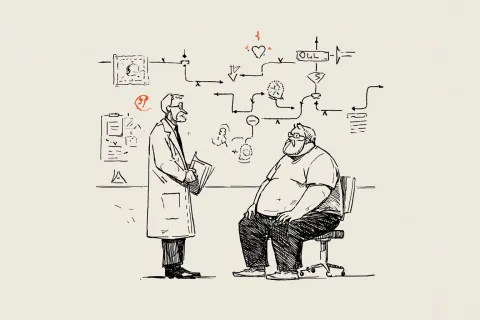Les émissions radioactives provoquées par l’accident de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima n’auraient pas provoqué de décès ni de cancers pouvant être directement attribués à l’exposition aux radiations, à en croire les conclusions d’un rapport du Comité scientifique de l’ONU sur les conséquences des émissions radioactives publié ce 9 mars. « Il y a toujours un risque de cancer quand des populations sont exposées, même à de faibles doses, mais nous ne pensons pas pouvoir détecter d’augmentation par rapport à l’incidence normale de la maladie dans cette population », a précisé Gillian Hirth, présidente de l’Unscear.
Pour rappel, les faits se sont produits il y a dix ans jour pour jour. Le vendredi 11 mars, un séisme de magnitude 9 frappait la côte Est du Japon. Dans la foulée, un tsunami endommageait durement la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi située le long de la côte, provoquant alors un accident nucléaire de niveau 7 sur l’échelle INES. Aux 15 891 décès et 2 579 disparitions induites par la catastrophe naturelle s’est alors ajouté le relâchement d’une quantité non négligeable de radionucléides dans l’environnement. « Les personnes vivant à proximité de la centrale ont subi une exposition externe au rayonnement à partir du nuage radioactif et du dépôt terrestre ainsi qu’une exposition interne due à l’inhalation et à l’ingestion de radionucléides », rappelle l’ONU dans sa page questions-réponses.
Le précédent de Tchernobyl ayant démontré que la thyroïde était un organe particulièrement affecté en cas d’exposition à des composés radioactifs, son incidence dans cette population à risque a particulièrement été scrutée. Dès 2011, le gouvernement nippon a lancé un programme de dépistage massif des cancers de la thyroïde à destination de la population particulièrement fragile des jeunes de moins de 18 ans. Un travail de titan effectué systématiquement qui a permis de mettre en lumière un nombre important de cancers chez les 360 000 enfants dépistés.
Conformément à ses précédentes conclusions datant de 2013 pourtant, les scientifiques de l’ONU ont estimé que cette hausse était imputable à un « effet du dépistage » plutôt qu’à celui des rayonnements ionisants. « L’amélioration des techniques permet de repérer des nodules de très petite taille, et donc des cancers qui ne se seraient sans doute en partie jamais déclarés, a expliqué au Monde Enora Cléro, épidémiologiste à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Ces campagnes de dépistage ont été menées dans la préfecture de Fukushima mais aussi dans des préfectures n’ayant pas été exposées aux retombées radioactives, et les résultats obtenus sont similaires. »
Des conclusions qui n’ont pourtant pas convaincu l’intégralité du monde scientifique. Et pour cause : difficile de comparer les taux d’exposition de Tchernobyl, 10 à 100 fois supérieurs, à ceux de Fukushima. Si l’accroissement du nombre de cancers de la thyroïde a été détecté seulement quatre ans après la catastrophe ukrainienne, celui de Fukushima pourrait donc apparaître bien plus tard. C’est en tout cas l’avis défendu par Florent de Vathaire, directeur de l’unité sur l’épidémiologie des radiations à l'INSERM, qui a étudié le cas de 7 000 enfants exposés avant l’âge de 1 an à de la radiothérapie. « On a bien eu un excès de cancers de la thyroïde pour des doses d’exposition assez faibles, mais il n’est apparu que plus de vingt ans après », argumente-t-il auprès du Monde.
Par ailleurs, certains travailleurs de la centrale ont été plus exposés que la population générale aux émissions radioactives. Depuis 2011, six cas de cancers chez ces employés ont été recensés comme étant des accidents du travail. Et en 2018, le Japon allait plus loin en reconnaissant qu’un des ces anciens salariés, atteint du cancer du poumon, était mort des suites de son exposition. Des zones de flou qui poussent Ketih Baverstock, ancien consultant en santé et radiations ionisantes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à déplorer qu’aucune « étude épidémiologique majeure » ne soit menée. « Ce n’est pas le cas, assure-t-il. Et les experts de l’Unscear sont désignés par des gouvernements qui possèdent des réacteurs nucléaires ». Théorie du complot ou théorie tout court ? Affaire à suivre !