
Une journaliste iranienne s'entête à vouloir couvrir une affaire criminelle dont tout le monde, de la population aux plus hautes autorités, semble faire peu de cas : une série de meurtres de prostituées au sein de la ville sainte de Mashhad. Plus elle se rapproche du criminel, plus elle réalise que la perversité réside ailleurs que dans ses passages à l'acte... Un film nécessaire et courageux, comme nous le rappelle l'actualité récente - et postérieure à sa sortie - mais surtout un tour de force cinématographique.
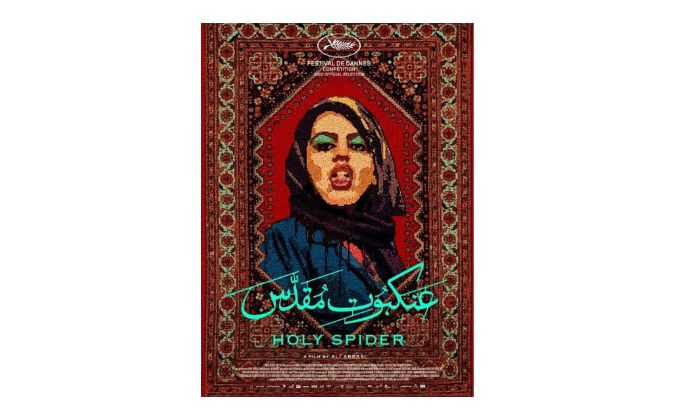
Les Nuits de Mashaad est un film tout en chausse-trappes, un film gigogne qui passe d'un classicisme à l'autre tout en maintenant un niveau de densité narrative et de sous-texte assez sidérant. Une somme et un sommet pour ce qui est le seulement troisième film d'Ali Abbasi - le précédent, Border, était déjà diablement maîtrisé, bien que traitant d'un tout autre sujet. Le contexte ne peut qu'amplifier la déflagration ressentie après sa vue, contexte que vient tragiquement rappeler la tentative d'assassinat sur un Salman Rushdie condamné à mort et à vie par le régime théocratique iranien. Car ce film n'est finalement que cela : une immense charge contre ce pays natal dans lequel il ne pourra probablement jamais revenir, tout comme son actrice principale, Zar Amir Ebrahimi, s'est résignée à s'en exfiltrer. Il est important de le lire avec cette vision, de le découvrir comme un résident iranien le ferait s'il en avait seulement le droit.
Les premières minutes évoquent une traque policière et journalistique à la Zodiac, dans une ville tentaculaire admirablement filmée, où, dans une atmosphère poisseuse et suffocante, se mêlent pour mieux se confondre le sacrilège et le sacré. Mais rapidement le film bifurque vers une autre direction. Abbasi se concentre sur son tueur, l'extirpe rapidement de son mystère pour braquer notre regard sur sa dualité, son apparente normalité, sa monstruosité crue. Il en fait un personnage hitchcockien, un étrangleur de Boston dont on ne peut que constater la progression dans la pathologie pure, une pathologie mosaïque admirablement montrée, l'assassin se montrant tour à tour mégalomane et pitoyable, messianique halluciné et habile cabotin, psychopathe organisé et psychotique imprudent, le tout sur fond de traumatismes de guerre. La façon dont peu à peu son délire contamine l'image et brouille la narration est également remarquable.
Dans une ultime partie, peut-être la plus surprenante, le film acquiert encore une dimension supplémentaire. Le délire se déplace, se renverse, ou plutôt apparaît dans sa réelle dimension, celle d'une société conditionnée jusqu'à l'absurde par un système perverti par le poison de l'emprise théocratique. Le film a été vu comme faisant oeuvre de féminisme, ce qui n'est pas faux, mais est aussi très réducteur, comme si le regard de la critique était biaisé par un prisme tout occidental - critique qui a souvent dénoncé, de façon assez ahurissante a posteriori, une supposée complaisance voire une obscénité dans la façon dont est montrée la violence. La généralisation de cette violence, telle une gangrène, jusqu’au plan final, est pourtant l’antithèse de la complicité, même si elle n’empêche pas l’ambiguïté - la journaliste elle-même n’est pas exonérée de cette obsession du châtiment. Ni féministe ni complaisant, Abbasi est avant tout un cinéaste humaniste, politique, qui au moyen d'une fable terrifiante à la Gogol dans sa description sociétale, et aux accents dostoïevskiens, a décidé de ne fermer les yeux sur aucun aspect de ce qui est infligé à son pays probablement très aimé, et de nous forcer à regarder. Un régime qui laisse tuer ses femmes mais aussi ses fous, et qui a trouvé le meilleur moyen pour perpétuer sa domination : inoculer à son délire chronique une dimension héréditaire.













