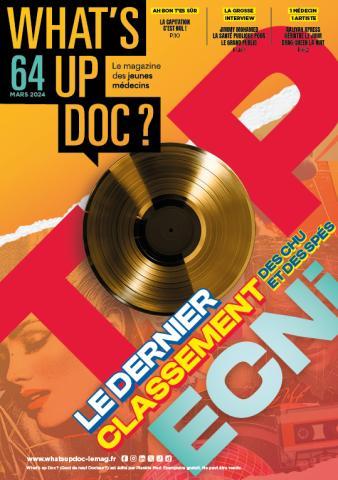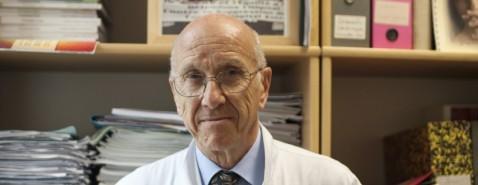What’s Up Doc : Nous vous pensions à la retraite, et vous nous donnez rendez-vous à l’hôpital. Comment cela se fait-il ?
Pr André Grimaldi : Je suis professeur émérite, ce qui veut dire… « vieux ». Je suis retraité depuis maintenant trois ans, et je ne suis plus chef de service depuis six ans. Mais je suis à l’hôpital tous les jours, où j’ai une vacation par semaine pour voir des patients. Et je continue à enseigner.
WUD : N’avez-vous pas peur qu’on dise que vous ne voulez pas laisser la place ?
AG : La place est laissée ! [Rire]. Je ne prends la place de personne, et je dois même rapporter un peu d’argent à l’hôpital qui me paie 200 € par mois. Je pense d’ailleurs qu’un des critères pour être chef de service, c’est de savoir organiser sa succession, si possible en choisissant quelqu’un de meilleur que soi. Ce qui a été mon cas.
WUD : En tout cas, vous n’êtes pas retraité des médias. On vous a parfois qualifié de lanceur d’alerte hospitalier. Est-ce un qualificatif que vous pourriez reprendre à votre compte ?
AG : Pas du tout ! Il se trouve que j’ai une situation privilégiée : quand vous n’êtes plus directement en charge, vous n’avez pas à défendre un pré carré ou la carrière de vos élèves, et vous êtes donc plus libre. Mais je ne suis pas un lanceur d’alerte au sens où peut l’être quelqu’un comme Irène Frachon, dont je salue l’action.
WUD : Vous êtes tout de même un médecin médiatique. Qu’est-ce qui vous a amené à occuper le devant de la scène ?
AG : Tout a démarré un jour de 2003. J’assistais au choix des stages par les internes, comme représentant de l’endocrinologie-diabétologie. C’était une époque où le numerus clausus était très bas : ce jour-là, beaucoup de postes pour lesquels on avait besoin d’internes sont restés vacants. Face à cela, la communauté médicale s’est déchirée : les différentes spécialités cherchaient à se piquer des postes. C’était un pugilat honteux où personne ne se préoccupait des besoins de santé publique. Horrifié, j’ai pris ma plume et j’ai adressé au ministre Jean-François Mattei une lettre co-signée par une cinquantaine de PU-PH. Évidemment, cette lettre est restée sans réponse. La moutarde m’est montée au nez, et j’ai envoyé mon texte à France Info. Ils m’ont interviewé et m’ont fait passer en boucle sur leur antenne. Dans la journée, le ministère m’appelait pour me demander de venir en urgence. Ce jour-là, j’ai compris que France Info et Le Parisien étaient devenus plus importants que les patrons en médecine. J’ai retenu la leçon.
WUD : Leçon que vous avez su mettre en œuvre quelques années plus tard, avec le Mouvement pour la défense de l’hôpital public…
AG : Effectivement. En 2009, au moment de la loi HPST [Hôpital, Patients, Santé, Territoire - NDLR], j’ai regroupé une communauté de collègues qui s’opposaient à ce que nous considérions comme une transformation de l’hôpital en entreprise marchande. Les médias se demandaient ce qui se passait, et ils ont invité sur leurs plateaux ce diabétologue avec lequel se retrouvaient des médecins et des non-médecins de droite et de gauche, du privé et du public…
WUD : Vos engagements actuels en faveur de l’hôpital public sont-ils une réminiscence de ceux de votre jeunesse ?
AG : Je ne me suis jamais caché de mon engagement à la LCR [Ligue communiste révolutionnaire - NDLR] après le mouvement de mai 68. Maintenant, on me le ressort comme si je devais porter l’étoile jaune de la politique ! Oui, à cette époque, je voulais changer le monde. J’ai donc pour un temps délaissé les livres de médecine pour lire les bouquins de politique et d’économie.
WUD : Et comment cet engagement a-t-il pris fin ?
AG : Je garde un bon souvenir des personnes que j’ai fréquentées à cette époque-là, mais à un moment donné, j’ai eu l’impression d’être coupé de la réalité. J’étais dans une logomachie politique qui tournait à vide. Et puis je vivais un déphasage qui n’était pas tenable, car j’avais une véritable passion pour la médecine. Je me suis dit que puisque je ne pouvais pas changer le monde, j’allais au moins essayer de changer le service de diabétologie où je travaillais comme chef de clinique, puis comme PH.
WUD : Quelles étaient vos ambitions pour ce service ?
AG : L’idée a été d’abord de changer les habitudes autour du concept d’éducation du patient. Dans le service, l’éducation consistait à projeter quelques films aux patients, à leur apprendre à mesurer sucre et acétone dans les urines, à leur montrer comment se faire leur piqûre. Les hospitalisations pouvaient durer deux semaines, voire un mois. Il y avait 60 lits et seulement trois boxes de consultation. Je suis donc allé voir ce qui se passait ailleurs, et notamment à Genève qui était pour moi la Mecque de l’éducation thérapeutique du patient. Au début, avant ma nomination comme PU-PH, on y allait quasi clandestinement, sur le temps de vacances.
WUD : Combien de temps a pris cette transformation ?
AG : Plus de 20 ans. Quand j’ai été nommé chef de service, j’ai voulu moderniser la structure, développer la recherche clinique, créer des unités spécialisées plus petites grâce au développement de l’ambulatoire… On a réduit de moitié le nombre de lits, et on a gardé tout le personnel. Les infirmières de consultation n’étaient plus des infirmières en fin de carrière fatiguées de faire des lits et de venir le dimanche. Elles comptaient parmi les plus motivées, elles avaient fait des DU, elles étaient capables de suivre les patients. Je trouvais absurde qu’elles soient cantonnées à faire des prises de sang et des examens d’urine.
WUD : Quel a été le rôle de la direction de l’hôpital ?
AG : J’ai eu la chance d’avoir trois directeurs successifs qui ont accompagné complètement le changement, auxquels je pouvais dire : « on ferme une salle, mais je garde les infirmières qui vont suivre des malades et les éduquer ». Ces directeurs concevaient l’administration comme étant au service des projets professionnels. Aujourd'hui, c’est nous qui sommes à leur service. Et encore, pas à leur service, mais à celui des comptes et des indicateurs. Tout le monde a appris à tricher…
WUD : Vous semblez très remonté contre la gestion hospitalière actuelle…
AG : Oui. La T2A [Tarification à l’activité - NDLR] est adaptée aux prises en charge programmées et standardisées, mais elle est totalement inadaptée à la maladie chronique, pour laquelle il s’agit de personnaliser les traitements et d’aider les patients à adopter de nouveaux comportements. Cela relève d’une médecine intégrée : biomédicale, pédagogique, psychologique et sociale. C’est une médecine qui se pratique en équipe, qui suppose une coordination entre l’hôpital et la ville, pour laquelle la T2A ne peut pas fonctionner et ne fonctionne pas. Pour nous c’est un carcan qui coûte cher. Mais les addicts à la T2A proposent de la complexifier un peu plus !
WUD : Mais les autres modes de financement comme le prix de journée et la dotation globale ont eux aussi des effets pervers. Alors comment fait-on ?
AG : L’hôpital vit sous le régime de la pensée unique : on a utilisé successivement le prix de journée jusqu’en 1983, puis la dotation globale jusqu’en 2004, puis la T2A qui a été généralisée en 2008. Il faudrait en réalité utiliser les troi en même temps. Pour les soins palliatifs, on ne trouvera pas mieux que le prix de journée. La T2A est adaptée à une prothèse de hanche standard, à une cataracte ambulatoire… La dotation globale (modulée d’une année sur l’autre en fonction de l’activité) est la moins mauvaise façon de financer la prise en charge de la maladie chronique et des maladies complexes. Quant à la médecine de ville, on pourrait imaginer un forfait annuel par patient diabétique de 200 €, au lieu de facturer en moyenne neuf consultations par an à 23 € chacune.
WUD : Vous pensez vraiment que le contexte politique actuel de la médecine libérale permet d’aller vers le forfait ?
AG : C’est possible de changer, à condition de ne pas agresser ceux qui ne veulent pas changer. Il y a des jeunes médecins, et des moins jeunes, qui veulent créer une autre santé publique. C’est avec eux qu’il faut passer au forfait pour le suivi des patients atteints de maladies chroniques. Ceux qui veulent rester au paiement à l’acte doivent pouvoir y rester.
WUD : Et pensez-vous que la jeune génération actuelle est prête à aller dans ce sens ?
AG : Je me méfie des questions de génération. Comme disait Brassens, « le temps ne fait rien à l’affaire ». Ce n‘est pas vrai que les jeunes ne pensent qu’aux loisirs, il existe des jeunes motivés. Ils sont enthousiastes s’ils ont le sentiment d’être valorisés, d’être intégrés dans une équipe où ils sont utiles, participent à la recherche et apprennent leur métier. Et s’ils ne le sont pas, c’est peut-être de notre faute. Quel monde et quelle médecine allons-nous leur laisser ?
___________________________________________________________________
BIO EXPRESS
1968 • Internat à Paris
1987 • Formation en Suisse où il découvre l’éducation thérapeutique
1999 • Devient chef de service de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière
2009 • Fonde le Mouvement pour la défense de l’hôpital public
2013 • Prend sa retraite, devient professeur émérite.
___________________________________________________________________
2016 • Les Défis de la maladie chronique, à paraître, Éd. Odile Jacob
2015 • La Vérité sur vos médicaments (collectif), Éd. Odile Jacob
2013 • La Santé écartelée, Éd. Dialogues Éducation thérapeutique, 3e édition, Ed. Elsevier Masson
2011 • Manifeste pour une santé égalitaire et solidaire (collectif), Éd. Odile Jacob
2009 • L’Hôpital malade de la rentabilité, Éd. Fayard
2007 • Traité de diabétologie, Éd. Flammarion
___________________________________________________________________