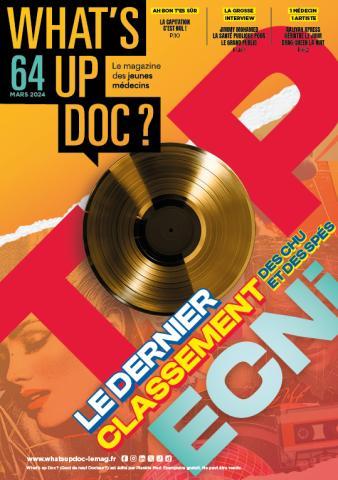Le réalisateur surdoué et peu prolifique Joanathan Glazer fait œuvre de pédagogie au moyen d’un film d’une dialectique radicale, d’une force et d’une ampleur inouïes.
Rarement on avait autant scruté, analysé, commenté une œuvre de cinéma. Depuis le Festival de Cannes, où l’on ne l’attendait probablement pas si haut dans le palmarès - et ce bien que le Grand Prix du Jury revienne régulièrement à des films controversés -, chacun veut se faire son idée sur la Zone d’Intérêt. Le succès du film témoigne de cette curiosité, d’autant plus bienvenue que notre époque crie sa peur d’une ignorance pourtant déjà bien installée. En préambule, contrairement à beaucoup de commentateurs intransigeants sur le sujet, notre a priori est plutôt positif quand un cinéaste s’attaque frontalement à l’univers concentrationnaire, qui plus est à la Shoah. Il est rare qu’il le fasse par plaisir et par facilité, et il est rassurant que des artistes éprouvent encore le besoin ou l’envie de s’exprimer sur le sujet. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Glazer s’y est attelé avec une ambition et une puissance peu communes. Certains ont été freinés par la forme même du film, qui est effectivement la clé de tout et qui rend limpide et peu attaquable le fond du propos, rapportant ce dispositif à une installation muséale. Si tel est le cas, alors ce serait la première fois que nous serions sortis autant éprouvés, sensoriellement éprouvés, d’une exposition.
Glazer installe en effet une multitude de caméras au sein de la maison Höss, procédé qui nous renvoie à notre actualité, à notre obsession pour la réalité, mais qui nous montre par là même, immédiatement, que cette réalité-ci, sur un tel sujet, ne peut être qu’un ersatz. Cette transparence intrusive, implacablement moderne, appliquée à une période et une doctrine politique à laquelle renvoie le constant contrôle géométrique du cadre et des images, constitue paradoxalement une impasse pour arriver à « voir » l’horreur. Le hors-champ, celui du déni, existera toujours, au cinéma comme dans nos psychés. C’est ce hors-champ, bien moins à risque de travestissement du réel, et horriblement symbolisé par une bande son qui fera date par sa sobriété et sa technicité, qui constitue le cœur de la dialectique de Glazer.
Dans un premier temps, tout le film, tous les personnages sont à l’unisson de cette banalité du Mal si couramment décrite. Par des images banales, renvoyant à des événements anodins, par des élans d’enfants et des rituels adultes, Glazer montre à quel point nous avons tous, en nous, cette capacité à nous adapter, à nous accommoder, même quand l’ignoble est au fond du jardin, quand il siège à notre table. Cela renvoie à notre condition, à notre nécessité, s’adapter pour survivre, cloisonner pour se protéger, ne pas faire de la vie un champ de mines. Cette aptitude, poussée à l’extrême, constitue ainsi également notre danger, notre disposition à l’oubli, contextuel plus que mémoriel. Elle peut nous rendre ignobles, hier comme aujourd’hui.
Pourtant, plus le film avance, plus il se fissure. Ici, une mystérieuse villageoise qu’on ne suivra qu’en vision infra-rouge, fantôme de la liberté. Là, la mère de la maîtresse de maison, première admiratrice de sa fille et de son gendre, mais qui désertera la demeure après seulement une nuit, seulement une vision. Ailleurs encore des jeux d’enfants contaminés par la cruauté, des regards innocents qui se détournent brutalement d’une fenêtre. Glazer suggère ainsi que, antonyme de l’indifférence, notre adaptabilité n’est que de façade et que, chez chacun, elle a un prix. Les atteintes psychiques ne sont pas moins profondes parce qu’elles sont invisibles. Le Mal laisse son empreinte, chez chacun, et le film trace une ligne - une zone - entre ceux qui l’incorporent, qui en font leur (in)humanité, et les autres.
Le film se conclut sur une nausée de Höss que d’aucuns pourraient rapporter à une somatisation : exposé à son ignominie, n’importe quel individu finirait toujours par en être malade, par la vomir. Nous préférons y voir, aidés en cela par des images actuelles de femmes de ménage s’attelant à nettoyer un Auschwitz devenu gigantesque musée, son écœurement face à son échec inéluctable, à l’impossibilité, malgré ses ambitions à installer une ingénierie exterminatrice sans limite, d’éradiquer un peuple, d’empêcher la construction mémorielle. Mais aussi que, tel ces employées, chacun d’entre nous doit s’atteler, sans cesse, à entretenir sa mémoire, individuelle et collective, pour au final préserver sa part d’humanité.