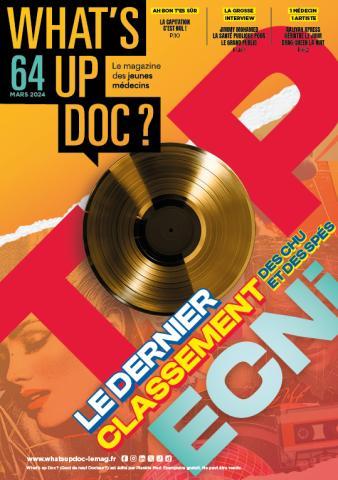Suite à la pandémie, nombre de candidats aux élections se sont emparés de la question de l’hôpital en réclamant de l’embauche de soignants ou en voulant restaurer le service public en général. On ne peut qu’approuver dans son principe un tel projet, même si l’on peut douter de sa concrétisation. Non seulement le candidat en tête dans les sondages, Emmanuel Macron, n’en prône pas, mais encore les gouvernements de gauche successifs ont introduit la maîtrise des dépenses publiques dès l’origine, avec le tournant de la rigueur en 1983.
La « main gauche » de l’Etat, comme disait le sociologue Pierre Bourdieu, n’offre donc guère de garantie en la matière et plus d’un observateur en a conclu à des accointances de l’Etat avec le marché, les grands groupes privés et l’accumulation du capital.
Sans être privé, l’hôpital public n’échappe pas à la tendance de la réduction des dépenses publiques. Pour le défendre, on ne peut donc pas non plus s’en remettre à la représentation et faire l’impasse sur un meilleur contrôle des politiques publiques par les principaux concernés : les usagers et les personnels hospitaliers.
S’appuyer sur l’initiative soignante
Notons d’abord que les médecins ont jadis eu plus de pouvoir sur l’hôpital public. Nombre de députés médecins, souvent de droite, défendaient leur fief et exerçaient un magistère mandarinal sur les petites mains soignantes, avant de se convertir plus tard au management hospitalier. Il ne s’agit pas de revenir à ce contrôle féodal et bourgeois tout à la fois, des médecins issus de bonnes familles.
D’autres réformes ont un temps mis l’accent sur l’amélioration de la qualité de soins, en sollicitant la participation des soignants, notamment lors de l’accréditation des établissements hospitaliers. Ainsi, des protocoles médicaux et paramédicaux ont été élaborés par les professionnels eux-mêmes, pour améliorer la qualité de soin.
La crise de la pandémie a fourni aussi l’occasion aux soignants de prendre les affaires en main dans les services covidés : dans les hôpitaux comme dans les EPHAD, les cadres leur ont laissé l’initiative. Mais, si leur participation fut requise dans l’urgence, un retour à l’ordre s’en suivi en lieu et place d’une quelconque refonte de l’organisation du travail.
Ce n’était d’ailleurs pas la première fois. Les périodes de crise ou d’urgence sanitaire créent souvent un appel d’air pour les collectifs de travail, qui se retrouvent sur le pont. Il en est ainsi lors des tempêtes, des canicules, des épidémies diverses, et il en fut tout particulièrement ainsi lors de l’irruption du sida, épisode mémorable qui marqua les services infectieux autant que les participants aux mouvements associatifs hors les murs de l’hôpital. Chaque fois, et plus régulièrement aux urgences ou au bloc opératoire, une dynamique collaborative se met en place particulièrement égalitaire, car, face à l’inconnu, nous sommes tous égaux et tout le monde est sollicité de la même manière, du simple agent au médecin : on a besoin de l’avis de tous et toutes.
Ce sont ce que j’ai appelé des mobilisations consensuelles, car, si elles n’ont aucun motif contestataire, elles créent en même temps une dynamique inclusive qui subvertit pour un temps les logiques hiérarchiques officielles et symboliques, autrement dit établies selon le grade et le diplôme, ou selon le genre et l’origine sociale.
Mais pourquoi se référer à de telles situations d’exception, si récurrentes soient-elles, alors qu’il existe des représentant.e.s élu.e.s aux élections professionnelles par le personnel hospitalier ?
Faiblesse des syndicats
La Fonction publique hospitalière comprend des Commissions administratives paritaires et des Comités techniques d’établissement. Les deux sont consultatifs et reposent sur une concertation entre représentants du personnel et de la direction pour traiter soit de l’avancement de carrière personnel des agents (CAP), soit des questions collectives d’organisation (CTE) et jouent, au mieux, un rôle d’apprentissage du dialogue social.
Il y a peu de littérature sociologique sur le fonctionnement sectoriel des commissions paritaires. Mais, du fait notamment de leur caractère consultatif, on peut douter de leur impact sur le quotidien hospitalier. En effet, au cours des 500 entretiens que j’ai réalisés auprès de tous les métiers de l’hôpital, au cours de 8 enquêtes sur les relations de travail dans les services, personne ne l’a évoqué.
Dans les mondes du travail en France, le milieu des syndiqué.e.s a le plus souvent constitué un monde à part, minoritaire : traditionnellement, ce sont surtout les militant.e.s fortement investi.e.s qui font le lien avec les personnels non syndiqués.
A l’hôpital, les soignants votant aux élections professionnelles ne sont pas majoritaires et sont moins syndiqués en pourcentage que les personnels non soignants. Cela peut s'expliquer par d'une part une forme d'individualisme des un.e.s et de l'autre un fort bureaucratisme. Il y a sans doute des cercles vicieux où lassitude, désengagement et bureaucratisme s’entretiennent. Tout le monde converge en tous cas, syndicats compris, pour constater que le temps syndical est absorbé par les structures de concertation.
Des mobilisations hors des syndicats
On peut surtout invoquer une autre expérience, celle des luttes sociales. Les rares fois où les soignant.e.s se sont mis en grève, ces derniers-ères ont crée des comités ad hoc au lieu de se contenter de suivre les syndicats représentatifs. C’est arrivé au moins deux fois, en 1988-89 avec la mise en place de coordinations lors de la grève des infirmières et en 2019, avec la mise en place d’un conseil national de grève, lors de la grève des urgences.
Souvent, les syndicats prétendent représenter de facto les salarié.e.s sans éprouver le besoin de se placer sous leur contrôle lorsque ces derniers se mobilisent. Ils ne cherchent pas à créer une mobilisation égalitaire, précisément du type de celles que vivent les soignants du fait des crises ou des urgences sanitaires qui secouent leur travail. Pour monter dans la structure syndicale, il faut souvent en saisir l’ethos bureaucratique, pour qui le souci de la structure passe avant celui des personnels. Pour travailler en équipe, il faut pouvoir au contraire compter sur les autres.
Des militants, syndiqués ou non, ont pu rencontrer l’hostilité des appareils fédéraux lors de grèves retentissantes. Lors de la grève récente des urgences, le comité inter urgences, émanation du conseil national de grève, a ainsi sollicité leur aide en vain (sauf celle de Sud-santé) voire a ressenti des blocages de la part des appareils.
Alors si ni l’administration, ni les médecins, ni les appareils syndicaux ne se fondent sur la mobilisation soignante, qui peut le faire ?
Le tabou social et politique du pouvoir populaire
La question est d’augmenter le pouvoir des soignants dans l’hôpital. Ils ne décident de rien et l’on ne voit pas comment améliorer l’organisation du travail sans changer cet état de fait. Si l’on s’intéresse à améliorer la qualité de soin, à faire des économies, à fidéliser le personnel, à en recruter et à en former de nouveaux, nul n’est mieux placé que le personnel soignant lui-même. En effet, il connait son affaire, il est au contact, c’est d’ailleurs pour cela qu’on a compté sur son initiative dans des situations difficiles, comme lors de la récente pandémie.
Surtout, à quelles dépenses inutiles incline-t-il ? A un plan de communication en papier glacé ? A faire intervenir des consultants de luxe ? Vendre des médicaments fort chers ? Vouloir un « partenariat public privé » clientéliste ? Construire un bâtiment vitrine ? Embaucher du personnel sans lien utile au service ? Même l’augmentation des salaires ne prendrait pas des proportions indécentes, si le personnel avait son mot à dire. C’est ce que suggèrent en tous cas les entretiens avec les soignants, mais aussi les historiens et les sociologues des classes populaires, qui mettent en évidence une « économie morale » ou des habitus populaires spécifiques, notoirement collectifs ou orientés vers l’utile et le nécessaire, du fait de leur socialisation. A l’hôpital, l’esprit d’équipe au travail prolonge la modestie des revenus et le sens des économies des milieux populaires.
Le tabou vient d’en haut, il est politique et social. En effet, si les réformes managériales ont grignoté le pouvoir des médecins, ce n’est pas pour le donner aux salariés, mais pour comprimer le seul poste budgétaire sur lequel on pense pouvoir légitimement rogner : la masse salariale. Ainsi, l’ONDAM (Objectif national de dépenses d'assurance maladie) montre les évolutions des économies faites sur le dos des hôpitaux et non sur celui de la médecine libérale, sans parler du prix des médicaments imposé par l’industrie pharmaceutique. Or non seulement un plus grand pouvoir du personnel hospitalier pourrait trouver des sources d’économie ailleurs, aux dépens des laboratoires et de la médecine libérale précisément, mais surtout il pourrait mieux gérer la masse salariale, la sienne comprise.
Le contre-pouvoir des usagers
Certes, tout pouvoir institué, si populaire et large soit-il, comprend ses limites. Il n’est pas douteux qu’un plus grand pouvoir des personnels générerait aussi des blocages, des routines, des abus, non pas du fait de sa nature sociale, mais du fait de la nature du pouvoir majoritaire : si démocratique soit-il, il peut contraindre une minorité d’une part, d’autre part ne pas s’intéresser aux autres collectifs que ceux qu’il représente – comme ceux des usagers.
Signalons tout de même, au préalable, que personne n’a rien à regretter à l’éradication du pouvoir féodal de l’Ancien Régime, malgré les difficultés de la légitimité démocratique et républicaine moderne. Néanmoins, s’il faut aller de l’avant, comment limiter les risques de ce nouveau pouvoir majoritaire ?
Sans nul doute, il faudrait retrouver ici des contre-pouvoirs, notamment chez les usagers de l’hôpital. La question n’est pas simple, car les usagers de l’hôpital sont par définition irréguliers, sauf les malades chroniques. Mais il existe des collectifs, comme des associations de malades, de quartier, ou de défense du service public, qui peuvent aussi dire leur mot sur la gestion de l’hôpital. Pour l’instant, la participation des usagers aux instances est parcimonieuse et sous contrôle vertical. Ainsi, les conseils d’administration des hôpitaux comprennent quelques « usagers » nommés par les Agences Régionales de Santé. On pourrait rendre cette participation plus démocratique, en veillant à ce que les personnes les plus démunies ne soient pas les moins sollicitées.
A ce rééquilibrage du pouvoir par le bas, il faudrait aussi préserver un principe dynamique pour garder intacte la force de mobilisation soignante, sa capacité d’initiative en fonction des événements. Il faudrait donc inventer des formes de défi de l’institué, non seulement de roulement des responsables, mais aussi de partager le pouvoir d’initiative, comme de pouvoir déposer un projet aux suffrages des autres. Le pouvoir créatif de l’instituant est un gage de réactivité de l’institution, mais aussi du maintien de la spontanéité et du moral des troupes.
Evidemment, une telle philosophie démocratique ne se limite pas au milieu soignant. Les Communards l’avaient bien compris, eux qui posèrent le principe de toute une refonte démocratique du pouvoir et du travail. Alors pourquoi commencer par l’hôpital ? Peut-être justement parce qu’il nous montre où et comment il y a urgence.
![]()
Ivan Sainsaulieu, Professeur des université - Sociologue, Université de Lille
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.